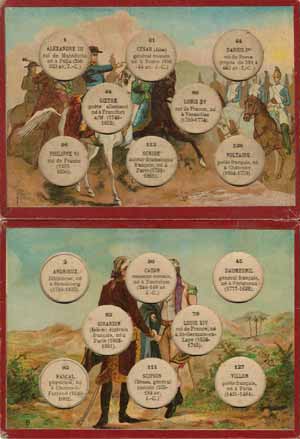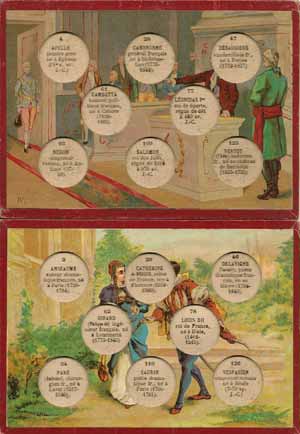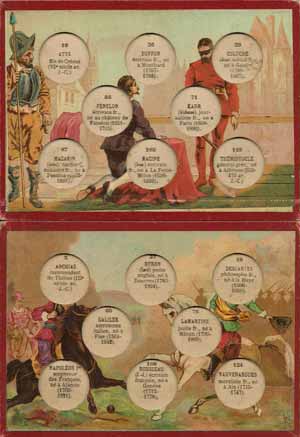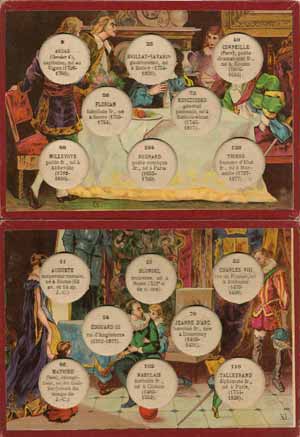___________________________
Gilbert Beaugé est sociologue et historien de l’art. Chargé de recherches au CNRS (Centre Norbert Elias-Vieille Charité-Marseille) et à l’EHESS, il s’intéresse depuis une dizaine d’années aux rapports entre textes et images, des origines à nos jours. En ce moment il travaille sur les Tentations de Saint Antoine et les images de la monstruosité imaginaire. Dernier ouvrage mis en ligne : « Autopsie d’un acte manqué : l’hommage à Delacroix d’Henri Fantin-Latour », Halshs, 2009.
Lire son article : Autoportraits de l’artiste en saint Luc peignant la Vierge
Julie Beaulieu termine actuellement une recherche postdoctorale au Mel Hoppenheim School of Cinema de l’Université Concordia (Canada). Elle coédite l’ouvrage de Rosanna Maule In the Dark Room: Marguerite Duras and Cinema (Bern : Peter Lang, 2009), une collection d’essais sur le cinéma de Marguerite Duras à laquelle elle contribue avec un texte intitulé « The Poetics of Cinematic Writing: Marguerite Duras and Maya Deren ». Elle a publié divers articles dont « Ethnographie, culture et expérimentations. Essai sur la pensée, l’œuvre et la légende de Maya Deren », Cinémas : revue d’études cinématographiques, vol. 19 / n° 1, Automne / Fall 2009, « La ‘chambre noire’ dans Le Camion de Marguerite Duras », dans Bryan Stimpson et Myriem el-Maïsi, Marguerite Duras : écritures, écriture (Caen : Lettres Modernes/Minard, 2007), « Le théâtre d’une écriture: le cinéma d’India Song », dans Coulisses, n° 33 (Franche-Comté : Théâtre universitaire/Presses universitaires de Franche-Comté, 2006), et plus récemment « La voie/voix féministe durassienne », L’écriture au féminin : Histoire, apports, enjeux (XIXe et XXe siècles), Intercâmbio. Revista de Estudos Franceses da Universidade do Porto (Porto (Portugal), 2010).
Lire son article : Cette voix qui a inspiré Catherine Breillat
Docteure en histoire de l’art, Stéphanie Danaux a obtenu en 2004 une bourse de Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour sa thèse intitulée L’essor du livre illustré au Québec en relation avec les milieux artistiques et éditoriaux français, 1880-1940. Spécialiste de l’histoire de l’illustration, elle poursuit actuellement ses travaux en tant que chercheure postdoctorale au sein du groupe « Penser l’histoire de la vie culturelle » du Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) de l’Université de Montréal. Elle s’intéresse notamment aux livres et journaux illustrés, aux imprimés pour la jeunesse et aux transferts culturels France-Québec. Elle a publié divers articles dans MENS. Revue d’histoire intellectuelle de l’Amérique française (2005), Etudes canadiennes / Canadian Studies (2008), Revue de BAnQ (2009) et Cahiers Daumier (2010). Plusieurs actes de colloque sont également à paraître. Site personnel.
Lire son article : Franges d’autel ou la tentation du livre de luxe au Québec
Benoît Delaune est docteur en littératures générales et comparées, auteur d’une thèse autour de William Burroughs et du procédé d’écriture de collage-montage appelé « cut-up ». Ce travail l’a amené à élargir ses recherches aux arts en général et surtout à la musique, notamment par le biais d’une approche narratologique. Par ailleurs musicien, il participe à de nombreux projets dans le champ des musiques dites nouvelles et improvisées.
Lire son artcile : William Burroughs et le cut-up, libérer les « hordes de mots »
Graphiste de formation (école supérieure d’arts graphiques Estienne, à Paris) ; Marie-Laure Delmas a obtenu une maîtrise en arts du spectacle, cinéma et audio-visuel (à Saint-Denis Paris 8). Actuellement en Master 2 de Littérature française (Paris 8), elle travaille sous la co-direction de messieurs Patrick Brasart et Patrick Wald Lasowski. Elle s’intéresse aux rapports que Sade entretient (directement ou indirectement) avec l’image, ceux que sa réception tisse entre ses différentes représentations. Plus largement, ses recherches l’amènent à réfléchir sur les images et l’imaginaire du 18e siècle et du tournant des Lumières.
Elle a participé au Colloque International Théories de la réception et cinéma : Spectateurs et publics, auteurs et lecteurs qui s’est tenu à l’Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand du 10 au 12 février 2010 : « (S’) adapter, c’est mourir ? Pasolini, Sade et le cinéma » (les actes du colloques sont à paraître courant 2011). Elle a également publié « Le fait est certain et cela suffit : regard des Lumières sur l’eunuque », Dix-huitième siècle, n°41, 2009, pp.431-447.
Lire son article : Le Spectre et la camelote. Clichés du roman noir en mouvement
Irène Fabry-Tehranchi est une ancienne élève de l’ENS-LSH, agrégée de Lettres Modernes, elle fait partie du Centre d’Etudes sur le Moyen Age de Paris 3 Sorbonne Nouvelle et travaille comme Attachée Temporaire d’Enseignement et de Recherche en Littérature Française à l’université Paris-Est, Marne la Vallée. Elle a contribué à la préparation d’expositions de la Bibliothèque Nationale de France et à la rédaction du site La légende du roi Arthur. Dans le cadre de sa thèse sur les manuscrits de Merlin et de la Suite Vulgate, elle publié plusieurs articles portant sur la relation entre Texte et Images, notamment « Continuity and Discontinuity : Illuminating and Interlacing the Adventures of Viviane and Merlin in the Prose Merlin », Marginalia, the Journal of the Medieval Reading Group at the University of Cambridge, 3, Illuminations, 2006 ; « Le livre de messire Lancelot du Lac : présentation matérielle et composition des manuscrits arthuriens de Jacques d’Armagnac (BNF fr. 117-120 et 113-116) », 22e congrès de la Société Internationale Arthurienne, Rennes, 15-20 juillet 2008 ; « L’intégration littéraire et iconographique du motif de la descente du Christ aux Enfers à l’ouverture du Merlin ». Textes sacrés et culture profane : de la révélation à la création, Oxford : Peter Lang, 2010, pp. 225-258.
Lire son article : « Conment Merlin se mua en guise de cerf » : écrire et représenter la métamorphose animale
dans les manuscrits enluminés de laSuite Vulgate
Ancienne élève de l’ENS, Valérie Hayaert est actuellement coopérante universitaire à l’Institut Supérieur des Langues de l’Université de Carthage, Tunisie. Auteur d’une monographie intitulée Mens emblematica et humanisme juridique : le cas du Pegma cum narrationibus philosophicis de Pierre Coustau, Lyon, Macé Bonhomme 1555, THR, Droz, 2008, elle poursuit ses recherches sur l’humanisme juridique (Budé, Alciat, Politien) afin d’étudier le système vexillologique de l’âge moderne à la lumière de l’invention et de la promotion polémique de ce que fut, dans l’histoire de la réception du droit romain, le mos gallicus. Le rapport qu’entretinrent les juristes européen à l’âge moderne vis-à-vis de l’image constitue un des axes de ce projet.
Lire son article : Calumnia, De famosis libellis et ripostes aux attaques injurieuses : la verve satirique de l’emblème
Aude Jeannerod est en deuxième année de doctorat à l’Université Jean Moulin Lyon 3 et travaille sous la direction de Jérôme Thélot. Ses recherches portent sur la critique d’art de Joris-Karl Huysmans et elle a notamment collaboré à la Revue d’Histoire Littéraire de la France (« Le genre de la critique d’art chez Joris-Karl Huysmans : fiction ou non-fiction ? », RHLF, fin 2010, à paraître). Agrégée de Lettres Modernes, elle enseigne actuellement dans le secondaire.
Lire son article : Montrer l’invisible et dire l’indicible :
images et langages du divin dans les écrits
sur l’art de J. K. Huysmans
Marie Legret est professeur agrégée de Lettres Modernes et doctorante en littérature comparée à l’Université de Paris IV – Sorbonne sous la direction de M. Bernard Franco. Son doctorat a pour titre provisoire : L’apprentissage du regard : subjectivité et image dans la narration poétique de Novalis, Nerval, Rilke et Char. Elle a travaillé deux ans en Allemagne en tant qu’assistante de Français à la Gaussschule de Braunschweig (Basse-Saxe), ce qui lui a également permis d’effectuer plusieurs séjours de recherche auprès de la Novalis-Gesellschaft à Oberwiederstedt.
Lire son article : René Char, Pour une lecture de Recherche de la Base et du Sommet
Né en 1968 en Angleterre, Harold Manning passe son bac en France tout en travaillant en cachette comme graphiste dans une salle de cinéma d'Art et essai. Etudiant à la Sorbonne, il écrit ses premiers scénarios et filme des courts métrages tout en travaillant chez des distributeurs ou des vendeurs internationaux (Connaissance du Cinéma, Forum Distribution, Pyramide Distribution, Pyramide International, Celluloïd Dreams). Il participe dès 1988 à la création et la programmation du festival d’Angers « Premiers Plans ».
Louis Skorecki le fait jouer dans ses Cinéphiles. Il tient également un petit rôle dans le récent Mr. Nobody de Jaco Van Dormael.
Son premier long métrage, Loin du front, est co-réalisé en 1998 avec Vladimir Léon. Il filme ensuite des documentaires, principalement des entretiens avec des cinéastes (Sydney Pollack, Robert Redford, Hou Hsiao-Hsien), et découvre le théâtre en devenant l’assistant de Deborah Warner puis de Robert Wilson.
Il collabore régulièrement à l’antenne de France-Inter. En 2005, il tient chez Rebecca Manzoni une chronique de globe-trotter amoureux des salles de cinéma du monde.
Scénariste ou adaptateur, diplômé de l’Atelier Scénario de la Fémis, Harold Manning collabore avec Joseph Morder, Tsai Ming-Liang, Marie-Christine Questerbert, Jaco Van Dormael, Patrice Chéreau.
Il est traducteur de pièces classiques ou contemporaines, de longs métrages iraniens et de sitcoms américaines. Il a sous-titré plus d’une centaine de films, dont les récents In The Loop et A Single Man. Il travaille actuellement à l’adaptation du nouveau projet d’Ari Folman (Valse avec Bachir) et au sous-titrage du nouveau film de Mike Leigh, Another Year.
A Paris, il est le traducteur-interprète régulier de Jim Jarmusch, Ken Loach, David Lynch, Woody Allen, Mike Leigh, Francis Ford Coppola, Marianne Faithfull, Todd Solondz ou Wes Anderson.
Producteur aux Films de la Liberté, il prépare le tournage du nouveau film de Vladimir Léon, Les Anges de Port-Bou et un documentaire sur Pascale Dauman, figure de la production et de la distribution indépendantes françaises.
Catherine Mao est allocataire de recherche à l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Elle prépare actuellement une thèse de doctorat sur l’écriture de soi en bande dessinée sous la direction de Jean-Marie Schaeffer au sein du Centre de Recherche sur les Arts et le Langage. Elle a récemment publié « L’œil et l’oreille dans Faire semblant c’est mentir de Dominique Goblet : d’un faire-semblant sonore à une esthétique sonore » dans la publication en ligne Images re-vues. Ses recherches portent notamment sur la pratique du dessin et sur les caractéristiques articulatoires de la bande dessinée, intervenant sur les modalités du récit de soi.
Lire son article : La syncope ou le désir d’image dans la bande dessinée
Marianna Marino est doctorante en co-tutelle à l’Université de Palerme et à l’Université de Paris Ouest-Nanterre-La Défense. Sa thèse, intitulée « Jacques Garelli : la poésie comme paysage de l’être » est dirigée conjointement par Maria Teresa Russo et par Jean-Michel Maulpoix. Elle a notamment publié « La poesia come question du lieu. Su Les Donneurs de noms di Jacques Garelli », Condividere il Mediterraneo : studi e ricerche, a cura di Giuliana Costa Ragusa e Laura Auteri, Palermo, s.n., 2008, pp. 37-51 ; « Une création continue : expérience de la poésie dans l’œuvre de Jacques Garelli », Loxias, n° 22, mis en ligne le 15 septembre 2008, et « Présences/puissances de l’image », Acta Fabula, Mars-Avril 2007 (volume 8, numéro 2).
Lire son article : Les mots et leurs visages Sur L’invisible parole de Pierre Chappuis
Claude Reichler est professeur de littérature française et d’histoire de la culture à l’Université de Lausanne. Il a été professeur invité dans plusieurs universités aux Etats-Unis et en Europe. Il a été fellow du National Humanities Center (Etats-Unis) et de la Japanese Society for the Promotion of Science. Ses domaines de recherches sont la littérature française et l’histoire de la culture. Il s’est intéressé particulièrement aux récits de voyage : d’une part aux voyages en Amérique et aux descriptions des contacts entre voyageurs et indigènes ; d’autre part aux voyages en Suisse et dans les Alpes. C’est à partir de là qu’il s’est occupé de paysage. Il dirige aujourd’hui deux équipes de recherche dans ce domaine : « Le paysage : perceptions, représentations, théories » à l’Université de Lausanne ; et « Le bon air des Alpes » au Fonds national de la recherche (projet PNR 48).
Lire son article : Un envoûtement par l’image. Usage et critique de l’image dans le prisme de la Montagne magique
Anne Reverseau termine un doctorat de littérature française sur les rapports entre la poésie et la photographie à l’époque moderniste (dir. Michel Murat) à l’Université Paris-Sorbonne où elle a enseigné en tant que monitrice et ATER. Fondatrice du groupe de recherche « La poésie au carrefour des arts » (www.poesie-arts.com), elle a co-organisé le colloque « Poésie et médias au XXe siècle » (octobre 2008 – Paris IV et Celsa), publié des communications sur la poésie moderniste, le surréalisme et les pratiques photographiques dans Fabula, Ludions, Critique et est intervenue dans différents séminaires de Paris IV, Paris III, ENS, EHESS ainsi qu’aux USA. En 2009, elle a obtenu le prix de la Fondation des Treilles.
Lire son article : Breton, Man Ray et l’imaginaire photographique de la magie
Michèle Rosellini est maître de conférences en littérature française du XVIIe siècle à l'Ecole normale supérieure Lettres et sciences humaines de Lyon. Liste de ses publications.
Lire son article : Le Lion et la Souris : deux usages politiques de l’animal dans les Fables de La Fontaine
Andrea Schincariol (San Vito al Tagliamento, 1978). Doctorant à l’Università degli Studi di Udine (Italie), sous la direction d’Alessandra Ferraro et en co-tutelle de thèse avec l’Université Toulouse-Le Mirail, sous la direction de Guy Larroux et M. Philippe Ortel. Il travaille à une thèse intitulée Naturalisme et photographie. L’influence invisible du dispositif photographique sur le roman d’Emile Zola, Guy de Maupassant, Joris-Karl Huysmans et Henry Céard. Il collabore avec les revues Il bianco e il nero (publication attachée au département de langues étrangères de l’Università de Udine) où il a publié « Ridere a tempo. Appunti sul rapporto tra tempi verbali e ironia in alcuni racconti di Robert Caze » (n° 9, 2007) et « Double reflet. Présence(s) du double dans la nouvelle « Le Horla », de Guy de Maupassant » (n° 11, 2009); et Ponts/Ponti – Langues littératures civilisations des Pays francophones. Il figure parmi les collaborateurs de la section photographique (dirigée par Roberto Del Grande) des catalogues de Palinsesti (éditions 2008 e 2009), manifestation internationale d’art contemporain de San Vito al Tagliamento. Il a participé au colloque international Censures. Les violences du sens (Aix en Provence, Maison méditerranéenne des Sciences de l’Homme, 18-19-20 novembre 2008), avec une communication au sujet de la réception du dispositif photographique au sein de l’institution universitaire française. Récemment, il a présenté une communication intitulée « Nana 3D » en occasion de la journée d’étude Spazi, luoghi, paesaggi (Bologna, Dipartimento Lingue e Letterature Straniere Moderne, 23 settembre 2009). Il a enfin participé à la journée de Ricerche dottorali di Francesistica in Italia, organisée par la SUSLLF (Société universitaire d’études de langue et littérature française, Pescara, 27 novembre 2009) avec une communication sur « L’influenza ‘invisibile’ del dispositivo fotografico sul romanzo naturalista », en cours de publication sur la revue télématique Publif@rum de l’Università di Genova.
Lire son article : Malheur à ceux qui ratent une photographie. Ou Le Horla comme dispositif photographique
Emma Viguier est artiste plasticienne, docteur en arts plastiques et enseigne en tant qu’ATER au département arts plastiques-arts appliqués de l’Université de Toulouse II – Le Mirail ainsi qu’à l’IUFM de Toulouse. Elle a soutenu sa thèse en 2008 intitulée : Corps à Corps : corps, écriture, photographie. De la mise en signes à la mise en scène, l’exploration d’une pratique artistique ; thèse qui interrogeait la quête d’un primitivisme fantasmé du corps à travers son « artialisation » scripturo-picturale et sa mise en scène photographique. Ses recherches à la fois plastiques et théoriques se concentrent sur les pratiques du corps (rituelles et artistiques), sur l’anthropologie des écritures tégumentaires, sur l’archaïque contemporain. Elle travaille également sur la problématique du graphein ainsi que sur la calligraphie asémique.
Derniers articles : « Pratiques du corps et tentations de l’Origine », Figures de l’art, Revue d’études esthétiques, n°18, « L’archaïque contemporain », à paraître ; « Corps-dissident, Corps-défendant : le tatouage, une "peau de résistance" », Amnis, Revue internationale de civilisation contemporaine, n°9, « Faire face : pratiques de résistance dans les sociétés contemporaines Europe-Amérique », 2009, AMNIS, Revue de civilisation contemporaine Europes/Amériques.
Lire son article : Henri Michaux : à la recherche du « texte primordial »
Myriam White-Le Goff est Maître de Conférences en la langue et la littérature médiévales à l’université d’Artois à Arras. Sa thèse Changer le monde, réécritures d’une légende (Paris, Champion, 2006) portait sur la légende du purgatoire de saint Patrick. Elle est également l’auteur d’un Envoûtante Mélusine (Paris, Klincksieck, 2008) et de nombreux articles qui traitent, entre autres, des points de rencontre entre réel et imaginaire ou de la question du merveilleux. Elle a co-dirigé différents colloques et volumes d’actes. Elle s’intéresse aussi à la réception du Moyen Age jusqu’à nos jours, notamment aux travers des activités de l’association Modernités Médiévales.
Lire son article : De quelques marges de manuscrits arrageois : le texte au défi de l’image
Marie-Jeanne Zenetti enseigne à l’Université de Paris 8 - Saint Denis. Elle poursuit une thèse de doctorat en littérature comparée et travaille notamment sur la notion d’enregistrement en littérature, ainsi que sur les rapports entre littérature et photographie.
Lire son article : Ecrire avec et contre l’image, dispositifs de l’enquête mémorielle dans Récits d’Ellis Island, histoires d’errance et d’espoir de Georges Perec et Robert Bober et Les Emigrants de W. G. Sebald
Cahier d’artiste : Julie Sorin est née à Nouméa en 1978. Elle vit et travaille à Saint-Etienne et à Nouméa. Elle est diplômée de L’Ecole régionale des Beaux-Arts de Valence et de l’Ecole nationale des Beaux-Arts de Lyon. Depuis 2001, elle expose à Valence, Villeurbanne, Lyon, Tourcoing, Copenhague.
Voir : Gone With The Wind