[20] Jean-Claude Schmitt a consacré une très riche étude au Volto Santo et à sa notoriété médiévale : « Cendrillon crucifiée. A propos du Volto Santo de Lucques (XIIIe-XVe siècle) », dans Le Corps des images. Essais sur la culture visuelle au Moyen Age, Paris, Gallimard, 2002, pp. 217-271, et S. Martinelli Tempesta, L'Immagine del Volto Santo di Lucca : il successo europeo di un'iconografia medievale, Pisa, Edizioni ETS, 2016. Il a exposé l’histoire de ce crucifix, a suivi sa trace dans les différentes versions de la légende qu’a suscitées cet objet, dans les récits de miracles, dont le poème intitulé « Le Saint Vou de Luques », et ce jusque dans la première Continuation Perceval où la translatio du Graal et celle du Volto Santo sont évoquées parallèlement.
[21] J.-C. Schmitt, « Récits et images de rêves au Moyen Age », dans Ethnologie française, 2003/4 (Vol. 33), pp. 553-563, cit. p. 555 (en ligne. Consulté le 23 janvier 2023).
[22] M. Demaules, La corne et l’ivoire, Op. cit., p. 222.
[23] Cristal et Clarie, v. 8657-82.
[24] Benoît de Sainte-Maure, Roman de Troie, éd. L. Constans, 6 vol., Firmin Didot, S.A.T.F., Paris, 1904-1912, vol. II, v. 14 657-14 939.
[25] Je reprends ce terme à Gérard Genette, qui l’a d’abord établi pour caractériser un discours « traité comme un événement », et dont le contenu n’est pas rapporté (Figures III, Paris, Le Seuil, 1972, pp. 190-192).
[26] Sur ce sujet, on consultera avec intérêt la belle étude de Romaine Wolf-Bonvin, Textus. De la tradition latine à l’esthétique du roman médiéval. Le Bel Inconnu, Amadas et Ydoine, Paris, Champion, 1998, et Textes et textiles du Moyen Age à nos jours, textes réunis par O. Blanc, Lyon, Editions de l’ENS, 2008.
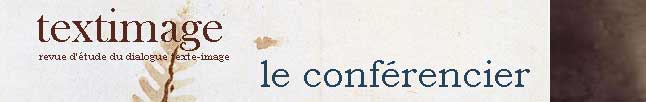
La lettre et l’image : (dé)faire image
dans Cristal et Clarie
- Lydie Louison
_______________________________
Loin d’apaiser son cœur, contempler enfin Clarie en Abilant finit par anéantir le héros : l’image mentale devient envahissante, obsédante, et le prive de tout repos. Or les traits de cette projection qui rythme la diégèse ne sont dévoilés au lecteur que sur la fin du roman. Cristal dépérit d’avoir été éconduit par Clarie et s’abandonne à une rêverie éveillée. Le souvenir de la princesse s’impose une fois de plus à son esprit. A la faveur de ce fantasme, Clarie est enfin décrite dans une construction qui répond à l’ouverture du récit. Du rêve endormi à la vision éveillée, les images mentales, phantasmae, dessinent l’objet du désir enfin décrit et embrasent le chevalier. L’image donnée à voir au lecteur déclenche finalement une décision, une action – déclarer sa flamme – et enclenche le dénouement. L’efficacité du fantasme ainsi représenté prend place au sein d’un schéma narratif réhabilitant un désir puissant, tantôt inhibant, tantôt moteur, qui tyrannise le chevalier jusqu’à son assouvissement.
Au sein de cette trame narrative modalisée par la présence permanente d’une image mentale dissimulée au lecteur, mais omniprésente à l’esprit du héros, émergent d’autres images, ponctuelles. L’une d’entre elles attire l’attention tant elle est inattendue.
A peine levé, à l’aube d’une reverdie escamotée, Cristal se rend en effet à l’église pour prier. S’adressant au saint Volt, il relate son rêve et demande à Dieu de le réaliser. La première image concrète évoquée dans le roman est donc celle d’une icône du Christ que le romancier se contente de nommer, le saint Volt. Le dispositif est réduit à son plus simple appareil. Le soin de faire image est délégué au lecteur. Aucun indice textuel ne permet de préciser s’il s’agit d’une icône représentant le visage du Christ, sens le plus large de saint Volt, ou d’une reproduction du Volto Santo, croix qui aurait été sculptée par Nicodème et dont la notoriété au début du XIIIe siècle n’est plus à démontrer [20]. Quel que fût le référent de cette expression, rassembler en un même lieu et une même intention ces deux images si opposées, le saint Volt et l’objet du rêve érotique, dans le contexte d’une prière ardente, ménage un contraste saisissant qui vient ébranler les cadres même du rêve prophétique hérité de la culture judéo-chrétienne, dont Jean-Claude Schmitt a rappelé les contours : « Le rêve donne accès immédiatement – sans la médiation d’un autre, d’un clerc, d’un directeur spirituel, d’un confesseur, à la source divine de la vérité, où se trouve le sens du destin de chacun, placé sous le regard de Dieu. C’est à travers cet échange des regards, permis par le rêve, que le sujet se découvre lui-même, mais toujours dans une relation essentielle au divin. Sa subjectivité n’est pas conçue comme la revendication de la liberté de son ego. Elle est aveu de sujétion à l’égard du Créateur, dont la volonté se montre et se fait entendre dans l’immédiateté des images et paroles oniriques » [21]. Or si le héros découvre en effet dans ce rêve le sens de son destin, s’il se tourne à son réveil vers « la source divine de la vérité », il prie cependant pour obtenir de la toute-puissance divine qu’elle accomplisse son rêve, son désir, et fasse sa volonté. Point de « sujétion à l’égard du Créateur », mais bien revendication d’un ego ! Enfin, comme l’écrit Mireille Demaules, « le songe érotique appelle trop expressément les plaisirs du corps pour que l’on puisse discerner une quelconque volonté divine dans leur apparition » [22]. L’inversion du Notre Père malthusien vient corroborer un traitement burlesque initié par la collision de ces images sacrées et profanes, dont les objets originellement sublimes – aspiration amoureuse, prière – ne parviennent pas à élever un héros ancré dans son désir charnel. Ainsi sollicité comme « pôle imageant du texte », le lecteur est plus puissamment frappé par l’inversion des mouvements courtois et spirituel ascendants attendus, tandis que Cristal prie pour que cette chimère trouve son modèle, devienne véritablement image, représentation d’un personnage existant par ailleurs au sein de la diégèse. La quête du protagoniste s’avère quête profane de l’original, de l’être idéal dont son esprit a modelé l’image.
Si l’on excepte les sculptures des montants du lit de Clarie [23], inspirées possiblement de la chambre de Beauté du Roman de Troie [24], pièce où s’animent de merveilleux automates trônant sur des piliers et conférant à l’ekphrasis une belle épaisseur, les autres images convoquées dans Cristal et Clarie relèvent de la broderie. Encore une fois, le romancier refuse de faire image, de décrire ces ouvrages et de les donner à voir précisément. Les images sont narrativisées [25]. Serait-ce le signe d’une indifférence au descriptif, d’un imaginaire peu visuel ou d’un jeu littéraire ? La dernière hypothèse nous semble plus plausible dans la mesure où la fée Jupiter est représentée dans ses travaux d’aiguille, brodant tous les animaux de la création. Ce détail gratuit, dépourvu de fonction narrative, pourrait bien faire un clin d’œil parodique à la Genèse, le Créateur étant remplacé par une fée qui porte le nom masculin d’un dieu païen, le choix onomastique opérant un double renversement de genre et de registre. Le texte, dénotatif, se contente d’évoquer succinctement un faire image concret, associe le temps d’un vers la broderie et la Création. S’il fait allusion au topos du texte/textile [26], qui a traversé les siècles depuis l’Antiquité et s’est déployé au Moyen Age, c’est pour mieux le bouder. Le romancier présente ainsi en possible arrière-plan la portée métalittéraire de la broderie, et se refuse à filer la métaphore de la même manière qu’il convoque par la suite bon nombre de motifs narratifs archétypaux qu’il s’abstient de déployer. La scène de genre esquissée, ainsi privée de sa profondeur, attire le regard du lecteur sur la part manquante, le dispositif symbolique traditionnel non actualisé, la métaphore amputée. Elle se fait emblème d’une écriture où faire image consiste précisément à faire signe, à désigner un processus poétique mis à distance, mais aussi des jeux textuels, intertextuels et métatextuels.