[42] Ibid.
[43] Ibid., p. 853.
[44] Jean de La Fontaine, Fables choisies, éd. Jean-Pierre Chauveau, texte établi par Jean-Pierre Collinet, Paris, Gallimard, « Folio classique », 1999.
[45] Ibid., p. 11.
[46] « Une image où – ô paradoxe, quand on sait que la tortue est célèbre pour sa lenteur, et le lièvre pour sa rapidité à la course ! – l’on voit représentée une tortue qui, touchant au but, va être couronnée par un arbitre (un singe juché sur une pierre ?), tandis qu’un lièvre, avec ses grandes pattes, s’évertue, visiblement en vain, à rattraper sa concurrente. Paradoxe, disions-nous, et qui prête d’emblée à réflexion » (Ibid., pp. 11-12).
[47] J’aurai l’occasion de revenir, de ce point de vue, sur le passage de l’édition Collinet de la Pléiade à l’édition « Folio classique » intégrale.
[48] Jean de La Fontaine, Fables. Livres I-VI, éd. Roger Guichemerre, Paris, Marcel Didier, « Les Classiques de la Civilisation française », 1964.
[49] « Le montage éditorial dégage un premier temps de latence et de seuil qui autonomise, fût-ce très provisoirement, l’image et le regard que le livre propose de porter sur elle. L’illustrateur a profité de cette suspension du processus interprétatif (le lieu de la fable s’accordant un moment de regard), pour laisser libre cours à son invention. Il s’est lancé le défi, paradoxal eu égard à son rôle et même à ses obligations, d’écarter le lisible au profit du visible ou, disons, de faire jouer le visible avant le lisible, dans le but de produire un plaisir d’image préparatoire à la lecture mais qui l’excède. Tout en emmagasinant le sens, boîte noire de significations, de connotations, de suggestions que le texte va plus ou moins ensuite actualiser, l’image se met en réserve de la lecture : elle prend le temps d’être elle-même, d’être pensive, se dotant de la possibilité, en se confrontant à la logique de l’écriture, de développer ses propriétés au-delà de sa fonction attendue » (Olivier Leplatre, « Pages, images, paysages (François Chauveau, Fables choisies mises en vers par M. de La Fontaine) », art. cit., p. 695).
[50] Les Fables de La Fontaine. Livres I à III (Extraits), éd. Gaston Mauger, Paris, Hachette, 1938.

Des textes sans images ? Statuts et usages
des gravures de Chauveau dans les éditions
des Fables de La Fontaine (1900-1995)
- Maxime Cartron
_______________________________
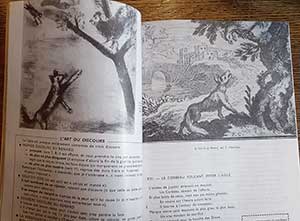
Fig. 3. J. de La Fontaine, Fables. 1964 

Fig. 4. Les Fables de La Fontaine, 1938 

Si de prime abord les éditeurs semblent s’inscrire à la suite du courant historiciste et iconophile représenté par Plan (1930), on s’aperçoit rapidement que ces intentions affichées relèvent d’une optique exclusivement textualiste, qui se double d’un bricolage pour le moins singulier :
Pour les Fables, on a eu recours aux diverses éditions, les originales et les suivantes, parues du vivant de La Fontaine, presque toutes chez Denys Thierry ou chez Claude Barbin (…) : éditions de 1668 (1ère et 2e parties) ; Recueil de poésies chrétiennes et diverses de 1671 ; Fables nouvelles de la même date ; édition de 1678-1679 (pour les quatre premières parties, toutes les fables antérieures s’y trouvant reproduites) ; Ouvrages de prose et de poésie de 1685 ; édition de 1692 (corrigeant celle de 1678-1679) ; édition de 1694 (5e et dernière partie) ; – sans compter les éditions séparées d’un certain nombre de fables ; les copies manuscrites (dont on n’a d’ailleurs usé qu’avec prudence) ; les Œuvres posthumes de 1696… [42].
La révérence quasi religieuse à l’auctorialité lafontainienne a certes disparu – doit-on rappeler qu’en 1953 Jean Rousset avait fait paraître La Littérature de l’âge baroque en France, qui rompait avec le textualisme biographisant de la critique classiciste et promouvait le dialogue des arts dans un esprit comparatiste ? –, mais pourtant, on ne lira pas une ligne, dans cette édition, sur les illustrations, hormis, bien entendu, dans la note bibliographique : « gravures de Chauveau (une figure pour chaque fable : dessinée par François Chauveau ou par l’un de ses enfants, gravée par lui-même) » [43]. Ainsi, « l’innovation » de Plan en 1930, qui par la réédition à l’identique tirait les gravures de Chauveau du purgatoire critique dans lequel elles étaient plongées, n’est pas réellement suivie ; les images sont toujours matériellement absentes. La bizarrerie de ce dispositif – présence dans le discours, absence dans les faits – est plus frappante encore chez Jean-Pierre Chauveau, qui en 1999 propose un choix de Fables pour la collection « Folio classique » [44], son édition de référence étant celle de la Pléiade publiée quelques années auparavant par Collinet avec les gravures de François Chauveau. J.-P. Chauveau signale que « chaque fable est précédée d’une "vignette", en l’occurrence une gravure, destinée à parler aux yeux, avant que les mots ne prennent le relais » [45] et cite pour exemple « Le Lièvre et la Tortue », allant jusqu’à décrire le dispositif iconotextuel s’instaurant au sein du livre. Et pourtant, on ne verra pas la gravure de François Chauveau. D’ailleurs le nom de ce dernier n’est pas mentionné alors même que J.-P. Chauveau insiste sur le travail herméneutique qu’accomplit l’image [46]. Par la suite, les images disparaissent complètement du livre, y compris dans la notice éditoriale et le dossier. Il est par conséquent un peu court d’invoquer des impératifs commerciaux pour justifier cette éviction. Certes, il est plus que probable que Gallimard ait refusé d’investir dans des reproductions graphiques pour une simple anthologie, mais cette explication ne suffit pas à rendre compte de cette présence affichée puis effacée des gravures de Chauveau. Si Gallimard n’a pas reproduit les illustrations comme dans la Pléiade, c’est sans doute aussi parce que J.-P. Chauveau n’a rien fait pour [47]. En effet, le « paradoxe » de l’image du « Lièvre et la Tortue », qui « prête d’emblée à réflexion » n’est en réalité qu’un prétexte pour lancer l’analyse de la poétique lafontainienne : l’image demeure un supplément au service du texte, l’écriture critique rejouant cette filiation ancillaire.
On retrouve un fonctionnement identique dans son principe, mais inversé chez Roger Guichemerre [48] : tandis que J.-P. Chauveau évoque les images puis les escamote, Guichemerre les évince totalement de son propos tout en en insérant plusieurs, empruntées à diverses époques et à diverses traditions iconographiques – dont cinq de Chauveau, ainsi que la page de titre de l’édition de 1668 – et en proposant une table des illustrations immédiatement après la page de titre de son édition. Les images sont présentes, elles imposent leur évidence, mais elles n’ont malgré tout pas droit de cité dans le discours critique. Il faut du reste noter que « Le Jardinier et son Seigneur » n’illustre pas la fable qu’elle est censée illustrer, et est placée pour ainsi dire au hasard dans le volume, alors que les autres gravures de Chauveau présentées par Guichemerre concordent toutes avec la fable pour laquelle elles ont été créées. Cependant, on remarque qu’elles sont toutes positionnées à la suite du texte, et non avant lui comme dans l’édition originale [49] : dans « La Mort et le Bûcheron », l’image est seconde, elle vient après le texte et même après le début de la fable intitulée « Le Renard et la Cigogne ». Pareillement, la gravure de Chauveau pour « Le Chartier embourbé » passe après le commentaire de l’éditeur. Mais c’est avec « Le Loup et l’Agneau » que le statut subalterne assigné à l’image est le plus manifeste ; non seulement elle est précédée par l’hypotexte ésopique, mais encore par le commentaire : l’image est dernière, elle n’est que pure illustration, c’est-à-dire ornement détachable et déplaçable à loisir. De ce point de vue, la mise en regard des gravures de Chauveau et Chagall pour « Le Coq et le Renard » est des plus significatives (fig. 3) : si l’on aurait pu envisager un décalage herméneutique majeur dans ce diptyque, l’image de Chagall étant exposée comme une manifeste reprise de celle de son prédécesseur, son positionnement avant, dans le sens de lecture, celle de l’illustrateur de l’édition de 1668 témoigne plutôt, en réalité, d’une simple impression de parenté ressentie par l’éditeur, sans que la pensée analogique soit poussée plus loin.
De manière similaire, dans son édition dite « pédagogique » de 1938 [50], Gaston Mauger rassemble une documentation iconographique relativement hétéroclite : pas moins de quatre portraits de La Fontaine (la miniature du Louvre, De Troy, Rigaud et Largillière), ainsi que des photographies de Château-Thierry et de sa maison voisinent avec des dessins de Rackham pour l’édition anglaise Heinemann, une gravure tirée du recueil de Nevelet, une autre d’Oudry ou encore de Grandville et de Doré, ceci sans compter Moreau le Jeune, une miniature chinoise (fig. 4) et une miniature indienne (fig. 5). Dans ce contexte pour le moins divers, Chauveau, présent tout de même à travers trois gravures, est comme noyé dans un flot d’images organisé sommairement à des fins avant tout didactiques, comme en témoignent les photographies et dessins de divers animaux, qui sertissent le livre et ont visiblement pour fonction d’initier l’enfant aux représentations de la nature et du vivant.