[32] G. P. Marchal, « Jalons pour une histoire de l’iconoclasme au Moyen Age », Annales, Histoire, Sciences Sociales 50, 1995, pp. 1135–1156 (en ligne. Consulté le 6 novembre 2022).
[33] Wider die himmlischen Propheten (WA 18, 67, 9-13): « Das bilde stuermen habe ich also an gryffen, das ich sie zu erst durchs wort Gottes aus den hertzen rysse und unwerd und veracht machte (…), eher denn D. Carlstad von bildestuermen trewmete. Denn wo sie aus dem hertzen sind, thun sie fur den augen keynen schaden ».
[34] Wider die himmlischen Propheten, (WA 18, 75, 7-10): « Was kan ich dazu? der ich als eyn Christen keyn gewalt habe auff erden, Setze eynen prediger hin, der die leutte ab weyse oder schaffe, das mit oerdentlcher weyse werde abgethan, nicht mit schwermen und stuermen ».
[35] Predigten über das 2. Buch Mose, 24 septembre 1525 (WA 16, 440,19–24) : « Nu mus man solchen bildern nicht arm und beyn brechen, sie zu schlagen, (…) denn das hertz bliebe gleich wol unrein, sondern man mus das volck mit dem wort dahyn bringen, das sie kein zuversicht haben zun bildern (…). Denn das hertz mus wissen, das ihm nichts (…) hilfft denn Gottes gnade und gueete allein ».
[36] Luther, Wider die himmlischen Propheten (WA 18, 67-68).
[37] Grégoire le Grand, Registrum Epistolarum, XI, 13, pp. 875-876.
[38] Théodulf, Opus Caroli Regis contra Synodum (Libri Carolini), Miscellanea Germaniae Historica II, 23 (Concilia, 2, supplementum 1), éd. A. Freeman/P. Meyvart, Hannover, Hahnsche Buchhandlung, 1998, p. 278 ; sur la via media, voir p. 102.
[39] Voir T. Kaufmann, « Die Bilderfrage im frühneuzeitlichen Luthertum », dans Macht und Ohnmacht der Bilder. Reformatorischer Bildersturm im Kontext der europäischen Geschichte, dirigé par P. Bickle, A. Hohlenstein, H. R. Schmidt et F.-J. Sladeczek, München, Oldenbourg, 2002, pp. 407-454, surtout pp. 407-410.
[40] Voir Hans Belting qui parle d’un « Geburt der Moderne aus dem Geist der Religion » (Op. cit., p. 510) ; « Die Kunst wird entweder zur Religion zugelassen oder von ihr ausgeschlossen, aber sie ist kein eigentlich religiöses Phänomen mehr » (p. 511).
[41] S. Michalski, Reformation and the Visual Arts. The protestant image question in Western and Eastern Europe, London/New York, Routledge, 1993.
[42] Voir O. Boulnois, « La face et le dos de Dieu. Théologie et économie chez Paul, Augustin et Luther », dans Dieu d’Abraham, Dieu des philosophes. Révélation et rationalité, dirigé par Olivier Boulnois, Paris, Vrin, à paraître.
[43] E. Jüngel, « “Auch das Schöne Muss Sterben” - Schönheit im Licht der Wahrheit », Zeitschrift für Theologie und Kirche, vol. 81, n° 1, 1984, pp. 106-126.
[44] Predigten des Jahres 1538, 20 avril, WA 46, 308, 2-8 : « [Q]uia kuennens sonst nicht begreiffen, ideo etc. Sic die geistlich sachen in solche bildnis fassen. Deus non ist menschlich bild, ut Daniel malet: Ein schon, alt man, hat schne weis har, bard, rotae etc. et strale giengen etc. non habet nec barbam, har etc. et tamen sic pingit deum verum in imagine viri antiqui. Sic mus man unserm herr Gott ein bild malen (…). Ipse met se dedit in humanitatem, qui unbegreiflich gewest. Christus dicit : "qui me", ‘ et patrem vidit’ &c. »
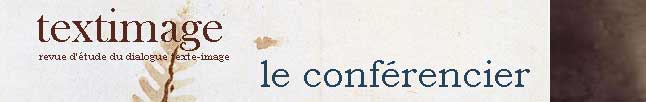
Les usages de l’image :
lire, méditer, vénérer
- Olivier Boulnois
_______________________________
Contre l’iconoclasme
Comme nous le savons, Luther a été horrifié par l’explosion d’iconoclasme provoquée par Carlstadt à Wittenberg en 1521-1522. La violence iconoclaste n’était en rien nouvelle : nous avons des témoignages de telles scènes au cours du Moyen Age, motivées par des raisons sociales ou politiques [32]. Ce qui était nouveau ici, c’était la motivation religieuse des iconoclastes : les images étaient détruites afin de rendre impossible la vénération ; il s’agissait d’une performance auto-réfutatrice, démontrant que l’image n’avait aucun pouvoir religieux. Dès 1522, Luther réagit contre les excès iconoclastes de Carlstadt. Il ne faut pas adorer les images, mais en même temps, il ne faut pas les détruire.
Tout d’abord, l’iconoclasme s’avilit jusqu’à la violence, ce qui n’est pas une bonne façon d’arracher les racines de la superstition. La racine, c’est le cœur de l’homme, et seule la Parole de Dieu peut y pénétrer assez profondément. « J’ai attaqué la destruction des images, pour les arracher d’abord du cœur par la parole de Dieu, pour les rendre sans valeur et méprisables (...) sans recourir à la destruction des images rêvée par Carlstadt. Car lorsqu’elles ont disparu du cœur, elles ne nuisent pas à l’œil » [33]. « Je me comporte comme un prédicateur qui détourne les gens [des images] et j’essaie de les faire disparaître de manière ordonnée, et non par le fanatisme et la violence » [34]. Une idée semblable est exprimée la même année, dans son commentaire sur l’Exode : « Nous ne devons pas briser les bras et les jambes de ces images (...) car nos cœurs resteraient malgré cela impurs, mais nous devons, par la parole, amener le peuple à ne plus s’y fier. (...) Car le cœur doit comprendre que rien ne l’aidera (...) en dehors de la grâce et de la bonté de Dieu seul » [35].
Plus profondément, Luther comprend le problème selon sa propre dialectique : nous ne trouvons le salut que dans par grâce de Dieu, et non par nos œuvres. Mais la destruction des images est elle-même une œuvre de l’homme. Mettre sa confiance dans l’iconoclasme, c’est encore une manière de s’éloigner de la grâce de Dieu. L’iconoclasme est donc encore une idolâtrie : c’est une idolâtrie de l’action humaine, des prétendues bonnes actions : « Les iconoclastes se fondent sur la contrainte de la Loi, et sur l’erreur de croire qu’en détruisant simplement les images, ils gagnent l’approbation de Dieu. En suivant ces lois, ils suppriment les images extérieures tout en remplissant leurs cœurs d’idoles, (...) d’une fausse justification et d’une gloire [obtenue] par les œuvres » [36]. Pire que l’idole visible est l’idole conceptuelle – et l’iconoclasme n’est rien d’autre qu’une idole conceptuelle.
La position de Luther a donc beaucoup de points communs avec celle de Grégoire le Grand.
1. Les images sont des histoires et des aide-mémoire ;
2. Aucune vénération n’est légitime ;
3. Aucune destruction n’est légitime.
Il suit la position de Grégoire, qui caractérise, fondamentalement, le courant principal de la pensée latine : « Le fait que tu aies interdit la vénération d’un tableau, nous l’avons approuvé, mais que tu l’aies brisé, nous le blâmons » [37].
Cette tendance était appelée par la cour de Charlemagne la via media de l’occident latin : ni vénération, ni destruction. « Adorer les images ou les briser va contre les commandements du bienheureux Grégoire (...). Ce mépris envers les adorateurs d’une part, et envers les briseurs de l’autre, en fait un allié pour l’Eglise de notre pays [l’Empire carolingien] » [38]. A son tour, Luther reste précisément à égale distance entre l’idolâtrie et l’iconoclasme. Les images sont considérées comme des adiaphora (choses indifférentes), comme n’étant ni bonnes ni mauvaises en elles-mêmes [39]. Du coup, l’image d’art n’est pas comprise comme un phénomène religieux en soi [40]. La relation personnelle aux images est donc libre. Mais, comme l’a fait remarquer un historien, cette position apparemment neutre, ainsi que l’appel à une notion de liberté, est déjà une prise de position : elle « établit la position théologique de l’art religieux » [41].
Par conséquent, même lorsqu’il répète l’ancienne position de Grégoire dans un nouveau contexte, Luther ajoute de nouveaux éléments à la tradition scolastique.
Dieu en vieillard
Luther insiste sur l’idée que la révélation de Dieu est paradoxale. Il met l’accent sur un verset d’Isaïe : celui-ci « n’avait ni apparence ni beauté pour attirer nos regards » (Isaïe 53,2). Cela signifie que la transcendance suprême se manifeste à travers l’immanence la plus vile, à travers l’incarnation, la douleur et la mort. Même s’il existe une théologie de la gloire (une connaissance rationnelle de Dieu), la théologie de la croix (l’économie du salut) est le seul accès à Dieu qui sauve [42]. C’est ainsi que la manifestation de Dieu prend la forme de son propre contraire. Comme l’a souligné Eberhard Jüngel (citant Schiller), « même la beauté doit mourir » [43].
Par conséquent, d’une certaine manière, nous pouvons dire que toutes nos images de Dieu sont négatives. Nous savons que l’image le dépeint tel qu’il n’est pas. Mais puisqu’aucune image n’est adéquate, aucun canon ne peut limiter la liberté des artistes. Ainsi, il en découle que nous n’avons pas le droit de distinguer entre les bonnes images, ou les images correctes, et les mauvaises, ou les images incorrectes. Aucune image n’est adéquate à Dieu, mais toutes sont utiles. La proclamation de l’Evangile reste associée à l’image, et Luther n’hésite pas à soutenir sa prédication avec des images de toutes sortes, peintures, Bibles illustrées, tracts, etc. Il n’a d’ailleurs aucun scrupule à représenter Dieu le Père sous les traits d’un vieillard. Il en donne même une justification, ce qui est tout à fait nouveau : « Parce que nous ne pouvons les concevoir, il est nécessaire de peindre les réalités spirituelles par de telles images. Dieu n’est pas l’image humaine dans laquelle Daniel le dépeint : un beau vieillard, aux cheveux de neige, avec une barbe, des rayons et un trône. Dieu n’a ni cheveux ni barbe, il n’est d’aucune figure humaine, et pourtant Daniel le dépeint ainsi, le vrai Dieu, comme un vieillard. C’est ainsi que nous devons nous faire une image de Notre Seigneur. (...) Car celui qui est incompréhensible s’est donné à nous sous une forme humaine. Le Christ a dit : "Celui qui me voit, voit aussi le Père" [Jean 14, 9] » [44]. Le paradoxe, c’est qu’il nous faut peindre Dieu comme il n’est pas, comme un vieillard.