[24] Sarah Sze est une sculptrice et artiste plasticienne américaine, née en 1969 à Boston (USA). Entre peinture, architecture et installation, sa pratique sculpturale joue de nos rapports avec le temps et l’espace, de nos relations avec les objets (les matériaux qu’elle emploie sont souvent empruntés à la vie de tous les jours) en mettant en scène, caricaturant ou poussant à l’extrême notre tendance à organiser nos rapports au monde. Elle compose ainsi des représentations immersives très fortes en ce qu’elles donnent toujours à sentir une présence / absence du geste ; et en ce qu’elles ouvrent à l’absurde et à la poésie nos systèmes de relation à l’espace et au temps.
[25] G. Deleuze, Le Pli. Leibniz et le baroque, Paris, Minuit, 1988.
[26] Ibid., p. 5.
[27] Ibid., p. 49.
[28] La gamme de matériaux disponibles est dépendante d’une économie de marché mondialisée et standardisée, tout en étant encadrée par des normes et des prescriptions de mise en œuvre (nationales ou européennes). En France, il existe un ensemble de textes législatifs et techniques prescrivant les « règles de l’art » de construire, mis à jour en permanence sous l’égide de différentes institutions de validation et de contrôle. Ce sont notamment le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (CSTB) et la Commission Chargée de Formuler des Avis Techniques (CCFAT) qui élaborent des Documents Techniques Unifiés (DTU) pour chaque produit. Ces DTU regroupent, entre autres, le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) qui définit la mise en œuvre ; le Cahier des critères Généraux de choix des Matériaux (CGM) qui définit les matériaux utilisables ; le Cahier des Clauses administratives Spéciales (CCS) qui définit les relations entre entreprises et maître d’ouvrage.
[29] Modélisation et conception automatisée de bâtiments ou d’infrastructures. Les process BIM associent une maquette numérique à la modélisation de « toutes » les données (coûts, délais, maintenance, impact écologique etc.) nécessaires à la conception, la construction et l’exploitation des bâtiments. Cette maquette numérique sert à la fois de prototype idéal et d’archive.
[30] Au fur et à mesure que l’outil de conception a été adapté à la production (et inversement), s’est installé un mythe de la sur-complexité du design des infrastructures, justifiant le rôle de la CAO ou du BIM et entraînant de fait l’utilisation de matériaux standardisés. Les conséquences sur les métiers de la construction sont connues, avec une explosion des métiers non spécialisés et mal rémunérés (les manœuvres remplacent les ouvriers qualifiés), et une normalisation de l’ensemble des gestes, de la conception à la réalisation. L’architecture contemporaine, en partie déterminée par ces logiques de rentabilité immobilière, exalte ainsi optimisation et prouesse technique (dont le symbole inaltérable reste la tour) comme des fins en soi. Le pouvoir est signifié par des symboles qui ne sont plus associés à un style architectural, mais à la généralisation de l’optimisation comme esthétique.
[31] Le philosophe José Ortega y Gasset commentant l’intervention de Martin Heidegger « Bâtir, Habiter, Penser », au Colloque de Darmstadt en 1951, dans « Du style en architecture – Autour du colloque de Darmstadt 1951 », Le Mythe de l’homme derrière la technique, trad. F. Bourgeois, C. Mélot et M. Rollot, Paris, Allia, 2016, p. 28.
[32] L’architecte a interdiction formelle de mettre la main à la pâte (codes de déontologie de l’Ordre des architectes et assurance MAF sont d’accord là-dessus).

Pratiques d’assemblages.
Texte – architecture – sculpture.
La matière comme relation
- Claire Mélot
_______________________________

Fig. 2. S. Sze, Seamless, 1999 
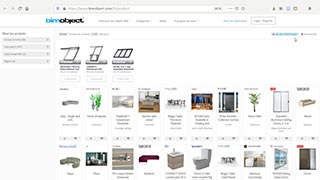
Pratiques d’assemblage
Dans les exemples qui suivent on s’intéresse en particulier à des processus de composition proches de la sculpture qui privilégient des pratiques d’assemblage telles que l’amas, l’empilement, l’emboîtement, la ligature, l’agglomération, la répétition, la suspension, le collage, etc. Les processus, abordés comme mise en œuvre et mise en relation de la matière, donnent à voir des gestes en train de faire et d’être faits.
Dans le travail de Sarah Sze [24], artiste plasticienne américaine, la sculpture se fait installation au sens propre, elle rend visible un ensemble de gestes, installés, dans l’espace (fig. 2). Ses sculptures fabriquent des mondes de relations, à partir d’objets et de matières existantes. Cette inscription de mouvements dans l’espace suggère une présence et fait de l’occupation du lieu, une habitation. Les sculptures de Sarah Sze jouent avec l’espace dans lequel elle s’installe, et mettent à l’épreuve nos représentations de l’espace. En jouant sur les échelles, la prolifération, l’accumulation et le rhizomique, ces installations mettent en scène les contradictions que nous posent les situations d’infinis : dans les systèmes qu’elle déploie, la centralité n’existe plus (elle a lieu partout, mais pas nulle part, en étant pourtant toujours située), ou au contraire tout point de l’espace peut faire coïncider des centralités équivalentes. Le résultat de ces assemblages ne se lit pas par volumes, mais par accroches de points de l’espace, qui (r)assemblent et (re)lient, travaillent des tensions avec l’espace. Tous les points de l’espace sont devenus valables, de façon similaire à la « courbure incessante sur soi-même » de la ligne leibnizienne [25], à l’infini.
Pour Gilles Deleuze, le pli est l’image d’une limite et d’une liaison à la fois, qui répond à une situation particulière, celle que pose la question de la représentation de l’infini au XVIIe siècle. Le pli est, selon Deleuze, une réponse conceptuelle élaborée par Leibniz pour faire face à la tension qu’amène l’introduction et la « prolifération à l’infini », jusque dans les « replis de la matière » (et jusque dans les « plis de l’âme »), conséquence de la perte des centralités [26]. Si le centre n’est plus « nulle part » (et le divin non plus) mais virtuellement et effectivement partout, l’espace change de propriétés et sa représentation change d’images. L’infini remplace l’étendue ou le lointain.
C’est que le pli n’affecte pas seulement toutes les matières, qui deviennent ainsi matières d’expression, suivant des échelles, des vitesses et des vecteurs différents (les montagnes et les eaux, les papiers, les étoffes, les tissus vivants, le cerveau), mais il détermine et fait apparaître la Forme, il en fait une forme d'expression, Gestaltung, l’élément génétique ou la ligne infinie d’inflexion, la courbe à variable unique [27].
Cette transformation des représentations n’implique pas qu’une « prise de conscience » d’un changement. Elle déplace les représentations vers d’autres modèles physiques, métaphoriques et symboliques. Se représenter (imaginer, produire des images) la matière comme débordant de sa forme nécessite un réarrangement conceptuel qui engage l’ensemble des autres représentations mais aussi la sensibilité (et chez Leibniz, la foi) : et en effet, comment apprivoiser et réorganiser tout un système de représentations ? Comment dès lors s’orienter et se situer dans l’infini en adoptant l’image d’un centre qui ne serait plus le point d’équilibre d’un ensemble, mais qui fait de tous les points de l’espace des centralités potentielles, et qui donc sont en relations les unes avec les autres ? Comment rendre l’infini habitable ?
Depuis Leibniz, l’infini, l’hétérogène et le multiple nous sont-ils par la suite devenus plus familiers, par habitude ? Sommes-nous devenus – monades leibniziennes ou lignes de fuites deleuziennes – transposables en tout point de l’espace ? Quelles conséquences pour nos représentations de l’espace-temps, de la matière, des corps ? Ces questions sont loin d’être abstraites, tant la colonisation des lointains semble toujours et encore à l’ordre du jour (des terrae incognitae dans l’espace stellaire existent bel et bien pour certains). Il semblerait même que le champ d’action (d’accaparement) se soit lui, encore élargi – à l’infini.
Architecture – matérialités de l’« art collectif »
A chaque matière correspond une grammaire de formes et de mises en œuvre qui, tout comme pour l’écriture, s’apprennent et s’appuient sur des codes et des normes. Il existe ainsi une étymologie des assemblages (béton = sable + eau + charge de ciment) élaborée par les règles de l’art et les normes de la construction, qui tracent des lexiques culturels. Tout l’art des assemblages en architecture consiste en une exploration des détournements et du jeu des écarts avec les conventions de la tradition. La majeure partie de ce qui fait la matérialité de l’architecture aujourd’hui, et donc de nos lieux de vie, est standardisée. Cela signifie que la gamme des matériaux disponibles et leur mise en œuvre est prédéfinie par l’industrie du bâtiment [28] et ce dès le dessin. La Conception Assistée par Ordinateur (CAO) propose des bibliothèques de produits intégrées aux logiciels, auxquelles correspondent des mises en œuvre, mais aussi des catalogues de marques et de fabricants (fig. 3). L’efficacité du partage d’informations et de la détection automatique de conflits entre corps de métiers et acteurs et actrices de la construction, et ce en amont du chantier, font des applications d’optimisation tels que les process BIM (Building Information Modeling [29]) des outils de plus en plus indispensables pour les agences d’architecture. Mais en faisant de tels outils d’optimisation une condition pour l’obtention de certains marchés publics, la maîtrise d’ouvrage tente de s’assurer que les choix faits par la maîtrise d’œuvre sont ceux qui correspondent à la mise en œuvre la plus efficiente (ie., bien souvent, la plus économique). Ce qui concourt à une standardisation globale des réalisations [30] et revient à diminuer d’autant la marge de manœuvre des architectes quant aux choix techniques, économiques, esthétiques en fonction des situations. C’est ainsi le principe d’une optimisation économique qui préside, c’est à dire non pas l’usage des espaces, mais le profit qui pourra être tiré de l’exploitation d’un bâtiment, et ce dès l’étape de la conception. Or comme le philosophe José Ortega y Gasset le relevait déjà dans les années cinquante, l’architecture c’est peut-être le seul art où la qualité dépend avant tout de sa capacité à être un « art collectif » :
Imaginons une ville construite par des architectes « géniaux », mais laissant libre cours, chacun de son côté, à leur style personnel. Chacun de ces bâtiments pourrait être magnifique, l’ensemble n’en resterait pas moins bizarre et désagréable. (…) Nous ne pourrions considérer le bâtiment dans l’objectivité souveraine d’un corps minéral et grandiose, mais lirions dans ses lignes le profil impertinent d’un monsieur qui « a eu envie » de faire cela [31].
Ortega forme même le néologisme de « capriciosité » pour évoquer le « geste architectural » comme caprice, à l’opposé d’un « art collectif ». L’édifice qui devient sa propre fin, traduction visuelle d’un discours, aujourd’hui celui du processus de néo-libéralisation, s’est installé comme paysage quotidien dans un nombre croissant de territoires urbains de par le monde.
Le déroulement du projet d’architecture dans une agence conventionnelle suit une série planifiée d’étapes de conception et de réalisation, de la plus grande échelle, au plus petit détail d’aménagement. L’étape de la réalisation, celle du chantier, reste une étape d’exécution selon des plans [32], l’architecte y contrôle la bonne réalisation, ajuste l’exécution au besoin, en échange avec les différents corps de métiers qui interviennent. La construction doit avoir lieu, selon une planification temporelle optimisée afin de maîtriser les coûts – notamment celle de la main d’œuvre. Mais surtout, les traces de la réalisation doivent disparaître. Le chantier en lui-même est une étape invisibilisée. Comme si ce moment du chantier – qui cristallise un ensemble de décisions et de tensions, de réajustements, de compromis techniques, esthétiques et économiques – n’avait jamais existé.