
Good girls, bad girls : filles du net 2.0.
Fictions de soi et performance des images
- Magali Nachtergael
_______________________________

Fig. 4. J. Ringley, Jennicam.org, 1999 

Fig. 5. Molly Soda, I Tried With You, 2015 
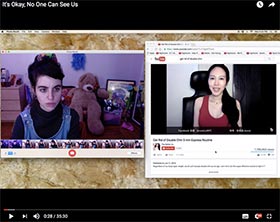
La suite du compte présente les œuvres de l’artiste et notamment son voyage en Corée du Nord. Elle tient un journal de bord de ce pays invisible et qui se présente pourtant au touriste sous son meilleur jour, malgré ses côtés obscurs : Ulman reconduit d’une certaine façon son expérience autobiographique à l’échelle d’un pays. Sa réflexion sur l’écriture de l’histoire intime ne se limite pas à ces expérimentations personnelles, en tant qu’artiste, elle produit elle-même des œuvres, dont une histoire très subjective de « l’histoire privée » qui se présente comme un montage vidéo [23]. Rappelant le format commun des infographies, ces « annales de l’histoire privée » sont une parodie de l’histoire du journal intime féminin. Une voix susurre des mots tendres à un homme, dans un long monologue accompagné d’images illustrant la conversation tronquée et de bruitages, un appareil photo se déclenche, des oiseaux chantent. Ces extraits intimes alternent avec des informations sur l’histoire du journal intime, illustrée de gif, textes mis en exergue et extraits de films. On semble bien loin du journal intime vu par Philippe Lejeune (Cher cahier, 1989), même sur écran (Cher écran, 2000) [24]. Pourtant, une continuité nette apparaît dans la position de la parole féminine depuis l’apparition du journal intime comme lieu de parole féminine réservée à l’espace domestique par opposition à l’espace public. Cet espace intime féminin est aussi celui de l’enfance, c’est-à-dire, des êtres non-finis, en formation, et qui ont besoin de protection mais aussi de tutelle. Ainsi, la culture féminine d’Amalia Ulman reprend elle les codes de l’enfance et de la féminité dans le sillage de la culture de la « chambre », dont Angela McRobbie avait dans les années 1970 signalé le renouveau à travers l’émancipation de la jeunesse dans la « bedroom culture ». En effet, dès les prémisses de la chambre connectée, comme le fait remarquer Jason Reid, historien de la culture adolescente, la punition « va dans ta chambre » perd tout son intérêt depuis que les chambres possèdent un équipement multimédiatique connecté sur l’extérieur [25]. Le phénomène s’amplifie avec la possibilité dans les années 2000 de se filmer dans sa chambre et de diffuser ces images en ligne. Apparaissent alors des « camgirls », filles du web 2.0 qui se mettent en scène – ou justement jouent sur l’authenticité de leur rapport à la caméra, dans toute la banalité de leur quotidien domestique. Selon Reid encore, montrant que la pratique de la camgirl est très spécifiquement genrée, le phénomène japonais des « hikikomori », adolescents s’enfermant dans leur chambre sans vouloir en sortir, est principalement masculin, même si certaines filles peuvent être concernées à la marge. Le garçon joue à des jeux vidéos, lit des livres, il ne communique pas sur Internet, la camgirl « s’extimise », pour reprendre le terme de Serge Tisseron et entretient un rapport performatif avec son image et un récit aux ramifications multiples, créant une véritable chimère du web, une hydre internautique.
Bedroom culture et authentique facticité : Molly Soda, « Internet-based artist »
Molly Soda, dont le vrai nom est Amalia Soto, est née sur l’île américaine de Puerto Rico en 1989 et n’est pas la première artiste à avoir mis en scène son intimité, ni sa chambre, ni son rapport à ce qui était les nouveaux médias au début des années 2000. Elle commence à publier sur Internet, comme des millions d’autres adolescentes, des images glanées et des selfies d’abord sur l’interface Tumblr où elle devient rapidement une célébrité dans la communauté, a « net-celebrity » ou une « micro-célébrité » [26]. Plus proche du « lifecasting » qu’Amalia Ulman, Molly Soda fait partie de la génération dite des cam-girls dont la plus célèbre fut Jennifer Shringley, connue pour son site Jennicam.org qui diffusait de 1996 à 2003 en flux continu des images de sa webcam personnelle (à raison d’une image toutes les 15 secondes au début, fig. 4). Plusieurs articles reviennent sur cette expérience, vue tantôt comme une œuvre conceptuelle, une expérience anthropologique ou un symptôme de la communication dans la médiasphère [27]. Bien que le flux soit disponible par un canal strictement visuel la « jennicam », le site enrichit l’expérience scopique de textes : la traditionnelle biographie, qui raconte en quelques mots l’autrice, mais aussi des poèmes « aux thèmes explicitement autobiographiques : Fear, Emily and I, Note of night. », comme le remarquent Jean François Laé et Philippe Artières. Ils ajoutent que plusieurs centaines d’entrées de son journal personnel sont également disponibles, certaines ayant les formes du quotidien, recettes de cuisine, activités de ses chats : « Car si toutes ces images ont pu être vues en direct, elles sont archivées en ligne, nommées, classées dans des dossiers, étiquetées comme des produits ou les objets d’une petit musée personnel » [28]. Ce qui s’apparente de prime abord à une archive personnelle sans grand intérêt a connu pourtant une fascination difficilement comparable aux reality shows dont l’événementialité était provoquée par des scénarios ou des situations à contraintes. Pour Jennicam, tous les visiteurs s’accordaient à dire qu’il ne se passait rien, qu’il n’y avait même rien à voir puisque la vitesse de rafraîchissement des images étaient très lente. De même, on voyait Jenni mais on ne l’entendait pas.
La théoricienne des médias Theresa Senft raconte, dans Camgirls, comment le non-récit de la vie de Jenni s’est construit pour elle à travers l’acte de navigation dans le site, mais aussi en considérant les images comme des fragments de récit biographique : « In viewing the images as a narrative, I was getting an inkling of who Jennifer was, and why she might find it useful to share her life with the world » [29], l’amenant au moment de découvrir enfin Jennifer devant sa caméra, à passer des textes aux images (et à faire coïncider les dates afin de reconstituer des chronologies). L’expérience Jennicam appartient à la catégorie des « real-life cam » [30] exactement comme celle de Molly Soda qui commence ses diffusions de « camgirl » en 2009 sur MySpace et Tumblr, soit six ans après la fin de Jennicam. Molly Soda prend alors un pseudonyme qui devient son nom d’artiste, passe du blog au net 2.0 qui permet d’agréger des contenus et autorise des interactions entre utilisateurs. Contrairement à Jennifer Shringley et profitant des progrès du net, Molly Soda est active devant sa caméra : elle prend une cigarette, se maquille, chante beaucoup, danse un peu, se montre en train de naviguer sur Internet, crée des GIF à son effigie, diffuse des séquences courtes d’environ 30 secondes, le tout en contrôlant son image simultanément sur son écran (fig. 5). Elle publie des images glanées sur Internet, des images qu’elle crée, des posts et des vidéos d’elle, rarement accompagnée par un autre personnage que son ours en peluche géant [31] (fig. 6). Personnalité tentaculaire du web ou « Internet persona », comme elle le dit elle-même, elle est évidemment présente sur son propre site, sur Instagram, Twitter, Youtube, Vimeo, Facebook, Soundcloud, Spotify, Pinterest, Tinder et Snapchat. Comme le signale Alice E. Marwick, la micro-célébrité est « quelque chose que l’on fait » et non que l’on « est » [32] : la création d’une activité en ligne est essentielle à sa réception, et à l’élargissement de son audience.
[23] A. Ulman, Annals of Private History, 2015, YouTube, 14 min 7 sec (consulté le 5 mai 2020).
[24] Ph. Lejeune, Cher cahier, témoignages sur le journal personnel, Paris, Témoins, Gallimard, 1989 et Cher écran : journal personnel, ordinateur, Internet, Paris La couleur de la vie, Seuil, 2000.
[25] J. Reid, Get Out of My Room! A History of Teen Bedroom in America, University of Chicago Press, Chicago and London, 2017, p. 137.
[26] T. Senft, Camgirls, Celebrity &. Community in the Age of Social Networks, Bern et alii, Digital Formations, Peter Lang, 2008 et D. Marshall, S. Redmond, A Companion to Celebrity, Hoboken, Wiley Publishers, 2015.
[27] Un chapitre lui est consacré dans J.-F. Laé et Ph. Artières, Archives personnelles : histoire, anthropologie et sociologie, Paris, Armand Colin, « Collection U », 2011.
[28] Ibid., p. 133.
[29] T. Senft, Camgirls, Celebrity &. Community in the Age of Social Networks, Digital Formations, Bern et alii, Peter Lang, 2008, p. 38.
[30] Le réseau autour de Jennicam lui a par ailleurs permis de faire des distinctions entre les modes de diffusion : « the real-life cam, the art cam, the porn cam, the group house cam, and the community cam », Id.
[31] Illustrant parfaitement l’ouvrage K. Goldsmith, Wasting Time on The Internet, New York, Harper Perennial, 2016 et le type d’activité qu’elle peut montrer sur sa chaîne YouTube, la vidéo de Molly Soda, It’s OK, No One is Watching us, 6 décembre 2016, 35 min 30 sec (consulté le 5 mai 2020).
[32] A. E. Marwick, « You May Know Me From Youtube. (Micro)-Celebrity in Social Media », dans P. D. Marshall et S. Redmond (dir.), A Companion to Celebrity, Wiley Publishers, 2015, p. 237.