[22] Fr. Gingras, « Par mi une estreite fenestre – L’espace d’une vision et les cadres du désir dans le récit français du XIIe siècle », dans Par la fenestre. Etudes de littérature et de civilisation médiévales, réunies par Ch. Connochie-Bourgne, Senefiance, n° 49, Aix-en-Provence, 2003, pp. 167-179 (en ligne. Consulté le 9 janvier 2023). Jean Subrénat, dans un article du même volume (« Une fenêtre à l’aurore (Tristan de Béroul, v. 4267-4485) », pp. 423-432) partage l’embarras de Daniel Poirion, qu’il cite (n. 6, p. 430) : « On ne voit pas bien le rapport entre les deux ouvertures mentionnées, le pertuis et la fenêtre. Il est possible que la fenêtre soit une ouverture intérieure, comme celle où Tristan a disposé sa lettre pour Marc (v. 2460, [...]) près de son lit, et le pertuis une petite ouverture donnant sur le jardin, sorte de meurtrière ne permettant pas d’entrer » (Daniel Poirion, éd. Pléiade, p. 1206).
[23] Trisan et Iseut, éd. D .W. Lacoix et trad. Ph. Walter, Le Livre de poche, « Lettres Gothiques », 1989.
[24] Le Livre d’images de Madame Marie, Introduction et commentaire A. Stones, Paris, Les éditions du Cerf – Bibliothèque nationale de France, 1997, f°90v.
[25] Jacques de Voragine, La Légende Dorée, trad. A. Bourreau, M. Goullet et L. Moulinier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », p. 29.
[26] M. G. Lewis, Le Moine, dans Romans gothiques, trad. A. Morvan, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », pp. 428-429.
[27] Voir P. Quignard, Le sexe et l’effroi, Paris, Gallimard, « Folio », 1994 (particulièrement le chapitre III, « Le fascinus », fascinus nommant en latin le phallos).
[28] Cette miniature représentant l’union de David et Betshabée est commentée par G. Bartholeyns, P.-O. Dittmar et V. Jolivet, Image et transgression au Moyen Age, Paris, PuF, « Lignes d’art », 2008, p. 51-52. Comme le notent les auteurs, cette métaphore courante de la pénétration sexuelle est « filée avec une grande inventivité » deux feuillets plus loin pour représenter le viol de Tamar par Amnon : la courtine au lieu d’être symétriquement écartée est enroulée autour de la tringle ; « l’enroulement, en suggérant un désordre évident, s’oppose à l’ouverture « consentie » des rideaux et indique par contraste le refus de la victime ».
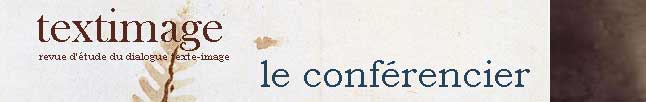
« Au trou mist l’ueil, dedens regarde » :
la question du voyeurisme médiéval
(XIIe-XVe siècles)
- Philippe Maupeu
_______________________________

Fig. 8. Anonyme, Saint Nicolas, v. 1300 

Le texte pose des problèmes de traduction. Il faut dire que le dispositif visuel, par lequel un homme depuis l’extérieur peut voir ce qui se passe à l’intérieur de la chambre, n’est pas très clair. L’ouverture dans la paroi est tantôt désignée comme pertus (un trou) et comme fenestre. S’agit-il de deux objets distincts ou du même objet désigné par deux termes différents ? Francis Gingras, dans un article consacré à cet épisode, opte pour la deuxième hypothèse de lecture : de la fenestre au pertuis, le rétrécissement de l’orifice dirait symboliquement la concentration et l’intensité du regard voyeur [22]. La traduction que je retiens des vers 4281-4298 par Philippe Walter [23] (ici en italiques et entre parenthèses dans la traduction de J.-Ch. Payen) invite à interpréter les choses différemment :
Alors, écoutez, dit le traitre. Il y a une petite ouverture dans le mur de la chambre. La courtine la recouvre. Derrière la chambre, il y a un ruisseau avec un glaïeul bien touffu. Que l’un de vous y aille demain matin. Une brèche introduit dans le nouveau jardin et permet de se rendre tranquillement au pertuis. Mais ne franchissez pas l’ouverture (que personne ne passe devant la fenêtre !). Epointez avec un couteau une branche ; piquez le tissu de la courtine avec la pointe de cette baguette, et tirez-le vers vous sans l’attacher (qu’il écarte doucement la tenture de l’ouverture, car elle n’est pas attachée), afin de voir nettement ce qui se passera quand Tristan viendra parler à la reine.
Un pertuis n’est pas une fenêtre. La fenêtre est un artefact, le produit d’un faire technique, une pièce d’architecture ; le pertuis (fût-il « mau », mauvais, comme le suggère le nom du repaire des amants) est une cavité, un passage, un conduit qui existe à l’état de nature, ou foré, creusé par l’homme. Le texte parait donc confus au regard de nos habitudes de lecture. Pour y voir clair, il faut rappeler que la syntaxe descriptive médiévale, qui régit la configuration des lieux du récit, n’est pas celle des romanciers du XIXe siècle. Dans le texte médiéval, le lieu ne préexiste pas à l’action narrative : il est déterminé et suscité par elle. A l’appui de ce fait syntaxique, dans l’ordre de l’iconographie, cette miniature pleine page, peinte à Paris autour de 1300, extraite du Livre de Marie [24], qui représente un épisode connu de la légende de saint Nicolas (fig. 8) : saint Nicolas, évêque de Bari, entend depuis la rue la plainte d’un homme malade obligé de prostituer ses trois filles pour subvenir aux besoins de la famille : « en secret, de nuit, le saint jeta par la fenêtre de la maison du voisin une grosse quantité d’or enveloppée dans un linge » [25] : l’intérieur de la maison et l’extérieur de la rue ne sont pas représentés ; seule l’est leur interface, la fenêtre, lieu de l’articulation du dehors et du dedans, lieu de l’échange et du don, car elle est présupposée par l’action (en l’occurrence l’aumône). Le lieu est un attribut de l’action – il est à la fois dépendant d’elle et il la détermine.
Le texte du Tristan s’éclaire si, au lieu de reconstruire mentalement l’espace a priori dans lequel se produit l’action (on pourrait parler par analogie, d’un mode perspectif de construction de l’espace narratif comme une boite qui accueillerait la figure), on le déduit de l’action. Or, des actions, ici il y en a deux :
- Godoïne regarde à l’intérieur depuis l’extérieur ;
- Yseut puis Tristan voient de l’extérieur depuis l’intérieur.
Si l’on regarde de près le texte, et que l’on préfère la traduction de Walter à celle de Payen, on sera attentif à l’avertissement de l’espion (voir supra, v. 4281-98) : le regardeur doit regarder à travers le pertus ménagé dans le mur en écartant la courtine, et non à travers la fenêtre (il se ferait repérer). La traduction de Payen : « ne franchissez pas l’ouverture » n’a pas grand sens. Le pertus se rapporte donc à l’action d’épier, de surveiller, c’est un dispositif de scrutation ; à l’inverse, la fenestre donne du jour à l’intérieur, elle permet de voir l’extérieur depuis l’intérieur : elle n’a pas la même fonction. Godoïne ne retient pas l’avertissement de l’espion : au lieu de regarder par le trou ménagé dans le mur (on pourrait imaginer par exemple qu’il soit à côté de la fenêtre ou dessous), il est vu par la fenêtre perçant la courtine : il révèle ainsi sa présence, et mal lui en prend. Le dispositif d’espionnage et de scrutation (Godoïne regardant les amants par le trou de mur) s’est mué en dispositif de projection (les amants voient l’ombre de Godoïne sur la courtine, par le jour versé à travers la fenêtre). L’existence factuelle, matérielle, de deux ouvertures, pertus et fenestre, importe à vrai dire moins pour la logique médiévale de l’action que leur distribution fonctionnelle dans le récit, et le marquage qu’elles opèrent de deux actions distinctes, non réciproques, agies par deux actants distincts (Godoïne et Iseut) : une scrutation de l’objet d’un côté (Godoïne doit espionner Iseut par le pertus), une révélation de soi de l’autre (Godoïne trahit sa présence à Iseut par la fenestre).
Peut-on dès lors parler de voyeurisme dans cette scène ? Cette scène est très différente du dispositif optique-libidinal par lequel la « pyramide visuelle » de la perspective s’inverse fantasmatiquement en « entonnoir » dans lequel le voyeur réifie l’objet de son désir. On peut le mesurer par les vertus du décalage anachronique. Dans le Moine, écrit par Lewis en 1796, Matilda, femme déguisée en moinillon, suppôt du diable, tend au moine pervers Ambrosio un miroir magique où il puisse se repaître des charmes d’Antonia :
(Ambrosio) contempla en miniature l’adorable figure d’Antonia. La scène se passait dans un petit cabinet attenant à sa chambre. Elle se déshabillait pour se baigner. Les longues tresses de sa chevelure étaient déjà ramenées vers le haut. Le moine amoureux eut toute licence d’observer les contours voluptueux et l’admirable symétrie de son corps. Elle se dépouilla de son dernier vêtement et, s’avançant vers le bain qu’on lui avait préparé, mit le pied dans l’eau. Saisie par le froid, elle le retira. Bien que ne se sachant pas observée, elle dissimulait ses charmes avec un sens inné de la pudeur ; et elle restait, hésitante, sur le bord, dans l’attitude de la Vénus des Médicis [26].
Relation non bijective, la vision en miniature dit ici la captation fantasmatique, la réification par Ambrosio de l’objet du désir.
Faire de Godoïne une figure du voyeur, c’est se tromper de paradigme. Certes, le trou foré dans le mur puis dans la courtine, motif que l’on retrouve ensuite dans le Roman de Mélusine et dans le Roman de la Violette, est gros de connotations sexuelles. Dans la miniature tirée de la Bible du XIIIe siècle, commentée ci-dessus, la scène de nuit des amants suit celle de Bethsabée surprise au bain (fig. 9). Elle métaphorise avec on ne peut plus d’insistance la pénétration sexuelle par l’écartement des deux courtines de part et d’autre du cierge érigé au-dessus du lit à hauteur de la hanche de David. Mais précisément elle la métaphorise, comme le fera plus tard Jean de Meung à la fin du Roman de la Rose, et donc en déplace la représentation du littéral au figuratif. En cela, parce qu’elle joue sur le déplacement sémiotique, et même si le sens second en est parfaitement obvie, la métaphore ne saurait être à justement parler « obscène », le sens symbolique faisant écran au sens littéral qui fascine le voyeur et le laisse interdit [27]. La syntaxe de l’image disjoint en outre la scène de surprise et la scène sexuelle, là où le voyeurisme les confond dans sa jouissance [28].
Pourtant, la lecture des scènes médiévales de la nudité surprise comme scènes de voyeurisme s’impose encore dans nos représentations. Pour en revenir à Godoïne et Iseut, selon Francis Gingras « Béroul multiplie les occasions pour des voyeurs qui accèdent à la jouissance en épiant les amants, position trouble et peu flatteuse dangereusement semblable à celle de l’auditeur / lecteur » ; alors que « la fenêtre s’amenuise de plus en plus », d’abord « un petit fenestre », puis « pertuis », « pertuiset » (v. 4321), « il faudra encore déchirer la courtine pour accéder à la jouissance des amants » – et l’on voit ici comment le commentaire s’emballe [29]. Car ce n’est pas à la jouissance des amants que l’on accède ici, c’est-à-dire à leur abandon érotique, mais au contraire à leur vigilance, toute de prudence et de contrôle. L’arc d’éros s’est mué en machine de guerre pour faire taire les médisants. Et c’est bien de cela qu’il s’agit : le félon assume la place du losengier (v. 402) qui dénonce au roi les agissements des amants. Voir ici n’est pas jouir pour soi de l’objet de son désir ; voir, c’est dénoncer et jouir de la dénonciation à l’autre du délit perpétré par les amants. L’obsession du flagrant délit et de la preuve traverse tout le Tristan de Béroul, preuve d’une passion adultère (courtoise) que tout le monde connait mais dont les dispositifs judiciaires échouent à établir la preuve, dans un fonctionnement comparable au Roman du Renart.