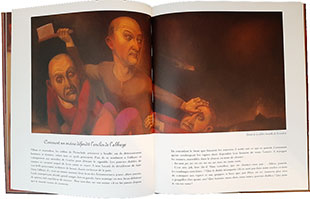Résumé
Les adaptations pour l’enfance et la jeunesse de classiques de la littérature française sont souvent accusées de trahir les œuvres originelles. Dans cet article, nous nous appliquons à démontrer en quoi les illustrations de cinq artistes contemporains insérées dans des adaptations de Gargantua destinées à un jeune public prolongent le texte de Rabelais, et renforcent sa polyphonie grâce au procédé de l’intericonicité.
Mots-clés : Gargantua, illustration, littérature jeunesse, adaptation, intericonicité
Abstract
Adaptations of French literary classics for children and young people are often accused of betraying the original works. In this article, we set out to demonstrate how the illustrations by five contemporary artists inserted into adaptations of Gargantua for a young audience extend Rabelais’ text, and reinforce its polyphony through the process of intericonicity.
Keywords: Gargantua, illustration, childhood studies, adaptation, intericonicity
On a souvent reproché aux adaptations pour l’enfance et la jeunesse de trahir, de défigurer les textes, en particulier les œuvres patrimoniales de la littérature française. Les transformations du texte original seraient guidées par un objectif de « lisibilité », comme l’affirme Isabelle Nières-Chevrel :
[L’adaptation] vise, dans le meilleur des cas, à reformuler un texte qui n’était pas destiné à un jeune public pour le lui rendre accessible ; mais trop souvent elle sert à édulcorer des œuvres littéraires, qu’elles soient pour adultes ou pour enfants, à en réduire la complexité esthétique, voire à les augmenter d’une série de banalités. Nous sommes alors devant une entreprise de « lisibilité » d’un triple point de vue esthétique, normatif et idéologique [1].
Pour séduire la jeunesse et lui permettre d’accéder à notre patrimoine littéraire, il faudrait réduire la complexité esthétique des œuvres originelles, notamment par la coupe, la simplification et donc la mutilation du texte.
Les adaptations contemporaines de Gargantua destinées à la jeunesse nous permettent de nuancer ce propos. Si elles coupent et simplifient le texte, elles sont toujours accompagnées d’illustrations qui semblent aptes à réinvestir la complexité esthétique du texte original. Les liens tissés entre le texte et l’image font en effet partie du processus d’adaptation pour l’enfance et la jeunesse. C’est ce que nous essaierons de montrer en nous concentrant sur cinq adaptations contemporaines du second-né des livres rabelaisiens dont les illustrations véhiculent une riche culture visuelle : Gargantua (Bordas, 1981) illustré par Isabel Gautray et adapté par André Massepain [2], Gargantua suivi de Pantagruel d’après l’œuvre de Rabelais (Thierry Magnier, 2004) illustré par Nicole Claveloux, d’après un enregistrement sonore de 1966 interprété par Jacques Fabbri, Michel Galabru et Claude Piéplu (l’adaptateur n’est pas indiqué) [3], l’album Gargantua (Milan Jeunesse, 2004) illustré par Ludovic Debeurme et adapté par Christian Poslaniec [4], Gargantua, d’après Gargantua de François Rabelais (Amaterra, 2014) adapté par Jean-Luc Langlais et illustré par Sébastien Mourrain [5] et La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel (Alzabane, 2018) illustré par Gaëtan Noir et adapté par Jean-Sébastien Blanck [6]. Ces adaptations ne sont pas destinées à un public scolaire : elles sont publiées dans des maisons d’éditions qui ne sont pas spécialisées dans les manuels scolaires et parascolaires, à l’exception des éditions Bordas. Cependant, le Gargantua d’Isabel Gautray ne ressemble pas à un ouvrage éducatif : l’absence d’appareil critique didactique et le format proche du in-quarto l’assimilent à un album. Ces cinq ouvrages présentent des cas frappants d’intericonicité qui font écho à l’intertextualité, à la fois antique, médiévale et contemporaine, narrative, poétique et théâtrale, de l’œuvre de Rabelais. Cette diversité de sujets, traduite par une diversité de tons et de styles, constitue la dimension polygraphique [7] de Gargantua. A l’instar des images que nous allons étudier, marquées par la plurivocité interprétative, le récit de Rabelais multiplie les interprétations possibles. L’œuvre a d’ailleurs suscité d’innombrables déclinaisons dans divers domaines au fil du temps : le personnage éponyme a notamment été mis en scène dans des caricatures politiques au XIXe siècle [8]. Nous nous attacherons précisément à montrer la dimension politique des images utilisées dans les adaptations contemporaines pour la jeunesse, qui s’inscrit dans une longue tradition iconographique. Cette lecture politique peut sembler étonnante au sein de livres pour enfants, mais il faut se rappeler que, dans la littérature d’enfance et de jeunesse, l’adulte est toujours le médiateur entre l’œuvre et le jeune public : il crée, édite, recommande, achète, lit, etc. Les cinq ouvrages analysés ici ne se limitent pas à leur lectorat de prédilection, et le public s’avère bien souvent double.
Les contours cachés des grandes œuvres de la Renaissance
Dans leur article « Gargantua et ses adaptations, entre Moyen Age et humanisme », Isabelle Olivier et Gersende Plissonneau analysent, entre autres, les illustrations de Ludovic Debeurme pour l’album Gargantua, publié aux éditions Milan Jeunesse, et remarquent les nombreux points communs entre la peinture « Détail de la célèbre bataille de Picrochole » de l’album de Debeurme (fig. 1) et des tableaux de deux maîtres du XVIe siècle, Pieter Brueghel l’Ancien et Jérôme Bosch (figs 2, 3 et 4) :
De plus, certaines de ces illustrations peuvent évoquer les peintures de Jérôme Bosch et de Breughel, qui se situent elles aussi à la charnière entre deux systèmes de pensée et de représentation. Le « détail de la célèbre bataille de Picrochole » que nous propose L. Debeurme est fondé sur un jeu d’ombre et de lumière que l’on retrouve dans des tableaux comme Le Jugement dernier de Bosch, Le Triomphe de la mort ou encore Margot la folle de Breughel, où le personnage féminin évolue sur fond de ruines et de flammes [9].
Dans la continuité de cette analyse sur le jeu d’ombre et de lumière de l’image de Debeurme, nous pouvons aussi penser à la partie haute du panneau intérieur de droite L’Enfer, du Jardin des délices de Jérôme Bosch (fig. 5). Les deux grands peintres de la Renaissance flamande ont, tout comme Rabelais, marqué leur temps par leur originalité et leur profusion, leur débordement graphique. Tout en s’inscrivant dans leur époque, ils ont développé des univers visuels uniques en leur genre et hors des normes des mouvements artistiques de leur temps, ce qui fait écho aux caractéristiques littéraires de Rabelais. Le foisonnement de l’écrivain du XVIe siècle entre d’ailleurs en dialogue avec les tableaux les plus célèbres des deux peintres. On pourrait penser aux Jeux d’enfants de Brueghel, daté de 1560, où plus de 230 enfants jouent à 83 jeux différents [10], et qui rappelle le chapitre-liste XXII, « Les jeux de Gargantua », sorte d’encyclopédie des divertissements.
[1] Isabelle Nières-Chevrel, « Adaptation », dans Dictionnaire du livre de jeunesse : la littérature d’enfance et de jeunesse en France, dir. Isabelle Nières-Chevrel, J. Perrot, Paris, Ed. du Cercle de la librairie, 2013, p. 8.
[2] François Rabelais, Gargantua, adaptation d’André Massepain, illustrations d’Isabel Gautray, Paris, Bordas, « Contes gais de tous les temps », 1981.
[3] Gargantua suivi de Pantagruel d’après l’œuvre de François Rabelais, raconté par Jacques Fabbri, Michel Galabru et Claude Piéplu, illustré par Nicole Claveloux, Paris, Editions Thierry Magnier, 2004.
[4] François Rabelais, Ludovic Debeurme, Gargantua, extraits choisis et traduits du vieux français par Christian Poslaniec, Toulouse, Milan jeunesse, 2004.
[5] Jean-Luc Langlais, Gargantua, d’après Gargantua de François Rabelais, illustrations de Sébastien Mourrain, Lyon, Editions Amaterra, « Les grands textes à hauteur d'enfant », 2014.
[6] Gaëtan Noir (illustrations), La Vie très horrifique des géants Gargantua et Pantagruel, d’après François Rabelais, adaptation et scénario de Jean-Sébastien Blanck, Clamart, Alzabane éditions, « Histoires d’Antan », 2018.
[7] La polygraphie et l’hybridité de Rabelais ont fait l’objet de plusieurs études : Terence Cave, « Polygraphie et polyphonie : écritures plurielles, de la Renaissance à l’époque classique », Littératures classiques. De la polygraphie au XVIIe siècle, n° 49, automne 2003, pp. 385-400 (en ligne. Consulté le 15 mai 2024) ; Dorothée Lintner, « Polygraphie comique chez Rabelais et Furetière », Papers on French Seventeenth Century Literature, vol. 38, n° 74, juin 2011, pp. 107-120 ; Guy Demerson, « Tradition rhétorique et création littéraire chez Rabelais », Etudes de Lettres, n° 2, 1984, pp. 3-23.
[8] On citera trois exemples frappants : Anonyme, Le Gargantua du siècle ou l’Oracle de la dive bouteille, 1790-1792, eau-forte coloriée, H. 0,535 m ; L. 0,402 m, Paris, BnF ; Anonyme, Mme. Gargantua à son grand couvert, Paris, Paul-André Basset éditeur, vers 1804-1814, gravure à l’eau-forte et au burin coloriée, H. 0,23 m ; L. 0,319 m, Paris, BnF ; Honoré Daumier, « Gargantua », La Caricature, Paris, 16 décembre 1831, épreuve sur blanc provenant du dépôt légal, H. 0,214 m ; L. 0,305 m, Paris, BnF.
[9] Isabelle Olivier, Gersende Plissonneau, « Gargantua et ses adaptations, entre Moyen Age et humanisme », dans Grands textes du Moyen Age à l’usage des petits, dir. Caroline Cazanave, Yvon Houssais, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2010, p. 321 (en ligne. Consulté le 15 mai 2024).
[10] Selon le site du musée où cette œuvre est conservée, le musée d’Histoire de l’art de Vienne (en ligne. Consulté le 15 mai 2024).