[24] B. Chambaz, Œil noir, Paris, Flohic éditions, 1999.
[25] J. Rouaud, Le Paléo circus, Charenton, Flohic éditions, 1996.
[26] Ibid., p. 19.
[27] Ibid., p. 35.
[28] Fr. Bon, Dehors est la ville, Charenton, Flohic éditions, 1998.
[29] Ibid., pp. 24-25, je souligne les déictiques.
[30] Ibid., p. 7.
[31] Ibid.
[32] Ibid., p. 15.
[33] Ibid., p. 81.
[34] Par exemple le concours d’écriture créative à partir d’images Les Mots pour voir organisé depuis 1999 par le site Imageimaginaire (en ligne. Consulté le 8 avril 2021) dans la Région Centre, en France, ou encore les ateliers d’écriture du poète Nicolas Tardy (en ligne. Consulté le 8 avril 2021).

La genèse imagée comme mode énonciatif.
Lorsque la collection « Musées secrets »
(éditions Flohic) fait écrire à partir d’images
- Anne Reverseau
_______________________________
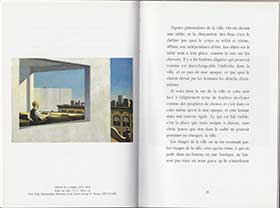
Fig. 4. Fr. Bon, Dehors est la ville, 1998.
E. Hopper, Office in A Small City, 1953 
Le discours essayistique fait l’objet de glissements dans la collection « Musées secrets », notamment parce que les relations documentaires des écrivains à leur objet artistique ne prennent pas forcément le ton de l’essai, comme le montrent deux exemples. Œil noir, de Bernard Chambaz [24], qui porte sur Edgar Degas, est un texte documenté aux deux sens du terme : l’auteur a recueilli de nombreuses informations qu’il utilise dans son texte et les images, en page de gauche, sont utilisées comme de véritables illustrations dans une remarquable synchronisation entre image et texte. Mais la vie de Degas est racontée à la première personne : vieillissant, le peintre raconte sa vie et parle de ses doutes et de sa peinture.
Un autre exemple de glissement du discours essayistique est le texte de Jean Rouaud, Le Paléo circus [25], sur l’art pariétal. L’ouvrage commence comme un essai qui tenterait d’imaginer la vie des hommes préhistoriques à partir des images qu’ils nous ont laissées. Le discours est adressé et parfois docte : « Imaginez que vous décidez de peindre une haute et vaste fresque », « Voir loin était un impératif de survie » [26]. Or, Jean Rouaud entre progressivement dans le récit : au chapitre 2 commence l’histoire du « petit homme estropié » [27], un homme inutile pour son clan, qui va inventer le dessin du mammouth.
Dans ces quelques exemples, il nous semble que c’est la genèse imagée de ces textes, qui s’apparentent à des textes de commande, qui autorise une grande souplesse dans les types de discours et donc dans la généricité de chaque livre. Comme la seule consigne était d’écrire sur un artiste, avec des images, il importait peu d’écrire une nouvelle, un essai ou de la poésie. L’ancrage dans la collection, d’emblée, et la liberté de la commande ont pu ainsi permettre aux auteurs des expériences d’écriture qu’ils n’auraient pas faites par ailleurs.
La pente naturelle de la description
Le discours descriptif est un autre attendu de ce type d’écriture face aux images, qu’on ne manque pas de rencontrer dans « Musées secrets » même si moins fréquemment que le discours essayistique. Les exemples sont nombreux, mais on ne développera ici que l’analyse de Dehors est la ville [28], l’ouvrage de François Bon sur Hopper, qui est l’un des plus intéressants pour aborder la question de la genèse imagée, notamment parce que la relation entre images et écriture s’y joue à plusieurs niveaux.
On a d’abord l’impression d’une suite de textes cherchant à plonger dans les tableaux d’Edward Hopper, faisant en quelque sorte l’exercice de la description d’images, mais d’une description dynamique, notamment grâce au pronom « on », abondamment utilisé. Dans Dehors est la ville, les images et le texte sont synchrones et cette co-présence est renforcée par l’usage des déictiques et des démonstratifs. Face au tableau Office in a Small City (1953), on lit :
On est devant une table, et la dissymétrie des bras c’est le théâtre par quoi le corps se refait et résiste (…). Les objets sur la table sont à leur place (…). Il y a les fenêtres alignées qui prouvent comme est interchangeable l’individu dans la ville, et ce pan de mur opaque […].
Sur la même page, mais renvoyant au tableau reproduit dans la double page suivante (New York Office, p. 26), on lit aussi : « Et voici dans la rue de la ville ce cube noir face à l’alignement terne de fenêtres mi-closes comme des paupières de choses » [29] (fig. 4).
La façon qu’a François Bon de se projeter dans les tableaux d’Hopper, en s’intégrant à la représentation, avec les pronoms « on » et « nous », évoque les modalités énonciatives souvent choisies par les participants aux ateliers d’écriture à partir d’images, qui s’efforcent de décrire l’image de façon dynamique. Mais une autre lecture de Dehors est la ville est possible. Comme le dit clairement l’exergue, le livre porte sur la façon dont un peintre a médiatisé l’idée de la ville pour un écrivain. C’est en réalité une relation et sa genèse qui sont en jeu dans cet ouvrage de « Musées secrets ». Les premières pages sont à cet égard explicites :
La ville est une fiction.
Cette ville n’existe pas. Ce qui se peint c’est notre idée de la ville, ce que nous mettons en jeu entre nous et le dehors lorsque nous disons le mot ville [30].
Hopper a donc aidé François Bon à construire son propre imaginaire urbain. Celui-ci se dit d’un ton définitoire : « La ville est ce qui nous sépare des autres hommes… » [31] ou « la ville c’est une dispersion là posée sur la planète… » [32]. Dehors est la ville éclaire ce que doit la réflexion sur la ville, qui est centrale dans toute l’œuvre de François Bon, au peintre américain, et en particulier à sa façon de représenter le hors-cadre, les ouvertures, l’absence et la séparation. La fin du texte le redit ainsi, en s’adressant directement à Hopper : « on a marché dans cette ville en fiction, en quarante ans rassemblée, obsessivement centrale, récurrente » [33].
Cet exemple de François Bon face à Hopper montre que la notion de « genèse imagée » peut s’entendre de deux façons, toutes deux exemplifiées dans la collection « Musées secrets » : les images qui figurent « sous » un texte, et plus largement l’univers visuel d’un écrivain, mais aussi les jalons visuels qui permettent de mieux comprendre la genèse d’un écrivain, l’illustration possible d’une autobiographie littéraire. François Bon utilise ici massivement la description pour dire cette relation, mais d’autres types de discours sont présents dans la collection.
La tentation de la fiction
A la lecture extensive de la collection « Musées secrets », comme à la lecture de textes d’ateliers partant d’images [34], on a l’impression que la fiction est une sorte de tentation éprouvée lors de la description. La fictionnalisation apparaît en effet en général à la suite de séquences descriptives et se constitue souvent en geste de franchissement d’un seuil, comme on l’a vu dans l’ouvrage de Jean Rouaud avec le passage au deuxième chapitre pour introduire un personnage. Comme la description, la fictionnalisation de l’image peut aussi être érigée en principe d’écriture. On trouve dans « Musées secrets » deux mouvements de fictionnalisation qui nous semblent aller dans des directions contraires : soit les peintures réelles sont intégrées dans des fictions plus larges, soit il s’agit de faire de chaque image un micro-récit.