[16] Selon ce principe, un texte peut présenter des aspects formels et sémantiques qui le profilent comme relevant d’un genre tout en n’étant qu’une forme mise au service d’objectifs d’un autre genre, auquel il est en réalité subordonné, et dont ce texte participe par conséquent. Ainsi en va-t-il de certains entretiens, dans la presse notamment, qui sont souvent élaborés et utilisés de façon à faire portrait, et qui sont d’ailleurs fréquemment présentés comme tels dans les chapeaux de présentation de ces entretiens.
[17] Voir Jean-Michel Adam & Ute Heidmann, Le Texte littéraire. Pour une approche interdisciplinaire, Louvain-la-Neuve, Academia, « Au cœur des textes », 2009, ainsi que Jean-Marie Schaeffer, Qu’est-ce qu’un genre littéraire ?, Paris, Seuil, « Poétique », 1989.
[18] Charles Grivel, Production de l’intérêt romanesque, La Haye, Paris-Mouton, 1973.
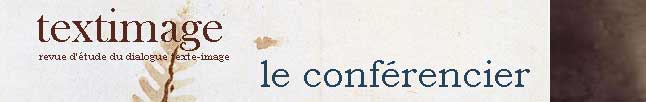
Un art de faire découvrir le monde.
Portraits de pays phototextuels
- David Martens
_______________________________
Au même titre que les figures de jeunes habitants mise en scène dans la plupart de ces livres, il y va là d’un procédé destiné à assurer un fil conducteur à ces composés de textes et d’images qui ont vocation à rendre compte d’une réalité aussi diverse et riche que possible, tout en étant dans le même temps tenus d’œuvrer de façon synthétique. Ces formes narrativisées de portraits de pays existent bien sûr également dans les formes pour adultes du genre. Cependant, elles paraissent à première vue tendanciellement nettement moins fréquentes, et mises en œuvre différemment et à d’autres fins. Si des séquences narratives trouvent place dans ces livres, lorsque ce n’est pas à leur entame (pour capter l’attention en début d’ouvrage), ou isolées dans l’ouvrage (pour relater un épisode particulier et lui conférer davantage de dynamisme), ce caractère narratif prend corps essentiellement dans des séquences ayant trait à l’histoire de la contrée dépeinte qui se trouve intégrée à une finalité plus fondamentalement descriptive qui est celle posée par le cadrage générique du portrait. En d’autres termes, ces narrations sont subordonnées à une finalité portraiturale, en vertu d’un principe que je proposerais d’appeler subordination générique fonctionnelle [16].
De telles opérations de cadrage sont également à l’œuvre dans les portraits de pays destinés aux jeunes publics, qu’il s’agisse – comme pour les portraits de pays pour adultes au demeurant – des titres de collections ou d’ouvrages à vocation portraiturale, qui affichent le nom du pays dont il s’agit de dresser le portrait – en vertu du principe selon lequel un titre de portrait porte souvent, ou du moins mentionne, le nom de ce dont il fait le portrait –, ou encore des couvertures, qui présentent avec une fréquence frappante des portraits des enfants sur lesquels se focalisent ces livres. Ces gestes de configuration générique relèvent de ce que Jean-Michel Adam et Ute Heidmann, à la suite de Jean-Marie Schaeffer, ont appelé la généricité éditoriale [17] : plutôt que des auteurs, elle est le fait des éditeurs qui conçoivent ces collections relativement formatées et contraintes, au point, à l’occasion, de présenter des œuvres romanesques rapportant des formes de découvertes géographiques ou sociales comme des portraits de pays, par exemple en les inscrivant dans des collections ad hoc.
Selon une tendance qui n’est nullement exclusive à la littérature de jeunesse, l’on offre volontiers à quelqu’un qui aime un pays un roman dont l’intrigue se déroule en tout ou en partie dans ce pays. Un tel cadeau rend présent le pays à travers la lecture. Que des romans puissent se voir ponctuellement rapprochés du portrait de pays, voire instrumentalisés pour servir un projet éditorial à vocation portraiturale, tient au fait que les récits peuvent comprendre des séquences qui font effectivement le portrait de pays ou de villes, de façon concise ou plus ample. Pour le formuler autrement, il peut y avoir du portrait de pays, plus ou moins nettement localisé, dans des textes dont la généricité les conduit à participer à d’autres formes génériques, à dominante non descriptive notamment, par exemple le roman. Ainsi s’agit-il de livrer (ou de prétendre livrer) à son lectorat des ouvrages qui permettent de découvrir des pays en misant sur l’attrait supposé de formes narratives susceptibles de jouer des attraits que procurent la production d’un « intérêt romanesque » [18].
Au début de la seconde moitié du XIXe siècle, un éditeur sévillan tel que Manuel de Santa Ana, en vient dans cette perspective à réunir des romans, souvent traduits, dans la « Biblioteca económica de instrucción y de recreo », étudiés par Catherine Sablonnière (lire l’article). Dans la présentation de ses publications, l’éditeur s’emploie à coupler une prétention d’instruction avec celle du divertissement, selon une alliance qui, coutumière en littérature de jeunesse, s’est nouée dans le titre de la fameuse collection du « Magasin d’éducation et de récréation » de Jules Hetzel, dans laquelle Jules Verne a publié ses « Voyages extraordinaires ». Plus encore, cette série narrative se place explicitement sous le signe du descriptif qui sous-tend le portrait, l’éditeur adjoignant aux titres originaux (qu’il modifie parfois aussi…), des sous-titres qui annoncent la couleur quant à la prétention de ces récits (ou plutôt de leur éditeur espagnol…) à apprendre à leurs lecteurs ce qu’il en est des modes de vie des populations dépeintes.
Ainsi, le roman de F. Gerstaecker, Los Piratas del Mississipi est-il accompagné du sous-titre « descripción de costumbres norteamericanas » [description de coutumes nord-américaines]. Le roman de Paul Féval, Enrique de Bretaña el emplazado a pour sous-titre « costumbres bretonas de la Edad media » [coutumes bretonnes du Moyen Age], le roman de E. About, El rey de las montañas, celui de « descripción de costumbres griegas » [description de coutumes grecques] et enfin, les Memorias de un cazador [Mémoires d’un chasseur] d’Ivan Tourghenief est qualifiée de « completa descripción de costumbres rusas » [description complète des coutumes russes].
Portraits de populations
Quoiqu’elle paraisse singulière dans le panorama des séries de portraits de pays, l’inclination ethnographique de cette collection d’œuvres romanesques traduites manifeste de façon particulièrement nette l’attention plus prononcée de ces ouvrages sur les populations et leurs us et coutumes que celle dont font la plupart du temps preuve leurs équivalents destinés au public adulte. En l’espèce, cet attrait, qui dépasse le cadre de cette collection – il se traduit notamment, plus tardivement, dans le dispositif accordant une place centrale à un enfant local dans les albums photo-textuels –, place au centre du propos l’une des trois composantes constitutives d’un pays lorsqu’il s’agit d’en dresser le portrait : d’une part, la conformation géographique du pays dépeint, en ce qu’elle comprend de paysage « naturels » et de sites façonnés de la main de l’être humain ; d’autre part, l’histoire de ce territoire ; mais aussi et enfin celle de ses populations. Tout portrait de pays permet peu ou prou d’appréhender ces différentes réalités, qui constituent l’horizon d’attentes légitimes du genre, en y trouvant leur place selon des modes de distribution variables.
En matière d’articulation des réalités dépeintes aux fins de faire portrait, il y va non seulement d’une question de formalisation des matières abordées – elles peuvent l’être, par exemple, séparément, selon une distribution en chapitre distinct par sujet, ou de façon plus étroitement mêlée –, mais aussi, plus fondamentalement, d’une simple question de valence, soit de poids respectif de chacun de ces éléments. A cet égard, tout portrait de pays (et toute série de portraits de pays) se singularise par sa façon de traiter ces différents ordres de réalité, à commencer par l’importance voire le caractère central ou non qu’il leur accorde, le cas échéant au détriment des autres. Le privilège manifeste accordé aux populations dans les séries destinées aux enfants se traduit à nouveau dans les titres de plusieurs collections, dont « Pays et peuples du monde » de l’éditeur turinois Edt Giralangolo (2007-2010), qu’évoque Caterina Ramonda (lire l’article). « Enfants de la Terre », série plus ancienne publiée par Le Père Castor entre 1948 et 1983, « propose[e] » pour sa part « aux enfants de 7 à 13 ans des albums (…) [dont l]e but est de “donner une idée vivante, sympathique et pittoresque de la manière de vivre dans les différents pays du monde” », comme le pointent Florence Gaiotti et Eléonore Hamaide-Jager.
La plupart du temps, les titres incluent le nom d’un pays, parfois d’une ville, mais proposent aussi des entrées par une ethnie comme les Masaïs qui habitent dans plusieurs pays de l’Afrique de l’Est, comme les Hmong-Fleur répartis dans de vastes espaces au Vietnam, en Chine et au Laos… ou les Touaregs, peuple nomade du Sahara.