
La Mise en abyme imagée
- Jean-Marc Limoges
_______________________________

Fig. 32. J.
Carpenter, In the Mouth
of Madness, 1994 
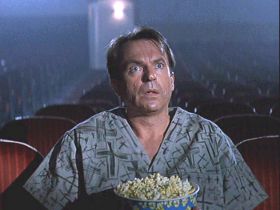
Fig. 33. J.
Carpenter, In the Mouth
of Madness, 1994


Fig. 34. J.
Carpenter, In the Mouth
of Madness, 1994


Fig. 35. M.
Cright, Seulement 129
secondes, 2004


Fig. 36. M.
Cright, Seulement 129
secondes, 2004


Fig. 37. M. Cright, Seulement 129 secondes, 2004

S’il
est aisé de trouver des exemples de mises en abyme
imagées instantanées de type simple au
cinéma, il sera en revanche impossible de trouver des
exemples de mises en abyme de type aporétique pour la raison
que nous avons évoquée plus haut : la
mise en abyme ne peut être aporétique
qu’à une seule condition : que
l’œuvre n’apparaisse pas
dans l’œuvre (mais ne demeure
qu’à l’état de programme,
d’ébauche, de projet, de réalisation
partielle du film lui-même). En revanche, il sera bien plus
facile de trouver des cas de mises en abyme imagées
instantanées de type infini ; étaient
d’ailleurs de ce type tous les exemples offerts par
Dällenbach lorsqu’il abandonnait la
littérature au profit de la peinture : les exemples
de la boîte de cacao Doste, des bouteilles de Quinquina
Dubonnet, des flocons d’avoine Quaker
Oats et de la Vache qui rit,
étaient tous des cas de mises en abyme imagées
instantanées de type infini. Or, toute mise en abyme
imagée infinie ne sera pas forcément
instantanée.
In
the Mouth of Madness (J. Carpenter, 1995)
représente un exemple de mise en abyme imagée
infinie qui n’est pas instantanée. Le film raconte
l’histoire de John Trent (Sam Neill), un assureur
s’improvisant détective afin de retrouver Sutter
Cane (Jurgen Prochnow), auteur de livres d’horreur
à succès, bizarrement disparu. Le film commence
à l’asile. On y voit Trent en camisole de force,
hurlant qu’il n’est pas fou, se
débattant sous la poigne de fer de deux infirmiers qui
l’enferment dans une chambre capitonnée (fig. 32).
Un peu plus tard arrive le Dr. Wrenn (David Warner) qui invite le
patient à lui raconter son histoire. On apprend alors
comment les éditeurs de Cane ont fait appel à
Trent pour le retrouver. En effet, son dernier livre, Hobb’s
End (comme les précédents
d’ailleurs), se vend bien mais le public attend impatiemment
le prochain, In the Mouth of Madness, dont la
publication risque d’être retardée,
sinon interrompue, si on ne retrouve pas l’auteur. Trent
raconte alors comment il a pénétré
(physiquement) dans l’univers de Hobb’s
End afin d’y retrouver l’auteur qui
s’y cachait et comment Sutter Cane lui avait remis le
manuscrit de In the Mouth of Madness
qu’il l’avait sommé de rapporter (dans
le monde réel) à son éditeur. Victime
de toutes ses manigances surnaturelles, incapable d’accepter
la porosité des frontières entre son monde et le
monde de la fiction, Trent devient fou. Fin de l’histoire. Le
psy est remercié. Le patient se retrouve seul. Cependant, la
porte de sa cellule est ouverte. L’asile est
désert. On dirait une hécatombe. Trent en profite
pour s’enfuir. Il erre dans les rues de la ville,
saccagée par les lecteurs du livre qui sont tous, eux aussi,
devenus fous. Il entre dans un cinéma (fig. 33)
où on présente une adaptation
cinématographique du roman In the Mouth of Madness
avec, dans le rôle titre, nul autre que John Trent (fig. 34).
Le film raconte donc l’histoire à laquelle nous
venons d’assister : Trent est à
l’asile, hurlant qu’il n’est pas fou,
puis se retrouve, au terme de sa captivité, devant un film
qui raconte son histoire… La dernière image est
donc rétro-prospective, en cela qu’elle renvoie au
début du film, mais annonce aussi sa suite.
Exemple
structurellement semblable dans le court-métrage
d’animation Seulement 129 secondes (M.
Cright, 2004). Le film raconte l’histoire d’un
gardien de nuit poursuivi par un monstre (fig. 35).
Or, au
bout de la
36e seconde, nous apprenons que tout cela n’était
qu’un film regardé par une fillette (fig. 36).
Cependant, par un curieux cas de métalepse, le monstre se
retrouve dans la salle et poursuit la jeune fille qui se
réfugie dans un musée jouxtant le
cinéma. Malheureusement pour elle, elle se fera croquer et
se transformera en monstre. Le gardien du musée –
le même qu’au début –, venu
voir ce qui se passait, se retrouve nez à nez avec le mutant
qui le poursuit de plus belle (fig.
37). Nouveau
déboîtement : tout cela
n’était qu’un film. Et nous
revoilà dans la salle de cinéma où se
trouve toujours la même fillette qui se fera poursuivre par
le même monstre (fig.
36). La mise en abyme infinie est donc
rétro-prospective en cela qu’elle rappelle et
annonce ce qui arrive.
Spaceballs
(M. Brooks, 1987) nous permettra enfin de passer de la mise en abyme
infinie rétro-prospective à la mise en abyme
infinie instantanée. Un peu après la
trentième minute du film, les protagonistes Dark Helmet
(Rick Moranis) et Colonel Sandurz (George Wyner), afin de savoir
où se cache la princesse Vespa (Daphne Zuniga)
qu’ils poursuivent, décident de visionner le film Spaceballs
(fig.
40)
qu’ils ont réussi à
dégoter (avant même sa sortie en salle !). Cette
image aurait suffi à nous donner une mise en abyme infinie.
Or, nos protagonistes décident de regarder, en
accéléré (fig.
39),
tout le
début du film auquel nous avons déjà
assisté (fig.
38). La mise en abyme infinie
imagée est ici clairement rétrospective.
Cependant,
nos personnages arrivent inévitablement au moment du film
où ils regardent le film et où ils se verront
regardant le film, regardant le film, regardant le film…
nous offrant ainsi un superbe « vidéo
feed-back » (fig.
41) qui ressemble
d’ailleurs aux publicités dont nous avons
parlé plus haut.
Ainsi, les
fameuses publicités vers lesquelles Dällenbach
s’était spontanément tourné
pour illustrer avec plus d’éloquence ce
qu’il entendait par mise en abyme infinie
n’étaient que des cas de mises en abyme
imagées instantanées. Dans Airplane II
: The Sequel (K. Finkleman, 1982), le capitaine McCroskey
(Lloyd Bridges) revient, le temps d’une pause, se planter
devant une photo de lui-même dans la même position
avec, derrière lui, encore une fois, une photo de lui dans
la même position, et ainsi de suite (fig.
42). Dans Ed
TV (R. Howard, 1999), un téléviseur
nous renvoie, à l’infini, l’image du
jeune Eddy Pekurny (Matthew McConaughey), filmé en direct,
lors de son passage à l’émission de Jay
Leno (lui-même), par les caméras de
télévision qui le suivent 24 heures sur 24 (fig.
43). Deux autres
téléviseurs
placés
« en abyme » des films The
Game (D. Fincher, 1997,
fig. 44) et Inland Empire
(D. Lynch, 2006,
fig. 45) nous offrent aussi, d’un seul
coup
d’œil, des mises en abyme infinie
instantanées.
* * *
Nous avons tenté, en passant de la mise en abyme littéraire (essentiellement « textuelle ») à la mise en abyme cinématographique – et plus précisément à la mise en abyme « imagée », c’est-à-dire celle se manifestant par une image dans le film et par l’image du film – d’exemplifier, après avoir exposé les trois types recensés par Lucien Dällenbach – simple, infini et aporétique –, les diverses modalités temporelles auxquelles les deux premiers types pouvaient donner naissance : prospectives, rétrospectives, rétro-prospectives, simultanées et instantanées. Il serait éventuellement intéressant de se questionner sur le type d’informations que nous donne chacune de ces configurations dans l’interprétation du film : s’agit-il d’un indice qui nous est révélé, de l’état d’esprit du personnage qui nous est dévoilé, etc. La « boucle programmatique », la « coda », le « pivot » et l’« arrière-fond » induisent-ils tous la même lecture ? Quelles sont leurs fonctions et leurs effets ? Ces configurations cherchent-elles à rompre ou à entretenir l’illusion filmique ? Cherchent-elles à s’afficher ou à s’effacer comme artifice ? Dans quel « sens » se manifestent ces réflexions ? Sont-ce les œuvres dans l’œuvre qui reprennent ce que les personnages ont fait, font ou feront, ou bien les personnages qui reprennent l’essentiel de ce que l’œuvre dans l’œuvre nous a donné, nous donne ou nous donnera à voir ? On voit la réflexion, presque infinie, à laquelle nous invitent ces divers jeux de miroirs.


