[50] V, 9, Ibid., p. 726.
[51] Ibid., p. 903-904. Sur cette image, voir notamment N. Ferrand, « Hamlet dans La Nouvelle Héloïse. La leçon d’arts visuels de Gravelot à Rousseau », French Studies, 67.4, octobre 2013, pp. 494-507.
[52] Voir la première ici et la seconde ici (consulté le 5 février 2023).
[53] Lettre de Rousseau à François Coindet, 13 février 1761 (CC n° 1286).
[54] On songera à cette remarque de Rousseau au livre XI des Confessions : « L’aspect du monstre le plus hideux m’effrayerait peu, ce me semble ; mais si j’entrevois de nuit une figure sous un drap blanc, j’aurai peur. Voilà donc mon imagination, qu’allumait ce long silence, occupée à me tracer des fantômes » (Confessions, livre XI, éd. A. Grosrichard, Paris, GF-Flammarion, 2002, t. 2, p. 330).
[55] La Nouvelle Héloïse, VI, 11, éd. cit., p. 856.
[56] S. Lojkine, « Représenter Julie : le rideau, le voile, l’écran », introduction à L’Ecran de la représentation, Paris, L’Harmattan, « Champs visuels », 2001.
[57] Voir J. Starobinski, Jean-Jacques Rousseau : La transparence et l’obstacle, Paris, Gallimard, 1971 (en particulier le chapitre V) et J. Berchtold, « Le voile est déchiré », dans Sources et postérités de la Nouvelle Héloïse de Rousseau. Le modèle de Julie, sous la direction de G. Goubier et S. Lojkine, Paris, Desjonquères, 2012, pp. 64-80.
[58] Confessions, livre IX, éd. cit., t. II, p. 181.
[59] Cl. Labrosse, Lire au XVIIIe siècle : La Nouvelle Héloïse et ses lecteurs, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985, p. 213 (en ligne. Consulté le 5 février 2023).
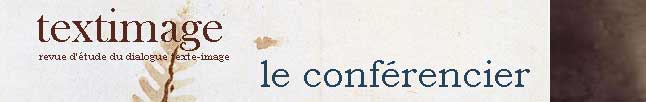
Le hors-champ et l’esthétique de la suggestion
dans l’illustration du roman au XVIIIe siècle :
l’exemple de La Nouvelle Héloïse
- Christophe Martin
_______________________________

Fig. 9. Gravelot et J. Ouvrier, « Où veux-tu
fuir ? Le Fantôme est dans ton cœur », 1764 

Fig. 10. Gravelot et N. Le Mire, « L’inoculation
de l’amour », 1764 

Le rêve
La 10e estampe fait, elle aussi, entendre une voix énigmatique : « Où veux-tu fuir ? Le Fantôme est dans ton cœur » (fig. 9). Contrairement à ce que l’on pourrait supposer, il ne s’agit pas d’une citation du roman : Edouard ne prononce nullement cette phrase lorsqu’il tente d’apaiser l’agitation de St. Preux réveillé en pleine nuit par un cortège d’« images funèbres » qui le conduisent « de fantôme en fantôme » jusqu’à la vision obsédante de Julie expirant dans son lit, le visage recouvert d’un voile [50]. Cette hallucination annonce bien sûr la mort de Julie. Le sujet de l’estampe est ainsi décrit par Rousseau :
Une chambre de cabaret. Le moment : vers la fin de la nuit. Le crépuscule commence à montrer quelques objets ; mais l’obscurité permet à peine qu’on les distingue.
L’ami qu’un rêve pénible vient d’agiter, s’est jeté à bas de son lit, et a pris sa robe de chambre à la hâte. Il erre avec un air d’effroi, cherchant à écarter de la main des objets fantastiques dont il paraît épouvanté. Il tâtonne pour trouver la porte. La noirceur de l’Estampe, l’attitude expressive du personnage, son visage effaré doivent faire un effet lugubre et donner aux regardans une impression de terreur. Inscription de la 10e Planche. Où veux-tu fuir ? Le Fantôme est dans ton cœur [51].
Le sujet de l’image, qui représente un moment d’hallucination et d’épouvante, se caractérise à nouveau par un choix compositionnel d’autant plus remarquable si on le compare à ceux d’images à peu près contemporaines représentant le cauchemar de Lovelace dans la Clarissa du Novelist Magazine, ou encore celui d’Edmond dans Le Paysan perverti de Rétif [52]. Contrairement aux choix opérés par Stothard et Binet, « l’estampe des fantômes » [53], comme la désigne Rousseau, prend soin de représenter l’agitation et la hantise de St Preux, aux prises avec ses propres chimères, mais de ne pas représenter les objets « fantastiques » qui l’assaillent, suggérant que la vision fantasmatique excède le cadre de l’estampe. Dans un roman qui revient de manière obsédante sur la question de la hantise et de la présence fantomale de l’objet dans le phénomène de la passion amoureuse, il est essentiel, selon les principes esthétiques de Rousseau, que ces « objets fantastiques » restent invisibles pour le spectateur, secrètement invité à se les figurer [54]. Le « voile redoutable » lui-même, qui recouvre la figure de Julie et que St Preux s’efforce vainement d’écarter, n’est représentée que métaphoriquement par le mouvement inquiétant des rideaux du lit, au-dessus desquels on discerne une végétation tourmentée, l’espace de la chambre semblant s’ouvrir vers un arrière-fond ténébreux et onirique. Rousseau ménage en outre un écho visuel avec la 5e estampe, « L’inoculation de l’amour » (fig. 10) qui représente ce que Julie a cru être une hallucination, mais qui s’est bel et bien produit dans la fiction, ainsi que Claire le lui révèle peu après.
Le voile
La douzième et dernière estampe de la série, nul ne s’en étonnera, se garde de représenter la mort de Julie (fig. 11). L’instant de la mort réelle, rappelons-le, a seulement a été saisie à la dérobée, au milieu de la nuit, par Wolmar se précipitant dans la chambre au moment précis où Julie expire dans les bras de sa cousine Claire : « je vois les deux amies sans mouvement et se tenant embrassées ; l’une évanouie, et l’autre expirante. Je m’écrie, je veux retarder ou recueillir son dernier soupir, je me précipite. Elle n’était plus » [55]. Rousseau lui substitue, en effet, la mise en scène de sa « seconde » mort, symbolique et publique. Comme l’a souligné Stéphane Lojkine, la seconde mort « se représente ensuite, dans ce qui tient lieu d’un rituel laïcisé de mise au tombeau, en présence de la collectivité réunie » [56]. Julie vient de mourir, et pour dérober son corps, qui commence « à se corrompre », à la superstition grossière du peuple qui l’entoure et croit en sa résurrection, Claire est allée chercher un voile d’or brodé de perles que Saint-Preux a rapporté des Indes. S’apprêtant à en recouvrir le visage de Julie, Claire s’écrie : « Maudite soit l’indigne main qui jamais lèvera ce voile ! maudit soit l’œil impie qui verra ce visage défiguré ! ».
On sait l’importance de la thématique dans l’œuvre de Rousseau [57], mais la mort de Julie est l’un des rares textes où le voile est un objet concret et non une pure métaphore. Sa position centrale dans l’image n’est évidemment pas innocente : toute la scène s’organise autour de ce rite du voilement, qui doit tout à la fois dissimuler le corps mort de Julie et manifester sa présence sacrée : c’est peut-être à l’impossible empreinte du visage sur ce nouveau Saint suaire que se confronte l’imaginaire de Rousseau, et que laisse imaginer la figure. Tout en signifiant la mort et la séparation, le voile les occulte.
L’obstination de Rousseau à accompagner l’œuvre d’images gravées n’est sans doute pas sans rapport avec la genèse (fût-elle plus ou moins romancée) d’une fiction romanesque tout entière dérivée de la puissance de l’imaginaire et de la force obsédante de certaines visions. On se rappelle, en effet, la manière dont Rousseau évoque, au livre IX de ses Confessions, la genèse de sa Julie :
Je me figurai l’amour, l’amitié, les deux idoles de mon cœur, sous les plus ravissantes images. Je me plus à les orner de tous les charmes du sexe que j’avais toujours adoré. (…) Je ne voulais ternir ce riant tableau par rien qui dégradât la nature [58].
Si la puissante efficace de l’image mentale est donc consubstantielle à l’invention même de La Nouvelle Héloïse, si le roman en déploie par ailleurs toutes les ressources au sein même de la fiction (on sait notamment que, dans toute la seconde moitié du roman, la thérapie de l’oubli conçue par Wolmar à l’intention des anciens amants consiste en une incessante substitution d’images, celles de Julie de Wolmar devant effacer celles de Julie d’Etange dans la mémoire de Saint-Preux), l’esthétique de Rousseau implique d’éviter toute représentation de ces images fondatrices du récit. Telle est bien la caractéristique la plus frappante de la série d’estampes dessinées par Gravelot, ainsi que Claude Labrosse l’a justement observé :
Le baiser n’est pas dans la première estampe, la scène de débauche est absente de la quatrième, le rêve est invisible dans la dixième comme est invisible, dans la cinquième (où cependant paraît le baiser), le fait que la scène peut se donner comme un songe. Le silence ne s’aperçoit pas dans la neuvième. Les images gravées sont elles-mêmes une sorte de voile qui recouvre les réalités du sexe et de la mort [59].
Loin d’être un essai de représentation de ces images dans lesquelles s’originerait la fiction, l’illustration de La Nouvelle Héloïse doit être conçue comme une invitation à se les figurer.