[39] Lettre à Mme d’Houdetot, 26 déc. 1757, CC n° 595.
[40] « Julie, ou lettres de deux amans, habitans d’une petite ville aux pieds des Alpes », par Jean-Jacques Rousseau, manuscrit autographe, Bibliothèque et Archives de l’Assemblée nationale, P 7077 (en ligne. Consulté le 5 février 2023).
[41] « Sujets d’estampe », La Nouvelle Héloïse, éd. cit., p. 902.
[42] Laocoon, chap. V, trad. J. Bialostocka, Paris, Hermann, 1964, p. 70.
[43] « Sujets d’estampe », La Nouvelle Héloïse, éd. cit., p. 895.
[44] E. Décultot, « Le Laocoon de Gotthold Ephraïm Lessing », art. cit., p. 203.
[45] « Sujets d’estampe », La Nouvelle Héloïse, éd. cit., p. 897.
[46] P. Griener, « Gravelot au service de Rousseau et de Voltaire : deux visions opposées de l’illustration », dans Rousseau et les arts visuels, Op. cit., p. 388.
[47] La Nouvelle Héloïse, V, 13, éd. cit., p. 744.
[48] « Sujets d’estampe », La Nouvelle Héloïse, éd. cit., p. 904.
[49] En entrant dans sa chambre, Wolmar la trouve « se tordant les mains et mordant les pieds des chaises, murmurant d’une voix sourde quelques paroles extravagantes, puis poussant par longs intervalles des cris aigus qui faisaient tressaillir » (Ibid., pp. 856-857).
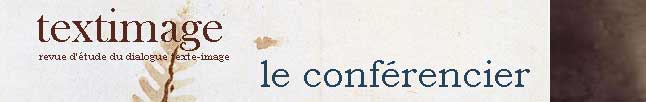
Le hors-champ et l’esthétique de la suggestion
dans l’illustration du roman au XVIIIe siècle :
l’exemple de La Nouvelle Héloïse
- Christophe Martin
_______________________________

Fig. 4. Gravelot, « Le premier baiser de
l’amour », s. d. 

Fig. 5. Gravelot et P.-Ph. Choffard, « Les
monuments des anciennes amours », 1764 

Fig. 6. Gravelot et N. Le Mire, « Le premier
baiser de l’amour », 1764 

Fig. 7. J.-M. Moreau et N. Le Mire, Le Premier
baiser de l amour, 1774 

Fig. 8. Gravelot et N. Le Mire, « Claire !
Claire ! Les enfants chantent la nuit quand
ils ont peur », 1764 
Dans cette esthétique de la suggestion, la couleur n’est pas vertueusement écartée en raison de sa séduction perverse ou de son immoralité (selon un argument récurrent des anticoloristes à l’âge classique). Idéalement, elle doit au contraire, en amont de l’exécution, guider l’imagination de l’artiste de manière à produire un effet oblique mais non moins puissant sur le spectateur. Les sujets d’estampes, explique Rousseau à Mme d’Houdetot, ne doivent pas être « exécutés à la lettre ». Ils décrivent non pas « ce que le dessinateur doit rendre, mais ce qu’il doit savoir afin d’y conformer son ouvrage autant qu’il est possible. Tout ce que j’ai décrit doit être dans sa tête » [39]. Aussi les figures dont rêve Rousseau ne sont-elles pas définies d’abord par la netteté du trait : visant à produire une sorte de vibration chromatique purement mentale, elles doivent permettre à l’artiste de solliciter l’imagination visuelle du spectateur, par la médiation du burin. L’artiste doit user du noir de la gravure non seulement pour graduer son intensité et accentuer parfois « la noirceur de l’estampe » (c’est le cas en particulier de la 15e planche : « Où veux-tu fuir ? le fantôme est dans ton cœur », NH, t. 2, p. 439), mais aussi pour suggérer ou plus exactement sans doute suppléer métaphoriquement les couleurs qui font défaut à la gravure.
Le cadre
Que la question du cadre ait été essentielle aux yeux de Rousseau, rien ne l’atteste mieux sans doute que le soin accordé à l’encadrement doré des dessins préparatoires au trait et à l’encre de Gravelot dans la copie manuscrite du roman offerte à la Maréchale de Luxembourg [40] (fig. 4). Ce n’est pas à la représentation « directe » d’une scène de la fiction que l’on assiste mais bien à la représentation d’une image exhibée comme telle, dont l’encadrement presque ostentatoire incite à donner toute son importance à la question du cadre et du hors-cadre. On remarquera notamment qu’il arrive à Rousseau d’insister sur la nécessité pour l’artiste d’inviter à un prolongement imaginaire ouvrant vers un hors-champ qui se laisse deviner dans l’arrière-plan de l’image. Ainsi, dans le sujet de la célèbre gravure intitulée « Les monuments des anciennes amours », Rousseau recommande de dilater les espaces pour que le lecteur puisse promener son regard en jouant sur ce qu’au cinéma on appellerait la « profondeur de champ » :
il faut ajouter à cette description (…) que dans la perspective des côtés du pays de Vaud qu’on voit dans l’éloignement, on distingue sur le rivage des villes de distance en distance, et qu’il est nécessaire au moins qu’on en apperçoive une vis à vis de l’esplanade ci-dessus décrite [41] (fig. 5).
Le moment
Comme on l’a vu à propos de la couleur, l’imagination, chez Rousseau, joue un rôle central non seulement dans la réception mais dans la production même de l’œuvre. A bien des égards, Rousseau anticipe nettement le fameux axiome de Lessing selon lequel « cela seul est fécond qui laisse un champ libre à l’imagination » [42]. Aussi importe-t-il de ne pas représenter l’instant paroxystique, mais au contraire l’instant fécond qui laisse deviner ce qui précède et imaginer ce qui suit :
Dans les figures en mouvement, il faut voir ce qui précède et ce qui suit, et donner au temps de l’action une certaine latitude ; sans quoi l’on ne saisira jamais bien l’unité du moment qu’il faut exprimer [43].
Comme chez Lessing, « aucun instant ne jouit en effet moins du privilège de stimuler l’imagination que la représentation du stade ultime de l’affect » [44]. Ainsi dans « Le premier baiser de l’amour », c’est l’instant figé de l’après-coup que Rousseau commande à l’artiste de saisir :
Le lieu de la scène est un bosquet. Julie vient de donner à son ami un baiser cosi saporito*, qu’elle en tombe dans une espèce de défaillance. On la voit dans un état de langueur se pencher, se laisser couler sur les bras de sa cousine, et celle-ci la recevoir avec un empressement qui ne l’empêche pas de sourire en regardant du coin de l’œil son ami. Le jeune homme a les deux bras étendus vers Julie ; de l’un, il vient de l’embrasser, et l’autre s’avance pour la soutenir : son chapeau est à terre. Un ravissement, un transport très vif de plaisir et d’alarmes doit régner dans son geste et sur son visage. Julie doit se pâmer et non s’évanouir. Tout le tableau doit respirer une ivresse de volupté qu’une certaine modestie rende encore plus touchante.
Inscription de la 1ère Planche*.
Le premier baiser de l’amour [45].
L’estampe a pour fonction de fixer le moment qui suit le baiser, de capter l’effet qu’il produit, de saisir la sensation au seuil de sa transformation en mémoire et récit (fig. 6). C’est dire que le choix compositionnel de Rousseau impose à Gravelot une esthétique de l’ellipse et de la litote : ce baiser qui marque de son empreinte irréversible le destin des trois personnages et dont l’ombre portée s’étend jusqu’au dénouement n’est présent, dans l’estampe, que dans l’inscription, Rousseau veillant à le soustraire au regard du spectateur. Car la règle qui prévaut chez Rousseau est que « l’effet visuel et émotif doit augmenter à proportion inverse de la perceptibilité du signe qui le cause » [46]. Le baiser est donc comme déplacé de son lieu, indiqué dans une image qui invite à se le figurer sans que l’œil puisse le percevoir, la figure gravée ayant pour fonction de faire entrevoir autre chose que ce qu’elle montre. Par contraste, la composition de Moreau le jeune, en 1774, rend d’autant plus significatif le choix du moment conçu par Rousseau : c’est bien l’instant du baiser passionné qui est représenté, dans toute son intensité (fig. 7).
La voix
Ce que l’estampe ne peut littéralement faire entendre, Rousseau tâche de le laisser imaginer en jouant notamment sur des effets de distorsion entre l’image et la légende, celle-ci faisant entendre une voix dont la source n’est pas textuelle, mais semble directement émanée de l’image elle-même. On songera notamment à légende de la 11e estampe, destinée à illustrer la lettre 2 de la sixième partie : « Claire, Claire ! Les enfants chantent la nuit quand ils ont peur » (fig. 8). La légende inscrite à l’extérieur du cadre fait entendre l’image, au sens d’un son émis hors-champ et non pas au sens d’une intellection puisque l’effet produit est au contraire énigmatique et oblige à se reporter à un hors-champ textuel bien antérieur. Le moment représenté dans l’image est, en effet, radicalement dissocié de la lettre dans laquelle figurent les mots dont la légende fait entendre un écho lointain et comme assourdi. C’est dans la lettre 5 de la cinquième partie que Julie, en effet, disait à Claire : « Tu fais avec l’amour dont tu feins de rire, comme ces enfants qui chantent la nuit quand ils ont peur » [47]. Or, l’image représente une scène ainsi décrite par Rousseau dans le sujet d’estampe :
Par terre est un échiquier renversé dont les pièces sont éparses. Claire, d’un air moitié suppliant, moitié railleur, présente au jeune homme la joue, pour y appliquer un soufflet ou un baiser, à son choix, en punition du coup qu’elle vient de faire [48].
La scène est toute de gaieté et de légèreté : elle est censée illustrer la conduite de Claire, prompte à voiler l’intensité de ses émotions par l’enjouement et le badinage. Mais en faisant entendre la voix de celle qui ne figure pas dans l’image, Julie, la légende laisse discerner la menace qui se profile à l’horizon de cette attitude conjuratoire. A la mort de Julie, qui fait l’objet de l’image suivante, le badinage laissera la place chez Claire aux marques du désespoir le plus absolu [49].