[22] J. Cerquiglini (trad. Monique Briand-Walker), « ‘Le Clerc et Le Louche’: Sociology of an Esthetic », Poetics Today, vol. 5, n° 3, 1984, pp. 479-491 (en ligne. Consulté le 20 octobre 2022).
[23] Voir F. Pomel, « La courtine chez Guillaume de Digulleville : une scénographie de la révélation et de l’incarnation du signe dans les Pèlerinages et Le Roman de la fleur de lys », dans Littérature et révélation. Espace et révélation, Littérales n° 45, 2010, dir. C. Croisy-Naquet, Université de Paris Ouest-La Défense, pp. 219-247.
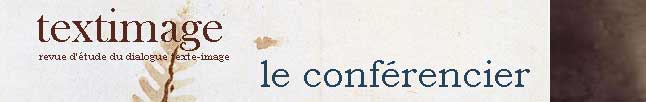
Voir en esprit ou par fiction : scène mentale
et points de vue dans trois songes allégoriques (Li Regret Guillaume, Le Dit de la fleur de lys
et La Déprécation pour Pierre de Brezé)
- Fabienne Pomel
_______________________________
Dans Li Regret Guillaume, le voyeur est de même autorisé à accéder à un « mistere » (v. 91). S. Menegaldo rapproche le dispositif spectatoriel du texte de l’« écoute dérobée » et de la « vision de biais » telles que J. Cerquiglini les définit dans « Le clerc et le louche » [22], où elle mentionnait d’ailleurs ce dit. Mais s’il s’agit bien d’une vision périphérique, on a affaire à un voyeur autorisé qu’on pourrait rapprocher d’un observateur derrière une vitre sans tain, puisqu’il voit depuis la périphérie sans être vu : « Tant qu’il te plest demeure Chi » (v. 470), lui propose d’ailleurs la demoiselle. Je me demande si on ne pourrait pas aussi voir dans ce voyeur un avatar du confident, l’œil et l’oreille fonctionnant sur une logique spéculaire : dès lors, le trou dans le mur n’opère pas tant comme une effraction, comme dans l’histoire de Pyrame et Thisbé, mais davantage comme vecteur ou signe d’une confidence qui émanerait d’un autre espace intérieur ou affectif, le cœur de la fille éplorée. « Et me contez tous vos courous », invite Débonaireté (v. 276).
Ce sont par ailleurs des voix fondamentalement hybrides qui s’expriment dans la série des personnifications : métonymie des qualités du défunt, les voix semblent venir d’outre-tombe ou d’un au-delà. Elles offrent un mélange de lamentation et de consolation où s’expriment à la fois le deuil de la fille et par voix et figures interposées, le cœur du clerc-témoin lui-même... Dans une telle perspective, la chambre sombre serait moins le tombeau du défunt qu’une chambre d’échos d’affects pluralisés, à la fois cœur et chœur. Avec ce dispositif spectatoriel du regard par le trou de la serrure, le clerc affiche simultanément une humilité face à Philippa et une fierté d’être son familier, une extériorité par rapport au deuil dans la posture de captation audio-visuelle et un partage de ce deuil. La posture originale du voyeur autorisé lui permet ainsi de formuler conjointement sur le mode de la transcription missionnée un panégyrique dans les plaintes et une consolation dans les ballades, le tout sur un registre simultanément distancié et compatissant. La spatialisation étrangement précise du point de vue viendrait alors asseoir l’esthétique allégorique comme expression d’une vision émanant du cœur, mais sous la tutelle d’une raison distanciée, vision paradoxale, tout à la fois intérieure et extérieure, affective et dé-subjectivisée.
Le Dit de la fleur de lys ou un parcours
du regard de l’opacité à la transparence
Le Dit de la fleur de lys scénarise d’une autre manière la vision comme révélation, en faisant succéder une révélation visuelle à la vision interdite doublée d’une ouïe autorisée devant la tente royale. La capacité visionnaire évolue au gré des postes d’observation et des changements de lieux, et au fil de l’itinéraire du narrateur intradiégétique. Le parcours du regard qui passe d’une vision entravée à une vision en transparence à travers la courtine met en scène un processus de dévoilement par désopacification du regard. Dans ce dit, ce sont des expériences lumineuses qui permettent à la vision de s’accomplir, suggérant une intervention transcendante, alors que dans le Pèlerinage de l’âme, c’est le parcours purgatoire qui, en purifiant le regard, permet d’accéder à la vision [23].
Mise en abyme et réflexivité du processus de visualisation : mode d’emploi
de la fiction allégorique et performances mentales spéculaires
Le regard redoublé : mises en abyme des regardants
Dans deux des textes, La Déprécation et Le Dit de la fleur de lys, le songeur se met en scène non seulement comme spectateur en train de regarder mais comme spectateur en train de regarder un personnage qui regarde. Cette mise en abyme du regard dans le songe invite à une expérimentation des points de vue.
Dans La Déprécation pour messire Pierre de Brezé, la posture mélancolique méditative est mise en abyme dans la scène vue : de même que le narrateur songeur-cadre est sur un lit, les deux personnifications qualifiées d’« ymages » (p. 38) – Noblesse humaine et Vertu – vues dans la pièce dépouillée de ses tentures sont « couchees des coudes chacune sur un quareau de velours noir, a mains soubs l’oreille, comme si tristesse et annuy grant les eust abatues » (p. 38). Comme le songeur mélancolique et angoissé, Noble Sang apparu dans la chambre est lui aussi triste et en larmes, et le songeur regarde ce jeune homme contempler le mobilier de la pièce. L’entrelacement des deux regards est patent :
Et piétant deux tours parmy la chambre, vis que appoyer s’aloit du dos à l’encontre du lit, et regardoit envers un mur, où avoit pendu a une perche une trompe de veneur, aucuns chapperons aussy d’oiseaux, et une espée garnie d’or pendant a un clou, et au dessous de la perche, un peu de costé regardoit fort aussy sur un buffet qui estoit là de moyenne hauteur, et sur lequel regardant asprement, je perçus lors que les larmes luy crevoient les yeux […] (DPB, p. 39)
Noble Sang, tout comme le songeur, est absorbé dans une activité contemplative, mémorielle et mentale, qui se poursuit lorsqu’il convoque des absents, en esprit, à qui il adresse ses « clameurs » (p. 61) : ce sont des personnifications (Fortune), des personnages historiques (le roi René, Simon de Lalaing, Juvénal des Ursins, le roi Louis XI, etc) ou encore des collectifs (princes, rois, ducs, ou cœurs féminins) ou des abstractions (les cieux) : « je ne voy que par fiction », remarque-t-il. Noblesse humaine, mère de Noble sang, commente cette absence d’auditeurs et l’artifice rhétorique de l’enargeia, qui consiste à placer sous ses yeux des images comme si on les voyait :
Quels acquest espoires-tu en la deprécation, qui n’as personne, ne ymage devant toy, qui te conçoive ? (DPB, pp. 63-64)
Selon un effet semblable de mise en abyme, le songeur du Dit de la fleur de lys voit le roi « acouté » dans la courtine, lequel contemple le signe offert et projeté. Là aussi, la posture de spectateur-contemplateur est dédoublée entre le narrateur témoin-spectateur et le personnage royal intradiégétique. Rien de tel en revanche dans Li Regret Guillaume.
Le cadre du songe en autorisant l’enchâssement des espace-temps et le dédoublement des diégèses favorise des dispositifs spéculaires entre les niveaux diégétiques et entre narrateur et personnages : le songeur se voit autre, voit l’autre comme miroir de soi ou encore voit l’autre en soi, thématisant ainsi la question du point de vue au sein du texte pour un lecteur invité à son tour à voir ou se figurer mentalement la scène allégorique.