
Paul Grimault, La Table tournante.
Métalepses
- Aurélie Barre et Olivier Leplatre
_______________________________
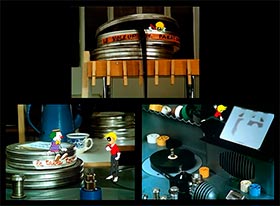
Fig. 18. P. Grimault, La Table tournante, 1988 
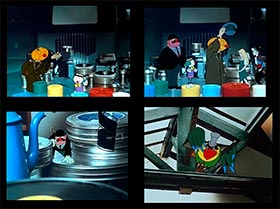
Fig. 19. P. Grimault, La Table tournante, 1988 

Grimault répète à chaque fois, sous des formes contiguës, la violence exercée contre les enfants innocents, contre ceux qui s’aiment et que la guerre a séparés : les films sont les exutoires successifs et lancinants de l’angoisse intérieure. Mais surtout, Grimault s’arrache à l’âpreté du monde réel pour inventer dans la fiction un monde qui donne le dernier mot au bonheur et aux retrouvailles : à la mécanique inquiétante répond la souplesse des corps et leur extrême plasticité, le battement d’aile (de plumes) de Gô suspendu à une corde, les acrobaties du voleur de paratonnerre, les circonvolutions du petit soldat... Les oiseaux, le couple blotti sous le chapeau de l’épouvantail, celui qui dialogue avec le joueur de flûte ou ceux qui, sur le toit, avancent maladroitement, l’un derrière l’autre, sous le regard de la bergère et du ramoneur, inversent la malédiction des rapaces partout présents.
L’orchestration du film cadre, le montage en écho des courts-métrages forment une réponse à la guerre moderne, aux bombes et aux obus destructeurs, envahissant Le Chien mélomane. La première animation, celle des oiseaux dessinés, percés au bec par les ciseaux devant le petit clown au moment de présenter la technique de l’animation, semble engager dès le début du film le parti pris de la fiction face au monde. L’appendice de métal qui a percé le papier est l’instrument d’une petite violence qui n’est que provisoire puisqu’elle provoque immédiatement la merveille. Outil par excellence du montage qui, dans un premier temps, fait éprouver le vertige de la disjonction et de la perte d’unité, les ciseaux participent de la fabrique d’une figure magique, l’oiseau, aérien et joyeux : il fait signe du film en train de se faire, que tout doit destiner au réenchantement, même s’il est mémoire imaginaire des vies souffrantes et d’une perception parfois amère de l’existence. Le sifflement de Grimault, qui accompagne musicalement ce premier atelier pratique revient, air de flûte ou de violon, ensorceler les images : partout la musique est dispensée, comme le marchand de notes du premier court-métrage l’essaime. A l’autre bout du film, dans le dernier court-métrage présenté au clown et aux autres visiteurs, le petit soldat actionne une clé située près du cœur : il déclenche ainsi, comme Grimault actionnant sa table de montage, à la fois la musique, certes fragile, et les pirouettes. La minuscule machinerie, qui ajoute les jouets mécaniques aux multiples sources de l’imaginaire de l’animation filmée, remplace celle des corps violents. L’œuvre de fiction, tournant sa clé, remonte une autre vie, une vie d’enfance, qui finit bien.
3. L’autobiographie animée
L’on pourrait croire que la présence intervallaire de Grimault à l’écran annonçant le programme, à la façon du bateleur du premier âge du cinéma, et explicitant les procédés de l’animation, relativise la charme ou nuit à son élan. Il n’en est rien, au contraire. Le fonctionnement du film dépend bien plutôt d’une tension permanente vers la fiction et même d’une aimantation de la réalité par la polarité fictionnelle. Chaque fois que Grimault assortit la projection de commentaires, il revient, ne serait-ce que pour illustrer son propos, à l’activité illusionniste des images. Qu’il dessine sur le mur une porte au feutre rouge et aussitôt le petit clown, lui-même intrus imaginaire dans le plan du réel, est invité à coller son œil au simulacre du trou de serrure ; une nouvelle séquence, spécialement imaginée pour La Table tournante, se forge alors sous ses yeux, qui relaient les nôtres [47’19-48’]. Le mur, obstacle naturel changé en écran poreux, est donc incapable de s’interposer face au désir de pénétration et d’infiltration des images : gagnées par une étrange fluidité, les surfaces ne sont plus étanches.
A l’instar du petit clown qui brouille avec gaieté les frontières du leurre, d’autres personnages surgissent sur le devant de la scène, traversent l’écran de la fiction afin quelquefois d’y retourner : le voleur de paratonnerres fait irruption dans le niveau cadre pour ensuite, en sautant dans l’écran, endosser son rôle dans le film dont il est le héros facétieux. Après lui, deux policiers, un épouvantail, le perroquet du Roi et l’Oiseau assurent la confusion et l’effervescence des plans (figs. 18, 19 et 20). Doués, semble-t-il, d’une vie propre, les personnages de Grimault s’installent sur la table de montage, repassent dans la visionneuse, s’agrandissent à l’échelle de l’image : « mais qu’est-ce que vous avez tous aujourd’hui » s’étonne dès le début, avec humour, Paul Grimault apparemment dépassé par cette expansion proliférante du syndrome de Pygmalion. Tout aura commencé par la survenue du petit clown tombé sur la table de montage. Grimault sort ses lunettes et, alors qu’il était coincé en boule dans la poche, le clown est libéré [2’’00-2’’10] : d’abord prisme kaléidoscopique, cristal d’images colorées, il se déplie, prend ou reprend forme avec son corps en accordéon, si proche du papier et déjà prêt à la danse de l’animation. René du désir de voir, dont les lunettes de Grimault sont la métonymie, le petit personnage donne l’impulsion de la fête des images ; il lance leur mouvement foisonnant qui, de la chute initiale, comme un tombé de la pellicule, prépare le défilement serpentin des films à travers les bobines de la table et leur redressement en images sur l’écran.
Promoteur en réalité de ces manifestations spirites et de ces acrobaties ludiques, Grimault n’échappe pas lui-même à la pulsion imageante qui gagne le réel. Au commencement du film, il se montre à nous sous la forme, comme gagnée par quelque sortilège, de l’ours à la casquette et à l’écharpe. Et c’est sous ses propres traits, mais en son personnage animé, qu’il quitte la pièce. Etrangement d’ailleurs, il ne part pas tout à fait dans le sens attendu [1’13]. Au lieu de s’éloigner, comme prévu, à droite de l’écran, symétriquement à son arrivée par la gauche sous la neige, il revient dans la direction initiale, quoique sous le climat du printemps. La fin du film aurait pu être marquée par la nostalgie de celui qui pressent avoir achevé son parcours et qui, avec le sentiment du devoir accompli, abandonne l’œuvre, puisque désormais les personnages savent si bien être indépendants et que le legs du cinéma leur a été transmis. Mais le film a tranquillement aidé Grimault à passer l’hiver pour atteindre le paysage ranimé par une pure atmosphère de fiction, dans laquelle il se fond ultimement et où désormais il prend place et se meut. Cette destinée est partagée par les autres protagonistes de l’aventure : chacun rentre, l’un dans une boite à bobine, l’autre dans la visionneuse ; l’épouvantail accompagne – adopte – le petit clown qui, venu d’un autre film, appartient pourtant fondamentalement au même monde que lui. Ce monde, Grimault ne le quitte pas, il ne le quitte plus, quelle que soit la réalité de la mort, ou en raison même de cette emprise de la finitude que son cinéma s’est attaché à représenter pour tenter de la déjouer.
![]()