
Soi disant… images
Jean-Marie-Gleize, le cycle de Léman
- Catherine Soulier
_______________________________
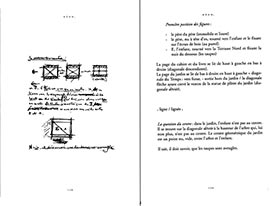
Fig. 1 . J.-M. Gleize, Néon, actes et légendes, 2004 

Avec, au premier chef, l’« énigme de la filiation », pour le dire avec la 4e de couverture de Film à venir, qui se déploie autour de deux figures familiales, paternelle et grand-paternelle.
Celle du père, HFG, pianiste et peintre amateur [19], revient de livre en livre avec une force de hantise. C’est qu’il est, par excellence, un revenant. Pour engendrer son fils, il lui a fallu revenir de Bavière où il avait été détenu longtemps pendant la Deuxième Guerre mondiale, dans un camp de prisonniers. Or ce lieu étant toujours affecté dans les livres du cycle des propriétés mêmes de la mort – le noir et le froid –, c’est en fantôme qu’aux yeux du fils le père en est revenu. A preuve le constat récurrent « Je suis né d’un quasi-mort » et le choix pour nommer ce quasi-mort d’une périphrase aux allures d’« épithète homérique » [20], « l’inconnu à tête d’os », qui fait basculer l’image réaliste de l’ex-prisonnier de guerre amaigri par les privations vers celle, monstrueuse, presque fantastique, d’un vivant à tête de mort. De l’aveu de Jean-Marie Gleize, « une partie de ce qu’[il] écri[t] est fortement marquée par une expérience de la mutité, celle de [s]on père qui a été durant cinq ans prisonnier de guerre en Allemagne et qui, de retour, avait pratiquement cessé de s’exprimer sur quoi que ce soit, qui communiquait très peu et qui refusait de parler de ces années-là » [21]. Le silence du père, donc l’absence d’un récit testimonial, ménage un vide narratif où pourrait se déployer la fiction du fils. Mais s’il arrive qu’un récit s’amorce, il reste fragmentaire et lacunaire, concentré en quelques lignes :
Il est parti sans connaître le chemin. Plus tard il s’est fait prendre. Il était là, devant le mur, immobile. J’entends les kilomètres dans le corps, leur battement, et les heures, la nuit sous bâches. Déposé un matin à la porte du chenil. Changé plusieurs fois de place. Déshabillé, rhabillé. Il mange debout sans rien dire. Il ne parle plus. A la fin il retourne [22]
voire condensé en une expression récurrente, « nuit de Bavière », où l’informe nocturne résume l’informulé (l’informulable ?) de l’expérience du stalag.
« Nuit de Bavière », c’est aussi le nom de ce que Gleize appelle une « transmission nocturne ». Celle de ces cinq années de captivité, de froid et de silence que le fils prétend « décisives pour [lui], parce qu’[il] sentai[t] bien qu’il [le père] les [lui] avait inoculées, transmises » [23]. Le lien de filiation est fantasmé comme un lien liquide, archaïque, un lien de sang, mais du sang vicié, perverti. Les figures médicales de l’inoculation et de la transfusion perdent en effet toute possible valeur curative pour dire la sensation d’une invasion pernicieuse du corps du fils par le noir, le froid et, en fin de compte, la mort à laquelle le père, revenu de guerre sans l’être [24], ne cesse d’appartenir.
Sa mort d’ailleurs hante le texte. Directement, par lambeaux de souvenirs – une chambre d’hôpital, les « mains de noir de cinq ans de pluie, 1940-1945 » [25] ouvertes de force après le décès qui les avait laissées fermées, la bouche violette –, ou indirectement, dans Film à venir, via des fragments de récits empruntés, l’un à un livre d’enfance, Ivik le petit Esquimau, l’autre à une enquête historique Minik, l’Esquimau déraciné. Deux histoires de fils confrontés à la mort du père. Dans le premier Ivik, l’enfant inuit, voit son père entraîné dans les profondeurs marines par un morse (animal dont le nom est opportunément homophone du latin mors). Dans le second, Minik, jeune Esquimau conduit à New York en 1897 avec cinq compatriotes adultes, voit tous ses compagnons, dont son père Qisuk, mourir de tuberculose et, neuf ans plus tard, découvre avec horreur le squelette de ce dernier dûment étiqueté dans une vitrine du Muséum d’Histoire naturelle de la grande ville américaine.
Si le père est placé de façon insistante sous les signes conjoints du « silence enfoncé comme un clou », de « l’eau glacée » et du noir de « la nuit de Bavière » [26], le grand-père paternel, HAG, surtout présent dans Tarnac, est défini par sa foi chrétienne marquée par une spiritualité particulière, franciscaine. Date de sa réception dans le Tiers-ordre, date de sa mort, fragments de son « Testament spirituel », extraits des cahiers de méditation qu’il a tenus de 1952 à 1958, citations de La Voie de pauvreté et bribes de récit tirés des 11 Fioretti de François d’Assise de Rossellini, tout cela permet de préciser le legs de celui que le cycle documentaire nomme « le père du père », un legs moins archaïque et moins charnel que celui de « l’inconnu à tête d’os », un legs qui passe par le livre plutôt que par le sang ou les fluides.
Un legs problématique toutefois. Car le catholicisme familial, rejeté longtemps comme un poids ayant pesé sur l’enfant, est d’abord l’objet d’une « violence anti-chrétienne » manifestée en « refus d’obéissance, violences verbales (…) lecture des livres interdits, refus de répondre, fuites diverses » et poussée jusqu’aux fantasmes de destruction matérielle (« incendie des “meubles” de l’église (confessionnal) » [27]). Plus tard, le communisme, vécu aux alentours de 1968 dans les rangs de l’extrême-gauche maoïste, vient moins opposer sa propre légende à celle des Fioretti que s’y nouer car, Jean-Marie Gleize le rappelle, son désir de révolution s’apparentait en mai-juin 1968 à « une exaltation en quelque manière mystique ou en tout cas religieuse, l’adhésion à quelque chose qui (…) pourrait s’entendre comme un idéal strictement égalitariste à coloration franciscaine » [28]. Et aujourd’hui encore, quand le « mot communiste », devenu « si lourd d’un poids de réalité concrète, précise et terrible, intolérable et incontestable » [29], se trouve redéfini comme « possibilité d’intensifier la joie », le recours au concept de « joie », central dans la spiritualité franciscaine, instaure, selon l’écrivain, une sorte de contact, de « frottement », entre « un idéal politique impossible et un idéal spirituel non moins compliqué » [30].
« Nuit de Bavière » et lumière ou « joie » franciscaine : deux sources. Le père et le grand-père paternel : deux jalons d’une histoire de soi commencée avant soi que questionne dans les divers livres du cycle une scène sans cesse retravaillée, la scène du jardin ou du carré. S’y met en place un système de relations optiques entre trois personnages, trois générations d’une même lignée : le fils (désigné « l’enfant »), le père (ainsi nommé) et « le père du père ». L’enfant est présenté tantôt lisant (Les Grandes espérances de Dickens, est-il précisé dans Néon,), tantôt fixant son regard sur un trou obscur sous la terrasse. Le père est occupé à peindre son fils, qu’il observe donc. Le « père du père », « immobile et lisant », regarde la scène. La chaîne des regards unit ainsi les trois protagonistes de cette histoire familiale : le « père du père » regarde son fils qui lui-même regarde le sien, lequel ne regarde rien de visible sinon du noir. Ou un livre. Dans ce dernier cas la chaîne optique relie un lecteur, « le père du père », à un autre, « l’enfant ». Avec laïcisation de la lecture puisque le premier lecteur lit la Bible, alors que le second lit un roman de Dickens. Entre les deux lecteurs s’interpose toutefois un peintre amateur (le père). Dans cette histoire de filiation et de transmission d’un ou plusieurs héritages, il faut, semble-t-il, faire la part de l’image. D’autant que la scène du jardin qui a pour point nodal une image peinte – en train d’être peinte – se constitue elle-même en image. Cliché photographique inexistant pris par un appareil purement verbal ou photogramme d’un film jamais tourné, capté par la seule caméra textuelle. Schéma des positions spatiales à la fois décrit et tracé dans les livres, soumis à variations tant scripturales que graphiques puisqu’il surgit tantôt griffonné (fig. 1), tantôt plus soigneusement élaboré (fig. 2).
[19] Néon le présente comme « le peintre des gazons, de l’église chemin de Rempnat, des sous-bois jaune-sec, huiles et craies », Op. cit., p. 140. Et Film à venir reprend textuellement cette désignation (p. 75).
[20] G. Mouillaud-Fraisse, « Tarnac, coïncidences », Faire part, no 26/27 Jean-Marie Gleize. La poésie n’est pas une solution, 2010, p. 138.
[21] J.-M. Gleize, Sorties, Op. cit., p. 430.
[22] Le Principe de nudité intégrale, Op. cit., p. 61.
[23] J.-M. Gleize, Sorties, Op. cit., p. 430.
[24] « Dis-leur que je ne suis pas revenu » est une formule leitmotiv.
[25] Le Principe de nudité intégrale, Op. cit., p. 72.
[26] Ibid., p. 61.
[27] Jean-Marie Gleize à Katy Remy, dans K. Remy, « Entretien avec Jean-Marie Gleize. Dialogue », Faire-part n° 26/27, 2010, p. 41. Pour cette « violence anti-chrétienne » voir en particulier Léman.
[28] J.-M. Gleize, Sorties, Op. cit., p. 432.
[29] Ibid., p. 372.
[30] « Jean-Marie Gleize. “Sortir du manège poétique” », entretien avec A. Paire. Zibeline (web radio), avril 2015 (consulté le 7 mai 2020).