
Le livre en ses miroirs :
entre mots et images
- Catherine Soulier
_______________________________

Fig. 14. P. Quignard et P. Skira,
Les Septante, 1994 

Fig. 15. P. Quignard et P. Skira,
Les Septante, 1994 

Fig. 10. Ed. Jabès et Raquel,
Des deux mains, 1976 

Fig. 16. Ed. Jabès et Raquel,
Des deux mains, 1976 
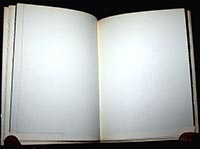
Dans le livre comme dans la peinture, le livre se donne d’abord dans sa réalité d’objet. Les pastels de Skira déclinent la forme du rectangle vertical (rectangle, à peine plus haut que large, du polyptyque ; rectangles, beaucoup plus étroits, des soixante-dix panneaux dont l’assemblage le constitue ; rectangles, plus étroits encore, que les pigments colorés déposent sur ces panneaux) en une inscription réitérée de ce qui pourrait apparaître comme une sorte d’idéogramme du livre, la forme rectangulaire étant celle, usuelle, du codex typographique (fig. 14). Partant, celle du livre des Septante lui-même, ainsi reconduit à son format spécifique, à la minceur de son dos. Rectangle parmi les rectangles. Mais rectangle singulier, comme l’est chacun de ceux qui viennent tour à tour incarner la même forme idéale, schématique jusqu’à en devenir abstraite. En représentant la diversité des modes d’assemblage, reliure ou brochage, celle des matières, cuirs ou papiers, en attaquant l’intégrité du livre afin de révéler, par les déchirures ou dans l’interstice créé par le décollement de la couverture, les fils, les cahiers assemblés, les panneaux de Skira exhibent la structure du codex. Abîmé, le livre met en abyme son être livre dont il montre les composantes matérielles, papier plié puis cousu ou collé, puis recouvert de peau ou de parchemin, ou de papier épais de couleur.
Quant au texte, sa mise en page singulière qui élargit considérablement les marges, rétrécissant et étirant d’autant le pavé typographique, favorise de nouvelles apparitions de la figure géométrique du rectangle vertical, tout en rendant à la page sa présence visuelle au delà ou en deçà de sa seule lisibilité. L’écho plastique entre rectangle étréci du texte et rectangle élancé de l’image où la verticalité propre à chaque panneau du polyptyque s’exalte du fait de l’isolement du détail dans le blanc impose la forme rectangulaire avec une force accrue (fig. 15). Mais, en décalage avec les pastels, le récit de Pascal Quignard évoque pour sa part les « soies écrites » et les « briques poinçonnées » collectées pour leurs maîtres par les émissaires des rois lagides, les « rouleaux de peau » des livres sacrés sur lesquels « la loi de Moïse était écrite avec des ors et dans les lettres carrées des Juifs », « admirable travail de parchemin aux raccords parfaitement dissimulés », ainsi que les « rouleaux de papyrus couverts de caractères grecs » par les soixante-douze traducteurs de la Torah. Tablettes et, surtout, volumen du texte, codex des images. Supports divers des signes d’écriture. Formes variables de ce que nous appelons « livre », que les Romains nommaient liber et les Grecs biblion, que nous ouvrons, que nous feuilletons, dont nous chargeons parfois les pages d’annotations marginales, en des gestes pour nous intimement associés à l’objet, sans penser que l’assemblage de feuilles sous couverture reliée ou brochée que nous manions fut d’abord une longue bande de parchemin ou de papyrus à dérouler latéralement, que nul de ses lecteurs n’ouvrit jamais, que nul ne feuilletait faute de feuillets, que nul n’annotait dans des marges absentes. En nous forçant à nous souvenir des mutations formelles que le livre a connues, Les Septante nous apprennent à le voir, donc à le penser dans sa spécificité formelle, matérielle, au lieu de le réduire, comme nous le faisons usuellement, à un support neutre.
Ce que l’on oublie trop souvent en lisant, que le livre est une chose physique, qu’il est fait de feuilles de papier assemblées, qu’il est forme et matière, Des deux mains le rappelle à sa manière. Non figuratives, les compositions de Raquel ne sauraient en aucun cas reproduire l’apparence du livre, qu’il soit volumen ou codex. Pourtant, elles contribuent à attirer l’attention sur la réalité concrète de l’objet. Sur le papier, par exemple, qui se découvre dans sa présence matérielle grâce à l’effet de dévoilement produit par l’agencement des feuillets de papier teint et des feuillets de vélin d’Arches. Le papier népalais teint en vert, en lui-même substance d’une notable richesse visuelle et tactile, ne voile qu’imparfaitement la page qui suit, laissant toujours deviner, en partie basse, une marge plus ou moins importante de vélin d’Arches (figs. 10 et 16). Une fois le voile vert soulevé, la page apparaît dans sa blancheur pour se donner immédiatement à percevoir comme une texture quand l’œil y découvre en léger relief deux lignes, l’une verticale, l’autre horizontale, qui redoublent deux des bords de la page, appelant aussitôt la vérification par le toucher, l’attestation par la pulpe des doigts d’un discret bourrelet (fig. 11  ). Puis le passage du recto au verso, qui permet de voir nettement le tracé gris au crayon dont l’œil et le doigt ne percevaient d’abord que la trace (figs. 12 et 13
). Puis le passage du recto au verso, qui permet de voir nettement le tracé gris au crayon dont l’œil et le doigt ne percevaient d’abord que la trace (figs. 12 et 13  ). La page est bien matière ; elle est surface et profondeur ou épaisseur, offerte au geste de la main.
). La page est bien matière ; elle est surface et profondeur ou épaisseur, offerte au geste de la main.
Car le livre, conformément à l’une des suggestions du titre, se réfléchit ici dans sa dépendance à la main qui le conduit, non sans violence, à prendre corps. Les mots en disent l’action, l’agression perpétrée contre le vocable qu’elle « fait saigner » ; ils la peignent en position d’écriture quand « la plume » tenue entre les doigts l’« entrouvre » ou la réduisent à un « poing serr[é] sur sa faim ». En regard, le travail du peintre, les déchirures du papier népalais, les tracés incisés dans l’épaisseur du vélin d’Arches, en attestent le passage. Alors que l’on pouvait spontanément les ramener à la main gauche et la main droite, la main désertée par le vocable qui la « sépare (…) de la main qui le forme » et la main d’écriture, celle qui « suffit au livre », les deux mains du titre se laissent donc identifier à chacune des mains créatrices, la main à plume et celle qui manie la mine de graphite, le crayon, peut-être inséparable, dans sa capacité d’agression, de son homonyme explosive.
Mais comment ne pas y voir aussi, en lisant le texte, d’autres mains ? Mains diurnes et mains nocturnes. Entre blanc et noir ; entre flamme puisqu’elles « brûlent avec le jour » et cendres, si la « nuit [en] est peut-être la consumation ». Entre vie et mort aussi ; commencement et fin ; élan inchoatif vers ce demain, dont, à deux et contenant ainsi « tout le matin », elles sont homonymes, et crispation lorsque chacune d’elles « serrée sur sa faim » se ferme en « poing », hiéroglyphe de son homonyme typographique, le « point » ici assimilé au « trou vertigineux de toute fin ».
Le livre alors, résolument physique – son noir et son blanc, encre et papier –, se révèle simultanément irréductible à sa provisoire incarnation. On pense à la définition que Jabès, dans Ca suit son cours, le premier volume du Livre des Marges, emprunte à un rabbin kabbaliste pour la détourner, dit-il, de son sens mystique originaire : « Le Livre serait cela qui “est gravé avec le noir du feu sur le blanc du feu”. Feu noir sur feu blanc » [16]. Le lien affirmé de l’écriture à la flamme, vitale sans doute mais surtout mortifère, éclairante mais dévorante, l’ouvre à une autre dimension, celle de la négativité foncière de l’activité dont il est le produit. La plume « poignard », l’encre « sang », le point « trou vertigineux de toute fin », béance tombale, « abîme » dans lequel « verse » « l’univers », une fois qu’il a « travers[é] la main » écrivante : les métaphores nouent obstinément l’écriture à la mort.
Ou aux morts. Car dans ces « mains qui brûlent », dans leur « consumation », dans la difficulté à éviter de « confondre cendre et ombre », il y a sans doute autre chose que la figure de ce qui, dans l’écriture, conjoint le « feu vivant de la création » [17] à la souffrance, la folie, la perte. Il y a « ceux à qui on a ôté le droit de vivre ». Tels sont les premiers mots du livre. Et ces mots sont des morts. Une foule de corps partis en fumée dans les crématoires ; une foule de spectres. La main, par l’écriture, prend en charge ce peuple innombrable de fantômes, victimes anonymes de la Shoah, victimes des persécutions antérieures. Dans le geste pour former les mots qui revendiquent « leur droit (…) à une pensée », elle pense elle-même l’inacceptable de leur spoliation ; dans la trace qu’elle laisse sur la page, elle y fait penser. Ainsi leste-t-elle le livre, ce « lourd fardeau », de tout le poids de la mémoire.
![]()