
Peindre la lecture, lire la peinture
- Nausicaa Dewez
_______________________________
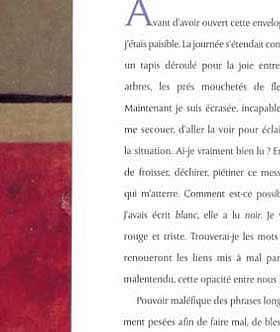
Fig. 4. Colette Nys-Masure, Célébration de la lecture,
pp. 82 et 83 (détail) 
Alors que Van Strydonck représente une jeune fille lisant à une femme plus âgée une lettre dont la peinture nous dissimule le
contenu, Nys-Mazure imagine (et écrit) les pensées de l’écouteuse et les paroles qu’elle adresse à l’autre personnage : le texte
« reproduit et invente des paroles inexistantes, imprononçables, impossibles, indicibles, fictives, des personnages dessinés d’une image muette »
[26], et « fait (arbitrairement) parler » [27] l’image à laquelle il se
réfère. Écrivant à propos d’un tableau, l’auteure investit le silence inhérent au pictural pour faire parler l’image. Philippe Hamon, constatant
la récurrence de ce procédé sous la plume des écrivains d’art, conclut que l’inexistence des images parlantes (à l’exception peut-être de
l’image cinématographique) ouvre la voie aux « images parlées ». Les textes qui font parler les images - ceux de Nys-Mazure en sont un exemple significatifs
- s’apparentent dès lors à un exercice de ventriloquie. Le peintre représente un personnage qui semble parler, mais, en raison du silence de la peinture, ses mots sont ceux
que lui prête un(e) écrivain(e) les inventant à sa guise.
La parole donnée au personnage n’est pas le seul point de glissement du texte par rapport au tableau. Alors que la scène peinte ne
représente nécessairement qu’un seul instant d’une action qui, dans le réel, est d’une durée relativement longue (d’autant que les tableaux ici
commentés représentent tous des scènes de lecture), Nys-Mazure imagine les faits qui ont précédé ce moment et ceux qui suivront. Cette manière de
traiter les tableaux, fréquente dans Célébration de la lecture [28], inscrit la représentation picturale dans une
fiction (embryonnaire) en la situant dans un continuum temporel. Ainsi le texte consacré à Misia à son bureau de Vallotton
(fig. 4) [29] :
Avant d’avoir ouvert cette enveloppe, j’étais paisible. La journée s’étendait comme un tapis
déroulé pour la joie entre les arbres, les prés mouchetés de fleurs. Maintenant je suis écrasée, incapable de me secouer, d’aller voir pour
éclaircir la situation. Ai-je vraiment bien lu ? Envie de froisser, déchirer, piétiner ce message qui m’atterre. J’avais écrit blanc, elle a
lu noir. Je vois rouge et triste. Trouverai-je les mots qui renoueront les liens mis à mal par ce malentendu, cette opacité entre nous ?
Pouvoir maléfique des phrases longuement pesées afin de faire mal, de blesser peut-être irrémédiablement [30].
Étudiant la critique d’art du XVIIIe siècle, Christian Michel montre que beaucoup d’écrivains éprouvaient le besoin de
couler leurs comptes rendus de tableaux dans une histoire, une anecdote dont la scène peinte ne représentait que l’un des moments, nombre de ces littérateurs se montrant
même hostiles aux œuvres picturales qui « ne racontent rien » [31]. Avec Célébration de la lecture,
on voit que ce réflexe de l’écrivain d’art de fondre le pictural dans un modèle proprement littéraire demeure vivace - à une époque
où la doctrine de l’Ut pictura poesis n’est pourtant plus qu’un lointain souvenir et où la peinture abstraite s’est désormais banalisée
dans le champ artistique.
La mise en histoire des scènes peintes a deux effets contradictoires. Elle contribue tout d’abord à l’autonomisation du texte,
puisqu’elle le détache de la stricte traduction du visible et donne à lire une fiction, texte se suffisant à lui-même ; elle suggère ainsi une limite de
la peinture - ou un des attraits de la littérature. Cependant, dans le même temps, la « fictionalisation » suggère que le peintre a « donné
vie » à ses personnages. La qualité illusionniste de la peinture invite l’auteure à dépasser le strict plan du représenté, pour imaginer un
au-delà du cadre - au-delà qui n’est d’ailleurs pas uniquement temporel, mais aussi spatial, comme le montre notamment le commentaire du Monet lisant de Renoir [32] :
Dans le brouillard confortable du tabac, du nuage odorant, homme captivé par le quotidien déployé. (...) Dehors il fait froid sans doute. Ici s’épanouit la volupté, celle des volutes qui ne dérangent personne dans le café [33].
Les textes consacrés aux tableaux de Van Strydonck, Vallotton ou Renoir [34] débordent encore ce que
donnent à voir leurs référents, en prêtant aux personnages une intériorité, une psychologie que la peinture ne saurait rendre avec exactitude. De telles
précisions orientent donc elles aussi le texte vers une autonomie par rapport au pictural, affirmant sa littérarité et l’égalant aux œuvres d’art dont
il découle pourtant.
Dans le texte « Décrire, suggérer », Nys-Mazure écrit vouloir « ménager (...) une chute »
[35] à ses textes - et la plupart se conforment à cet objectif. Telle est peut-être la manifestation la plus emblématique de cette
littérarisation des scènes picturales. Le principe même de la chute repose en effet sur la progression linéaire propre à la lecture du texte : un tableau ne
saurait avoir de chute [36].
Investissant les aspects de la scène de lecture laissés invisibles par la peinture, les textes de Nys-Mazure ne sont pas seulement des commentaires
des tableaux, mais aussi des méditations en acte sur les différences entre littérature et peinture.
Par d’autres côtés, ces textes affichent, par contre, un souci de fidélité à la représentation picturale, en
tentant ainsi de maintenir un équilibre entre ce que nous avons appelé, à la suite de J. Lichtenstein, les exigences rhétorique et philosophique.
[27] Ibid. Hamon souligne.
[28] Cf. par exemple le texte consacré à La Lettre de Mary Cassatt (1891, Washington, National Gallery of Art) : « Le sort en est jeté, je ferme l’enveloppe puis j’irai la poster. C’est la toute dernière lettre. Nous n’échangerons plus de messages [...] » (C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 87). Également à propos de La Liseuse de Claude Monet (1872, Baltimore, Walters Art Museum) : « Barbouillée de rêve, elle rentrera au couvert de la maison bourgeoise, bruissante des parfums du soir, un pétale accroché au bouton du corsage » (Ibid., p. 97).
[29] Félix Vallotton, Misia à son bureau, 1897, Saint-Tropez, musée de l’Annonciade.
[30] C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 83. Nys-Mazure souligne.
[31] Chr. Michel, « Comment plier le tableau à la description ? Scènes de la vie quotidienne et verbalisations dans la France du XVIIIe siècle », dans La Description de l’œuvre d’art. Du modèle classique aux variations contemporaines, op. cit., pp. 187-200.
[32] Auguste Renoir, Claudel Monet lisant, 1880, Paris, musée Marmottan.
[33] C. Nys-Mazure, Célébration de la lecture, op. cit., p. 51. Nous soulignons.
[34] Cette tendance s’observe également dans d’autres textes du livre. Cf. notamment le commentaire des Inséparables de Florence Fuller (Adélaïde, Art Galler of South Australia) : « Elle lit. (...) Le désir s’empare d’elle : chevaucher, sauvagement, en nature vierge, au lieu de moisir au sein de cette maison calfeutrée, toujours trop chauffée [...] » (Ibid., p. 138).
[35] Ibid., p. 7.
[36] Une chute pourrait par contre se concevoir dans le cas d’une suite de tableaux formant une histoire, ce qui confirme par ailleurs qu’elle n’existe (essentiellement) qu’en régime narratif.


