
Soi disant… images
Jean-Marie-Gleize, le cycle de Léman
- Catherine Soulier
_______________________________

Fig. 14. J.-M. Gleize, Néon, actes
et légendes, 2004 
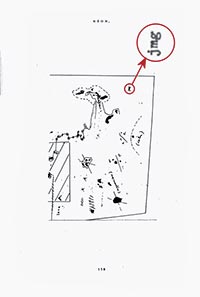
Fig. 15. J.-M. Gleize, Néon, actes
et légendes, 2004 

Fig. 16. J.-M. Gleize, Tarnac, un acte
préparatoire, 2011 

Fig. 17. J.-M. Gleize, Tarnac, un acte
préparatoire, 2011 

Fig. 18. J.-M. Gleize, Tarnac, un acte
préparatoire, 2011 

Fig. 19. J.-M. Gleize, Le Livre des cabanes.
Politiques, 2015 
D’ailleurs cet album miniature n’est-il pas un leurre où des photos venues d’ailleurs, d’autres albums prêtés par des amis ou dénichés aux puces, constitueraient de toutes pièces une feinte archive familiale ? En quête de certitudes, l’œil doit alors traquer sur ces visages d’hypothétiques « airs de famille », scruter les tirages à la recherche d’un détail révélateur, depuis les yeux clairs du petit enfant (les yeux bleus de Jean-Marie Gleize ?) jusqu’aux barrières blanches bordant la terrasse sur laquelle posent les trois personnes entourant le bébé (les « structures de bois peint en blanc » [39] des terrasses bordant le carré du jardin de Tarnac ?). C’est sans doute la conjonction du travail de montage et de ce que l’on peut nommer installation verbale qui établit la plus forte présomption d’authenticité. On remarque en effet, placé à la suite de la séquence photographique dont il n’est séparé que par une page de texte, un fragment de courrier (fig. 14) adressé à « Monsieur Gleinze / Université de Tunis », légendé du seul mot « légende » et, de ce fait, inclus dans la série, lui-même suivi par deux croquis dont le premier (fig. 15) porte en guise de discrète signature les initiales « jmg ». Et puis il y a le substantif « légende(s) », disposé, au pluriel, tel un titre et repris obstinément au singulier de page en page, allusion possible à la pratique d’un ami photographe et diariste, à l’un de ses livres en particulier, Légendes de Denis Roche, qui avance la notion de « photo-autobiographie ». Sur cet arrière-fond rochien, les photographies avouent leur teneur autobiographique mais de façon indirecte, biaisée. Et retorse, puisque le dispositif iconotextuel fonctionne doublement : par la présence insistante du substantif « légendes », il suscite la pensée du travail de Denis Roche ; par l’effacement répété de la légende circonstancielle, il impose la conscience d’une déviation du modèle photo-autobiographique – une déviation comparable à la déviation du patronyme dont la faute de frappe corrigée impose le compte tenu. Bien sûr, l’écrivain, questionné, peut répondre :
-la première photo représente mon père le troisième à partir de la gauche avec son béret de chasseur alpin et cinq de ses camarades à l’armée
-la deuxième ma mère au piano dans l’appartement où nous habitions au 20 rue des Tournelles à Paris (…)
-la troisième c’est moi bébé dans les bras de ma cousine et marraine Marie-Madeleine avec mes deux grands-parents paternels sur la terrasse de la maison à Tarnac (Corrèze). (…)
-la quatrième est ma grand-mère dans le salon à Tarnac
-la cinquième moi (sans doute au même endroit)
-la sixième est la façade de la maison de Tarnac
-la septième est Joëlle en actrice pour La Farce des ténébreux de Ghelderode. Elle faisait du théâtre dans le cadre de l’Aquarium, troupe des ENS quand nous étions normaliens
-la huitième est le génie de la Bastille, mon point de repère quand nous habitions rue des Tournelles à côté (je reste ami des Anges)
-la neuvième est la dame, Zina, qui nous aidait pour les choses matérielles à la maison, lorsque nous habitions à Carthage en Tunisie (coopérants après l’agrégation), dans le quartier des ports puniques. Elle achetait des fruits et des légumes à un marchand qui tirait tous les jours sa petite charrette dans nos rues [40].
Mais ces mots ne sont pas dans le livre. Ils n’ont pas vocation à y être. Seule, conformément à l’étymologie latine du substantif récurrent, legenda, une injonction à lire, qui tourne à vide puisqu’il n’y a précisément rien d’autre à lire qu’elle-même. A moins qu’on n’y entende une invitation à lire le livre, voire le cycle entier, pour tirer de la masse des fragments textuels les légendes absentes. Petite machine à désintimiser l’intime (« Tout le monde se ressemble » écrivait Emmanuel Hocquard, et, certes, rien ne ressemble plus à un album de famille qu’un autre album de famille), la séquence photographique du chapitre « Vite ! », qui fait défiler en mode accéléré quelques jalons d’une existence, apparaît ainsi comme un dossier d’images offert à la pulsion inquisitrice d’un lecteur détective, un embrayeur de fictions potentielles.
Contrairement à cet ensemble photo-autobiographique livré sans aucun commentaire, d’autres images tirées de l’archive familiale entrent pour leur part en résonance immédiate avec du texte qui les légende ou s’y appuie. C’est le cas des quatre photographies de la forêt qui forment « Plans fixes », le chapitre 5 de Tarnac, et de celle du père à l’ouverture du premier chapitre du Livre des cabanes, « Dire être né ».
Des quatre clichés de la forêt (figs. 16, 17 et 18), seul le quatrième est accompagné d’une légende : « Sur cette image, la dernière, il reconnaissait le Bois du Chat », mais leur homogénéité qui les inscrit au premier coup d’œil dans une « même série » conduit à y voir autant de captations par le même opérateur du « paysage-enfance ». Leur allure ancienne, le récit dans le chapitre 1 de leur découverte par le fils, et, dans le chapitre 7, leur attribution à un allocutaire qui, « voya[nt] le haut des arbres se détacher sur le ciel », a « tiré au hasard » en pensant « il n’y a plus rien entre Dieu et nous » laissent deviner à l’origine des clichés le regard et le geste du père. Ce qui pourrait conduire à lui attribuer aussi les deux photos sans légendes ni commentaires qui servent de clôture à « Un objectif », le huitième chapitre du Livre des cabanes (fig. 19) : un chantier d’abattage avec au premier plan les troncs couchés au sol, un chantier de sciage où les billes de bois sont débitées en longues planches. Gleize semble, d’ailleurs, le souhaiter quand il écrit dans « Légender ? » : « On peut imaginer que ces six photos [les quatre insérées dans Tarnac et les deux du Livre des cabanes] ont été prises par la même personne (désignée dans le texte comme le père ou l’inconnu à tête d’os) » [41]. Couplées avec le fragment de carte qui situe le village de Tarnac, elles documentent le lieu géo-biographique. Couplées avec le texte qui leur fait écho sans les accompagner (puisque texte et images n’appartiennent pas au même chapitre), les quatre photos de « Plans fixes » (figs. 16, 17 et 18) accueillent une subjectivité, acceptent un poids d’obsession, de hantise. Nulle trace de luminosité dans le commentaire qui, négligeant la découpe plus pâle du ciel pourtant présente dans trois des photos et les interstices de clarté à l’arrière-plan de la deuxième, privilégie l’épaisseur de la « masse » végétale réputée « impénétrable » et la nuance obscure des « clichés gris et sombres, très gris, très imbibés de brouillard », voire pour le quatrième d’ambiance « nocturne et orageuse ». Obscurité, froid, humidité : ce sont les caractéristiques intrinsèques de Tarnac, dont la rêverie littérale du septième chapitre place les quatre consonnes en équivalence avec les quatre photos de la forêt, et qui contient redoublée dans son nom la « voyelle noire » du sonnet rimbaldien, la voyelle noire des origines. Ce sont aussi les caractéristiques de la nuit de Bavière. En conséquence, ces clichés, qui doivent, selon le premier chapitre, « figurer dans le livre » pour y « figurer ce que voit l’enfant, ce qui le pénètre sans qu’il le sache », entretiennent une relation potentielle avec les diverses occurrences de la scène du jardin où l’enfant fixe en aveugle le trou obscur sous la terrasse pendant que son père, le fixant du regard et au pastel, transfuse en lui « la nuit de Bavière ». Ce qui est vu alors en ces photographies de format carré, formant à elles quatre les angles d’un carré virtuel que l’on est tenté de relier à celui du jardin-cloître, ce n’est plus seulement la forêt telle qu’elle a été là en un temps révolu, ni même la trace du regard désormais éteint du père qui a vu et pris ce que le fils a pu voir à son tour en découvrant les tirages, et que nous voyons après lui. C’est ce qui ne peut se voir, ce noyau obscur autour duquel tournent les livres, cette bave d’hier déposée par le camp de Bavière au plus profond du corps de « l’inconnu à tête d’os » et inoculée par lui à son fils.