
Du roman-photo aux romans-photos
- Jan Baetens
_______________________________

Fig. 6. D. Michals, Le Gant, 1974 
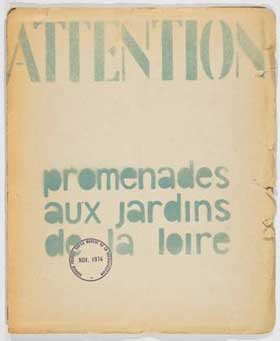
Fig. 7. Anonyme, Promenades aux jardins
de la Loire, s.d. 
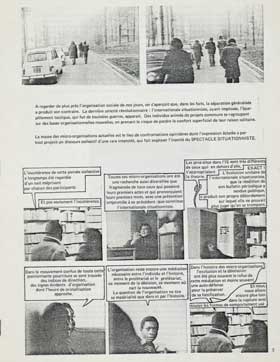
Fig. 8. Anonyme, Promenades aux jardins
de la Loire, s.d. 

Fig. 9. H. Serra, Madame Bovary, 1979 

Fig. 10. B. Peeters-M.-Fr. Plissart, Le mauvais œil, 1987 

Il n’en va pas autrement pour les réinterprétations plus « légitimes » venant du monde des arts plastiques, que l’on aurait tort de séparer a priori des formes populaires du roman-photo. Prenons par exemple Le Gant de Duane Michals [23], une « nouvelle » de 17 photographies, toutes accompagnées d’une légende narrative manuscrite, qui montre les rêveries érotiques d’un jeune homme autour d’une paire de gants de cuir (fig. 6). Cette histoire, apparemment un cas typique de « séquence minimaliste », peut non moins être lue comme une rencontre entre plusieurs autres genres, où les échos du roman-photo devraient trouver aussi leur place, ainsi que certaines références
• au roman illustré : on sent que le modèle de Nadja de Breton et l’esprit d’un certain fétichisme surréaliste surplombent la fiction michalsienne ;
• à la saynète typique du cinéma des premiers temps : chaque image correspondant plus ou moins à un plan immobilisé ;
• à la photographie documentaire d’un certain milieu urbain : comment ne pas penser aux images de vitrines d’Atget, le photographe dont les capacités narratives, discrètes mais réelles, ont été décrites par Walter Benjamin, qui lui invente un œil de policier [24] ;
• mais aussi à certaines formes de photographie documentaire : la froideur des images fait naître l’idée d’une filature, comme si le personnage s’était fait suivre à son insu par un détective privé faisant son rapport.
Tout comme dans le cas du roman-photo il convient de casser le modèle unifiant et universalisant du genre, les compositions de ce type doivent elles aussi être analysées comme la convergence jamais totalement réconciliée de plusieurs horizons génériques.
A un troisième niveau, l’œuvre n’est pas seulement matérialisation d’un texte, puis reconfiguration d’un genre ou d’une forme discursive, elle est aussi une énonciation concrète située dans un espace-temps précis qui permet d’en saisir la genèse et la signification comme réplique à une situation intertextuelle à la fois reprise et mise à distance. Cela se voit clairement dans les parodies du roman-photo, où la réponse au modèle se fait de manière presque mécanique, souvent largement prévisible. La parodie conserve le même format visuel, mais y colle un autre contenu, supposé avilir le modèle visé. En fait l’effacement du roman-photo servant de repoussoir, et transparaissant comme palimpseste sous la forme parodique, est doublement contraint par l’exercice en question. D’une part l’agression inverse le matériau initial, mais sur le seul plan du contenu, les aspects formels restant la plupart du temps tout à fait semblables à l’œuvre répudiée. D’autre part elle puise invariablement aux deux grandes sources de la carnavalisation que sont le sexe et l’étron, Hara-Kiri, on le sait, ne faisant pas exception à cette règle millénaire. Le mécanisme de la réponse intertextuelle se note également dans les détournements situationnistes, où l’effet de surprise est toutefois construit de manière plus sophistiquée. Au lieu de s’appuyer sur l’invention d’un contenu dévalorisant, les incursions situationnistes (fig. 7) dans le domaine du roman-photo introduisent, dans une mise en page aussi neutre et transparente que possible, un collage d’images mais aussi de textes venant de sources antagonistes (généralement il s’agit d’images empruntées à la culture de masse ou au discours publicitaire et de légendes ou de récitatifs à connotation politique). Le contraste entre ce qui se voit et ce qui se lit, joint au réemploi apparemment détaché d’un genre et d’une mise en page connotant la culture populaire dans ce qu’elle a de plus émotif, tend à produire des surprises certes moins voyantes que dans les parodies, mais sans doute plus durables, et partant plus efficaces (fig. 8).
Enfin, la stratégie de la genèse par répartie à un modèle antérieur se remarque aussi dans les adaptations littéraires des années 1970 ou, quelques années plus tard, les romans-photos « sérieux » de Marie-Françoise Plissart et Benoît Peeters [25]. S’agissant des premières, réalisées avant tout par Hubert Serra et très appréciées du public du magazine Femmes d’aujourd’hui, elles substituent aux récits anonymes et interchangeables du roman-photo « populaire » la griffe d’une signature prestigieuse, certes décédée depuis longtemps, qui offre l’occasion d’échapper aux sentiers battus du mélodrame contemporain (fig. 9).
Quant aux ouvrages de Peeters et Plissart, ils tissent des liens intertextuels très serrés avec le roman-photo classique, certes à des degrés de distance variables. Même si elles se distinguent par un classicisme visuel peu attesté dans la culture populaire, on ne peut pas dire que les travaux de Peeters-Plissart « oublient » le roman-photo traditionnel. Certaines de leurs compositions y renvoient même directement, comme par exemple la promenade amoureuse sur les terrils dans Le mauvais œil (fig. 10). Une observation analogue peut se faire au niveau des mises en pages. Quand bien même Marie-Françoise Plissart évolue incontestablement vers la photographie « autonome », avec une préférence sans cesse plus marquée pour les images privées de texte et pour la restriction du nombre d’images par page, il serait exagéré d’en conclure que les structures du roman-photo s’effacent complètement de sa trajectoire de photo-romancière. Le dialogue persistant avec le roman-photo affleure ainsi dans le maintien d’images reproduisant des fragments d’écriture, surtout dans des œuvres muettes comme Aujourd’hui (fig. 11). Enfin, rien ne paraît plus étranger aux histoires à l’eau de rose du roman-photo que le récit « queer » de Droit de regards [26]. En réalité, c’est bel et bien de passion, idéalisée et irréelle d’un côté, inquiétante et très corporelle de l’autre, qu’il est toujours question et de ce point de vue les femmes nues enlacées de Marie-Françoise Plissart ne détournent nullement du roman-photo le plus classique qui soit, dont la charge érotique ne doit pas être escamotée.
Le roman-photo au service de la littérature
Dans cet article, on a proposé une relecture de l’opposition roman-photo (comme genre) versus romans-photos (comme occurrences concrètes et individuelles de ce que l’on pourrait peut-être appeler le « photo-romanesque »). On a essayé de démonter, à l’aide de quelques idées-clé du nouveau comparatisme développé par Ute Heidmann, qu’on ne gagne rien à vouloir universaliser et décontextualiser les deux pôles de l’antinomie. Mieux vaut, en revanche, insister sur les nombreuses possibilités de différenciation interne, puis de comparaison textuelle très concrète, entre le modèle abstrait et les occurrences particulières. Les avantages de pareille lecture ne devraient pourtant pas être limités à la seule analyse du corpus examiné. La discussion théorique, méthodologique et analytique du roman-photo ouvre de vraies perspectives aux études littéraires, confrontées elles aussi à des difficultés analogues. A titre d’exemple et en guise de conclusion, pointons ainsi deux types de questions qui tracassent plus d’un chercheur littéraire aujourd’hui. Premièrement le problème des genres hybrides, dont surtout le roman graphique (graphic novel), que menace parfois une approche par trop essentialisante. Deuxièmement celui du recours trop peu réfléchi à certains métaconcepts dont les vertus opératoires, à la différence de l’atout rhétorique qu’ils peuvent représenter, peuvent se révéler fort maigres. Peut-être est-il temps de dépasser des notions comme « hybridisation », « tournant visuel » ou encore « intermédialité » dont la plus-value pratique et théorique ne semble plus assurée aujourd’hui [27].
[23] Titre original : « The Pleasures of the Glove » (1974), disponible en français dans le volume Duane Michals, n°12 de la collection Photo Poche, Paris, Centre National de la Photographie, 1983, n.p.
[24] Cf. "L’œuvre d’art à l’ère de sa reproductibilité technique (première version)", in Walter Benjamin, Œuvres III, Paris, Gallimard, « Folio », 2000, p. 82..
[25] A côté de Droits de regard et Aujourd’hui, que Marie-Françoise signe seule, mentionnons encore : Fugues (Paris, Minuit, 1983), Prague. Un mariage blanc (Paris, Autrement, 1987) et Le mauvais œil (Paris, Minuit, 1987), qui portent la double signature de la photographe (Plissart) et du scénariste (Peeters).
[26] On suit ici la lecture de J. Hillis Miller, qui dans un ouvrage en préparation sur Derrida et les queer studies, convoque ce roman-photo que l’on peut lire comme un ouvrage à quatre mains entre l’artiste et son lecteur, comme un des exemples privilégiés de son argumentation.
[27] Mes remerciements sincères à Charlotte Pylyser, Steven Surdiacourt, et David Martens, qui ont bien voulu discuter une première version de ce texte.


