
Sur les terres du sensible - Philippe Ortoli A propos de l’ouvrage : Raphaël Jaudon, Cinémas politiques, lecture esthétique - Cinq thèses sur l’engagement des films, Genoble, Ed. UGA, « Cinémas, émergences-résurgences », 2024 9782377474684 |
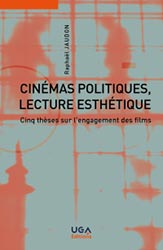 |
S’il y a une qualité première à l’ouvrage de Raphaël Jaudon, maître de conférences en études cinématographiques à l’université de Caen, c’est bien la clarté de son propos : sur un objet aussi riche que celui des rapports entre « le cinéma » et « la politique », et ce en tressant, au-delà d’une synthèse maîtrisée de l’historicisation de leurs remous, une série de propositions stimulantes, la langue est toujours précise, voire minutieuse, le style résolument alerte. Le point est d’importance, car le livre, organisé majoritairement autour de la confrontation de pensées complexes, celles de philosophes, comme de sociologues, de critiques et de cinéastes, aborde ces fécondes théories avec le souci d’une lisibilité constante qui, il faut le souligner, ne se confond jamais avec leur simplification.
C’est d’autant plus méritoire que Jaudon intervient sur un terrain particulièrement labouré, si ce n’est miné, celui de la (re)lecture des films au prisme d’une dimension politique qui a pris, depuis quelques années en France (globalement, dirons-nous, à partir du phénomène Me Too, 2006), mais depuis plus longtemps aux Etats-Unis (on peut le dater du développement des études féministes appliquées au cinéma, soit la deuxième partie des années 1970), une importance cruciale. L’auteur ne mentionne quasiment jamais ces approches spécifiques [1] (tout juste quelques références à Judith Butler et à Laura Mulvey, pionnières de l’éducation progressiste), mais scrute les conditions qui les ont rendues possibles : de ce fait, même si ce n’est pas son propos, il apporte un éclairage passionnant sur cette tendance majeure de notre époque.
Avec rigueur, le livre cerne un enjeu qui entend prioritairement rejeter le « politique » comme un adjectif à accoler à « cinéma » pour y créer un genre et, de manière globale, contester son acception en tant que « fait » séparé de celui que constituerait le film : s’enracinant dans le sillage du Rancière de Partage du sensible (le philosophe, souvent cité, y compris pour d’autres textes, est une des références affirmées de ces pages), il s’agit de convenir que c’est par la façon dont elle se constitue dans le monde sensible que toute communauté prend forme, et que c’est par une vêture pareillement sensible que l’œuvre d’art se présente à nous.
A admettre sous le terme « politique » ce qu’on recoupe aussi d’ordinaire dans le vocable « social », c’est-à-dire l’ensemble de ce qui a trait à la vie collective, et pas simplement l’organisation de son pouvoir institutionnel (pp. 237-248), l’auteur effectue un travail salutaire (de manière assez drôle, quand il remarque combien le second adjectif est toujours marqué par des thématiques misérabilistes dans les classifications qui le consacrent) qui l’entraîne vers des terres sur lesquelles on ne s’attendait pas à le voir débarquer : c’est ainsi qu’une certaine conception anthropologique, celle qui défend l’idée que la construction de la société est indissociable des images qui permettent de la fonder, apparaît dans des pages éclairantes sur Aby Warburg ou Didi-Huberman (notamment p. 175). Cette réflexion sur les modalités par lesquelles « des formules iconographiques » passées ressurgissent au sein de « problèmes contemporains » s’enracine dans un propos plus global qui est une piste précieuse tracée par le livre, celle qui consacre la façon dont tout ordre social s’appuie sur un visible qui, avant de le justifier, l’incarne. A ce sujet, fondamental pour la thèse de Jaudon, deux remarques s’imposent.
La première tient dans le fait que l’on ne peut réduire les zones de convergence des regards (là où la mise en scène du perceptible s’agence) à des centres de pouvoir (cf. p. 106) : certes, la charge politique des images est indubitable, mais pour autant l’organisation du visible n’est pas, comme le pense Bourdieu (lui aussi sollicité ici), l’unique marque du dominant. Elle est aussi le produit de la manière dont un sujet envisage son rapport au monde et, bien souvent, comme les ailes d’Icare préfigurent l’avion (suivant la très belle formule de Morin [2]), elle porte en elle les transformations sensibles d’un commun qu’elle donne à ressentir. De fait, lire toujours l’agencement de ce dernier sous l’angle de l’emprise court le risque d’un appauvrissement du politique décliné sous un versant majoritairement coercitif.
La seconde est que, en même temps qu’elles sont des « phénomènes visuels » à maîtriser, les images se présentent aussi dans cette relation sous un versant poétique (Hegel, par exemple, a montré combien l’esprit d’une nation se reflétait dans la forme épique). Si Debord a fait du spectacle le discours premier du pouvoir (dont on retrouve des traces dans les écrits alarmistes de Baudry sur les puissances anesthésiantes du dispositif cinématographique, cf. p. 109), c’est dans la définition plus large de l’image qui le sous-tend que se conçoit le mode d’expression de l’agencement du collectif.
[2] Edgar Morin, Le Cinéma ou l’Homme imaginaire, Paris, Editions de minuit, 1985 [1956], p. 213.