
Dérive, secousse, brasillement.
La dynamique intermédiale dans Drancy
la muette de Yannick Haenel et Claire Angelini
- Corentin Lahouste
_______________________________

Fig. 4. C. Angelini et Y. Haenel,
Drancy la muette, 2013 
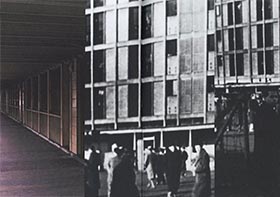
Fig. 5. C. Angelini et Y. Haenel,
Drancy la muette, 2013 

Aussi, les images d’Angelini parlent. Une de leurs voix est celle de Haenel : c’est le texte qu’il a rédigé qui, par moments, se présente d’ailleurs comme un commentaire du travail de la photographe, comme une ekphrasis (cf. pp. 27-29). Bien plus, l’auteur français donne ou restitue une parole à Drancy, que sa toponymie a réduite au mutisme, au secret. Toutefois, cette parole est fragile, elle est marquée par la douleur des faits qu’elle révèle. C’est ainsi une parole fragmentée, une parole entourée de silence, auréolée d’indicible. Les quatorze fragments qui composent le texte de l’écrivain peuvent dès lors être appréhendés comme autant de blessures ; ils font écho à la plaie camouflée que constitue Drancy dans l’histoire française. L’auteur lui-même se dit ravagé – « mon corps est à vif » (p. 37) – et, à travers lui, son écriture s’en voit affectée : « Le mouvement de l’écriture, par endroits, se brise ; et conduit à travers ses brèches vers une émotion qui à la fois la précède et prend sa place » (p. 36). Néanmoins, sa parole opère avant tout une fêlure dans le silence trop longtemps maintenu au sujet de Drancy, elle est fracturation de ce silence. Jacques Rancière dans Le Travail de l’image éclaire cet aspect en même temps qu’il indique la nécessité du détour, du biais, du mouvement, pour aborder l’abominable – nécessité que vont faire leur les deux artistes :
L’irréparable n’interdit pas la parole, il la module différemment. Il n’interdit pas les images. Il les oblige plutôt à bouger, à explorer des possibles nouveaux. Le caractère irréparable de ce qui a eu lieu n’oblige en rien à élever des monuments à l’absence et au silence. L’absence et le silence sont là, de toute façon, dans toute situation, donnés. La question est de savoir ce que les présents en font, ce qu’ils font des mots qui contiennent une expérience, des choses qui en retiennent le souvenir, des images qui la transmettent [8].
L’œuvre de Haenel et d’Angelini rejoue par conséquent l’Histoire, la fiction qu’elle constitue. On peut ainsi la considérer comme une œuvre istorique – sans h –, en référence au concept (« proto-genre ») proposé par Emmanuel Bouju, qui désigne « une fiction du témoin oculaire (istor) (…) qui actualise le temps historique comme temps vécu au présent – tout en affichant une distance par l’ostentation du dispositif narratif » [9]. En favorisant les effets de discontinuité et les connexions intempestives, elle vient ainsi remettre en question la « solennité ronflante » (p. 21) de l’historiographie, son irrémissible tracé ; elle dérange son discours institué. Il s’agit, comme l’affirme Haenel, de ne plus « respecter les mensonges » (p. 19). Elle est donc œuvre de résistance et donne naissance à un autre récit pour ce lieu meurtri, hanté [10]. Il est également possible de voir le travail des deux artistes comme un travail d’archéologie, c’est-à-dire comme un « mode alternatif d’intelligibilité du réel » [11]. Ainsi que le note Lionel Ruffel, l’archéologie, « loin d’être une science du passé, est une étude du présent, ou plus exactement, l’archéologie, dans la matérialité du présent, permet de retrouver la mémoire du passé » [12].
Avec Drancy la muette qui propose une connaissance par le montage, il ne s’agit alors pas « de proposer d’autres histoires, mais d’autres formes d’intelligibilité de l’histoire » [13]. Est par conséquent rendu possible le récit d’une autre mémoire de l’Histoire et notamment d’une mémoire post-témoin (de l’héritier du témoin, du témoin au second dégré). Aussi, Drancy la muette, en tant qu’œuvre de la recombinaison, ouvre à un nouvel espace, à une nouvelle perspective, qui est celle de l’entre, de l’inter. L’ouvrage esquisse en effet un espace dialectique entre texte et images, entre présence et absence, entre parole et silence. Il instaure alors une continuité inédite, « inavouable » (p. 28), entre réalité présente et réalité passée, entre l’univers concentrationnaire et celui de la banlieue : « une continuité terrible se met à exister » (pp. 30-31) ; « une forme persiste à travers la mise en rapport des époques » (p. 28), qui est celle de l’exclusion et du contrôle. Cet aspect clairement développé par Haenel dans son texte est tout autant perceptible dans les photographies d’Angelini, dont la plupart donnent à voir un horizon barré, font surgir diverses formes de clôture (figs. 4, 5 et 6).
Les deux artistes font ainsi déborder (p. 36) Drancy au-delà de Drancy, justement parce que ce lieu et ce nom symbolisent quelque chose : ils représentent l’ignominie de la déshumanisation que met en place le « paradigme de l’Etat de police » (p. 39), à travers l’« administration de la vie » (p. 39) qu’instaure le camp. Ce lieu est une des traces de ceux-ci dans l’Histoire, et qui, malgré les apparences, persistent – déshumanisation et administration de la vie ne se sont pas arrêtés à la fin de Seconde Guerre mondiale. Mais dans un même temps, Haenel et Angelini investissent également le lieu étranger (de l’étrange) qui s’est établi à Drancy : le lieu interdit, le lieu du bannissement, le lieu d’un au-delà, à la fois temporel et éthique/moral – car dépassant l’acceptable, l’imaginable. Le livre se fait ainsi la scène de ce que Dominique Rabaté a identifié (au sujet de l’œuvre de Perec, pour sa part) comme « le jeu de deux paroles, de deux registres [sémiotiques] [au sein desquels] se cherche un inter-dit,qu’aucun discours ne peut seul subsumer » [14].
Le dialogue entre les formes donne naissance à un intervalle, à un espace en creux que l’on pourrait dire spectral. Il engendre une « troisième image » (p. 30), pour reprendre le terme employé par Haenel : « dans cet interstice qui sépare [les différentes époques], une autre image apparaissait. Cette image n’existe pas – ou plutôt elle existe comme scintillement d’une lacune : elle est l’image-même de l’introuvable qui vient battre entre les époques » (p. 30). Cette troisième image, intermédiale, déborde le figurable car ce qu’elle vise à dévoiler (l’exclusion et le contrôle) est proprement in-visible, in-dicible. Comme le note Haenel, « [u]n éclair, seul, nous accorde à son éphémère saisie, sans nous la rendre pour autant, mais en nous donnant à voir ce qui, brièvement s’absente » (p. 29). Elle incarne l’espace enseveli entre (par) les mots et les images.
Dynamique, elle agit alors comme une passerelle entre passé et présent et « nous accorde à la visibilité de ce qui n’a pas d’image » (p. 30), s’inscrivant pleinement dans la perspective de l’intermédialité qui est, comme l’affirme Silvestra Mariniello, « du côté du mouvement et du devenir, (…) [en tant que] lieu d’une pensée de l’être non plus entendu comme continuité et unité, mais comme différence et intervalle » [15]. Aussi, elle est, par la faculté imaginative de laquelle elle émane, redisposition, écart, de même que dépassement de la limite et, dès lors, en un certain sens, agrandissement de conscience. Ni image(s), ni mot(s) – plus que toute image et que tout mot –, elle est geste(s), suivant l’acception qu’Agamben octroie à ce terme : « Ce qui caractérise le geste, c’est qu’il ne soit plus question en lui ni de produire ni d’agir, mais d’assumer et de supporter. Autrement dit, le geste ouvre la sphère de l’ètos comme sphère la plus propre de l’homme » [16]. De surcroit, elle permet, à travers l’investissement subjectif qu’elle implique [17], de régénérer la mémoire de la Shoah, que l’on peut dire « saturée » – pour reprendre le titre d’un ouvrage [18] de Régine Robin –, engorgée par tant d’images vues et de discours entendus à son sujet ; ce qui en composait le fond le plus abject : son caractère coercitif et évictif. Comme l’ont souligné Sébastien Biset et Myriam Watthee-Delmotte dans leur étude de l’œuvre d’Ernest Pignon-Ernest, « en posant l’oubli ou le non-savoir en son centre, l’image peut créer l’ouverture à un savoir nouveau, à l’insoupçonné » [19].
[8] J. Rancière, « Le Travail de l’image », dans Esther Shalev-Gerz, catalogue de l’exposition Ton image me regarde ?!, Paris/Lyon, Jeu de Paume/Fage Editions, 2010, p. 11.
[9] E. Bouju, « Force diagonale et compression du présent. Six propositions sur le roman “istorique” contemporain », dans Ecrire l’histoire, n°11 – printemps 2013, p. 52.
[10] Le travail de Patrick Zachmann sur la place Tiananmen relève d’un même souci, d’un processus similaire. La place Tiananmen peut d’ailleurs être vue comme le pendant chinois de Drancy.
[11] L. Ruffel, Brouhaha. Les mondes du contemporain, Paris, Verdier, 2016, p. 192.
[12] Ibid., p. 181.
[13] Ibid., p. 184.
[14] D. Rabaté, « L’individu contemporain et la trame narrative d’une vie », dans Studi Francesi, 175, LIX|I, 2015, p. 59.
[15] S. Mariniello, « Présentation du dossier Intermédialités et cinéma », Cinémas, vol. 10, n°2-3 – Cinéma et intermédialité, printemps 2000, p. 6, nous soulignons.
[16] Agamben Giorgio, Moyens sans fins. Notes sur la politique, Paris, Editions Payot et Rivages, « Petite Bibliothèque », 2002, pp. 67-68.
[17] Appréhender Jan Karski (2009) dans le sillage de cette troisième image (en tant que déploiement de celle-ci) permet de reconsidérer cette œuvre loin de la polémique qu’elle a suscitée.
[18] Voir R. Robin, La Mémoire saturée, Paris, Stock, 2003.
[19] S. Biset et M. Watthee-Delmotte, « Représenter in situ : Ernest Pignon-Ernest à l’interface de la mémoire et de l’oubli », dans I. Ost, P. Piret et L. Van Eynde, Représenter à l’époque contemporaine. Pratiques littéraires, artistiques et philosophiques, Bruxelles, FUSL, 2010, p. 261.


