
Sade-cinéma
- Olivier Leplatre
_______________________________

Fig. 35. Fr. Urbini (attr.), Testa de cazzi, 1536
Fig. 36. Anonyme, L’Abbé Mauri, v. 1792 

Fig. 37. D.A.F. de Sade, Histoire de Juliette [1799]
Fig. 38. E.-J. Marey, Un homme qui marche, v. 1890 
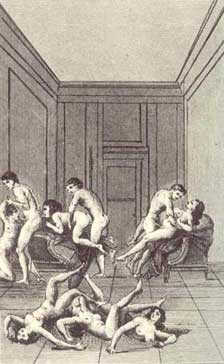
Fig. 39. D.A.F. de Sade, Histoire de Juliette [1799]
fig. 40. E.-J. Marey, Saut en hauteur de pied ferme, 1890-91
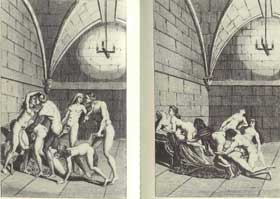
Fig. 41 et 42. D.A.F. de Sade, Histoire de Juliette [1799] 

Cependant le dispositif iconographique des œuvres de Sade pallie cette faiblesse et même porte à son comble le désir de l’écrivain [27] puisque le mouvement réintègre l’espace des images sans que celles-ci renoncent à traduire les scènes en stases visuelles paroxystiques qui arrachent le corps au morcellement, l’illuminent tout à fait et situent hors du langage le corps total [28] : « On remarque dans toutes ces peintures », constate Juliette face aux fresques d’Herculanum, « un luxe d’attitudes presque impossible à la nature, et qui prouve ou une grande souplesse dans les muscles des habitants de ces contrées, ou un grand dérèglement d’imagination » [29]. « Presque impossible dans la nature », mais incitant alors le défi de tenter cet impossible, pour devoir conclure que la merveille du corps acrobatique ne réussit que sur la scène de l’image où se réinvente la chimère d’une substance corporelle infiniment malléable, une anamorphose permanente de la nudité, dont on a pu tirer, parfois, des visages (figs. 35 et 36).
Par toute cette activité aspectuelle, par leur cadence et leurs ressources, les gravures de Sade finissent par donner l’impression d’introduire une des expériences archéologiques ou anachroniques du cinéma. Cette expérience qui se superpose à une certaine opération de l’illustration aide aussi à revoir les origines du cinéma. L’anachronisme agit méthodiquement dans les deux sens. Il appelle un devenir et rejoint une antécédence, il les réévalue l’un par l’autre. Il relie des moments au prix d’un forçage du temps qui l’enrichit en l’arrachant à sa simple chronologie. Il reprend de manière féconde ce qui était déjà là et n’apparaissait pas encore comme tel avec ce qui sera ou est ensuite advenu. Dans ce dialogue, chaque phénomène avance l’un vers l’autre et tire bénéfice d’une relecture mutuelle.
Le système d’illustration sadien dépend de la possibilité d’un imaginaire cinématographique : celui des similitudes différentielles, des répétitions d’images qui se reprennent en mordant sur leurs ressemblances et en s’écartant par leurs différences.
Pour fabriquer des images de cinéma, il faut en premier lieu que le primat soit accordé au vecteur mécanique dans l’analyse du mouvement de la vie. Pas de cinéma sans corps mis en action par des forces dont le nombre est illimité. Quand Etienne-Jules Marey invente la chronophotographie puis s’intéresse au cinéma à la fin des années 1880, il capte d’abord des forces convoquées dans le mouvement et il les transcrit dans des images [30]. La succession des images rend visible la décomposition des forces, elle permet de suivre la manière dont elles se font et se défont. En sorte que montrer le mouvement consiste pour Marey à désigner des forces qui posent et des forces qui passent. Les illustrations de Sade ne montrent en vérité rien d’autre que ce montage des forces chargées par l’écriture (figs. 37 et 38). Basculée dans l’image en série, cette mécanisation, cette « revue » du mouvement inaugure un traitement cinématographique du visible.
Le cinéma ne reproduit donc pas du tout la réalité du mouvement ; il le traite à la façon des diapositives : en le fragmentant, en fractionnant des aspects et en les reliant les uns aux autres. Le cinéma naît ainsi du choix d’enregistrer les syncopes de la vie.
Dans ses théories du montage et du photogramme, le cinéaste russe Eisenstein a développé la double idée de l’image attachée à l’instant remarquable et du film élaboré par l’attraction des plans. Par son œuvre, il a voulu résoudre la contradiction essentielle du cinéma entre la ponctualité spectaculaire des images, qui rapproche l’art cinématographique de toutes les machines à vues, et la nécessité d’un vecteur narratif qui enchaîne les ponctualités. Eisenstein souhaitait assembler dans un film une chaîne d’« excitants » [31] : des images poussées à leur maximum de tension pathétique juxtaposées les unes à côté des autres ; l’écart entre elles ménageant le heurt d’une différence d’où découle l’impression de mouvement.
Dans ses Réflexions critiques sur la poésie et la peinture, l’abbé du Bos théorisait en des termes assez proches cette emprise sensible des scènes répétées, mais dans le domaine du théâtre : « Quarante Scenes qui sont dans une Tragedie », écrit-il, « doivent [donc] nous toucher plus qu’une Scene peinte dans un tableau ne sçaurait faire » [32]. Au théâtre, pour l’abbé du Bos, chaque scène est autonome mais elle est surtout un aspect actualisé dans une série. Selon lui, la multiplicité des tableaux engendre une intensification de l’énergie d’action et une augmentation des degrés de l’émotion. La cohérence de la pièce dépend en définitive de cette insistance de l’énergie alliée à la persistance rétinienne qu’obtiennent les scènes selon la logique d’une mémoire des impressions.
L’illustration sadienne construit le même spectacle, dialectisant le ponctuel et le vectoriel ; elle aboutit à l’esquisse d’un film des corps, un film physique et psychique puisqu’il engage le régime d’une obsession (figs. 39 et 40).
En 1977, la revue Obliques choisit de publier l’ensemble des gravures, sans le texte, sous le titre Sade illustré. On peut s’amuser à faire fonctionner ce livre comme un flip-book (figs. 41 et 42). Ce geste est possible parce que les illustrations sont assemblées les unes à la suite des autres. Mais, plus fondamentalement, parce que chaque image des livres de Sade regarde en arrière l’image précédente dont elle est la répétition différenciée et en avant l’image suivante qui va la reprendre sans lui être semblable. Les images s’appellent tout en n’étant jamais tout à fait superposables. Parfois la scène vue accentue sa forme et sa pose en se détachant mieux, en marquant un peu plus sa singularité (fig. 43), et alors elle fait davantage bégayer le mouvement (la série visuelle s’apparente à la lanterne magique) ; parfois, ou le plus souvent, son extraordinaire se banalise suffisamment pour faire de l’image un instantané, un instant quelconque (et non privilégié) [33] qui augmente la fluidité de la séquence. Quoi qu’il en soit, les images battent un rythme, cadencé par le texte qui s’intercale (le cinéma réclamera l’intervalle pour le mouvement) et par le passage d’une gravure à l’autre, selon des espacements variables dans l’œuvre (et non équidistants comme sur la pellicule). Cette intermittence de l’illustration, cette « iconorythmie » [34], est structurée par le nombre important de la série ; elle met en évidence un rythme des images qui s’ajoute aux caractéristiques cinématographiques de l’iconographie sadienne.
Et cependant, trop de vitesse nuirait aussi au déploiement de l’image. Car plus nous rapprochons les images entre elles et plus leur altérité s’accuse : des détails, des bizarreries, de petits événements (objets, gestes, corps : la cascade d’une perruque, l’ourlet écumeux d’un coussin, des stries de sang scarifiant une fesse, des écarts excessifs de proportions entre les figures…). Ces fétiches, d’abord fondus dans la masse de l’image et alors même que nous les pensions disparus ou refoulés, font retour ; ils surgissent sur le fond des identités. Tout en allant vite d’une image à l’autre, le regard doit aussi prendre le temps de développer intégralement chaque gravure, dans un supplément de l’instant, presque une durée qui l’aide à jouir de ces effets locaux d’obscénité : du temps pour que s’installent dans l’œil des singularités visuelles qui isolent l’image tout en fonctionnant aussi comme les points d’appui de la dynamique visuelle. Le texte intervient précisément pour ralentir le défilé : il étire les images les unes en direction des autres (anaphoriquement et cataphoriquement), mais il les étire aussi afin qu’en chacune se dépose une signifiance, cueillie le long du parcours des images, et afin que l’écart des particularités contribue à la possibilité même du jeu et donc du mouvement.
A voir le corpus iconographique des récits sadiens, nous appréhendons ce qu’est vraiment le rythme. Car, comme le rappelle Emile Benveniste [35], le rythme n’a pas été d’abord le mouvement régulier comme le battement des flots le suggèrerait. Le terme a appartenu auparavant à la philosophie ionienne, et il a signifié la « forme distinctive » [36], « la forme dans l’instant qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile » [37]. Il s’agit donc d’une forme modifiable, comme le tracé d’une lettre ou le pli d’une draperie [38]. L’illustration sadienne est fondée sur ce mouvement répétée mais irrégulier, non exactement prévisible bien que pris dans un « fluement », selon l’expression de Barthes [39], distinct en chacun de ses battements alors même qu’il est soutenu par la répétition [40]. La gravure agence ce rythme : son apparaître, sa secousse occasionnelle mais suffisamment régulière plie et déplie les formes-forces des corps. Elle désigne l’énergie qui circule en eux et entre eux ; elle jaillit de leurs rapports et fait exister une structuration dans le flux.
On pourrait conclure sur ce devenir-cinéma de l’illustration sadienne par ce qu’elle implique pour le regard, c’est-à-dire la perspective d’une autre manière de voir. Grâce à la répétition métamorphique qui anime le système des images, la substance cède le pas au mouvement et le mouvement lui-même reforme substance. Ce phénomène produit alors des images qui éclairent des scènes primitives de l’œil. Les gravures sadiennes changent le voyeurisme, et les conditions de la pulsion de plaisir, en une expérience de métamorphoses de l’œil lui-même, qui se projette à l’image. Ce que nous voyons dans ces gravures, par l’expression des corps recomposés, ce sont des figures inédites de notre pupille, un jeu de poupées dans les remous de notre regard.
[27] Nous ne suivons pas tout à fait sur ce point l’analyse de Michel Delon qui lit la page de l’Histoire de Juliette uniquement dans le sens d’un congé donné à l’image à travers le détournement d’un stéréotype stylistique (l’insuffisance de l’écriture comparée aux arts du visible et l’appel au talent du peintre) : « L’érotisme va bien au-delà d’un simple recueil de positions, la dynamique de l’imaginaire sadien est irréductible à une suite d’images. L’écriture désormais prend à sa charge la description picturale des lieux, des personnages et des actions » (« L’Esthétique du tableau et la crise de la représentation à la fin du XVIIIe siècle », dans La Lettre et la Figure. La Littérature et les arts visuels à l’époque moderne, édité par W. Drost et G. Leroy, Heidelberg, Carl Winter Universitätsverlag, 1989, p. 23). On remarquera cependant que, dans le cas de l’Histoire de Juliette, l’ouvrage parvient à offrir une image de l’exploit pornographique au terme duquel Sade réclame l’aide du graveur censé l’immortaliser (fig. 34).
[28]
Voir R. Barthes, Sade, Fourier, Loyola, Paris, Seuils, « Points », 1980, p. 131.
[29]
Sade, Histoire de Juliette, Cinquième
partie, éd. cit., p. 1068.
[30]
Voir l’essai de Georges Didi-Huberman à qui les
lignes suivantes sont très directement redevables (Mouvements
de l'air. Etienne-Jules Marey, photographe des fluides,
Paris, Gallimard, « Art et artistes », 2004).
[31]
Voir S. M. Eisenstein, « La méthode de mise en
scène d’un film ouvrier » [1925], dans Au-delà
des étoiles, Paris, UGE, 1974, p. 25. Sur les
théories du montage d’Eisenstein, voir tout
spécialement Eisenstein : l’ancien et
le nouveau, dirigé par D. Chateau, Fr. Jost et M.
Lefebvre, Paris, Publications de la Sorbonne-Colloque de Cerisy,
« Esthétique » 2001.
[32]
Abbé Du Bos, Réflexions critiques sur
la poésie et la peinture, Paris, Pierre-Jean
Mariette, 1740 (quatrième édition), volume I, p.
396.
[33]
Sur la différence entre instant quelconque ou instant
privilégié au cœur de la bifurcation de
la ligne technologique qui, selon Gilles Deleuze, distingue
l’art des images qui bougent et l’art du
cinéma, voir le cours
« Cinéma/Image-mouvement » tenu
à Nanterre en novembre 1981, consultable sur le site de l’Université de Paris 8.
[34]
Non pas exactement rythme dans l’image ou entre
l’image et le texte, comme l’étudie
Liliane Louvel, mais tempo des séries d’images
(voir L. Louvel, Texte/Image. Images à lire,
textes à voir, Rennes, Presses Universitaires de
Rennes, « Interférences », 2002, pp.
242-247).
[35]
E. Benveniste, Problèmes de linguistique
générale, Paris, Gallimard, 1966, Tome
1, pp. 327-335.
[36]
Ibid., p. 332.
[37]
Ibid., p. 333.
[38]
Ibid.
[39]
R. Barthes, Comment vivre ensemble. Cours et
séminaires au Collège de France (1976-1977),
Paris, Seuil Imec, « Traces écrites »,
2002, p. 38.
[40]
« Les hommes ont bien tort de craindre la
répétition, à condition d’y
chercher non pas de convaincre par l’entêtement,
mais la preuve que, même redite, une pensée ne se
répète pas ou encore que la
répétition fait seulement entrer ce qui est dans
sa différence essentielle » (M. Blanchot, L’Entretien
infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 501).


