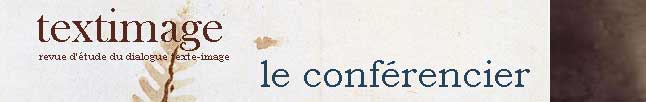Résumé
Le frontispice de l’édition originale des Maximes de La Rochefoucauld a donné lieu à de multiples commentaires. Un élément cependant n’a pas retenu l’attention de la critique : celui du cadrage précisément. La gravure présente une citation tronquée du poète Horace, réduite à deux mots. Pourquoi cette coupure violente ? Et surtout, quels en sont les effets sur l’interprétation globale de l’image ? Le dispositif conçu par ce frontispice repose sur un non-dit et un non-montré. Le cadre ici dérobe ce qu’il lui importe de signifier. Il cache pour exhiber différemment. Une comparaison avec la gravure qui sert de frontispice à un ouvrage proche – La Fausseté des vertus humaines de J. Esprit – permet de confronter deux formes de discours, identifiés chacun par une image représentative.
Mots-clés : La Rochefoucauld, maximes, Sénèque, augustinisme, moralistes
Abstract
The frontispiece of the original edition of Les Maximes by La Rochefoucauld has given rise to many comments. One element, however, has not caught the attention of the critics: its framing. The engraving features a truncated quote from the poet Horace, reduced to two words. Why this violent cut? And above all, what are the effects on the overall interpretation of the image? The device designed by this frontispiece is based on unsaid and unshown elements. The frame here conceals what is important for it to signify. It hides to show off differently. A comparison with the engraving that serves as the frontispiece of a similar work – La Fausseté des vertus Humaines by J. Esprit – allows us to compare two forms of discourse, each identified by a representative image.
Keywords: La Rochefoucauld, maxims, Seneca, augustinism, moralists
S’il est un frontispice célèbre, c’est bien celui qui ouvre l’édition originale des Maximes de La Rochefoucauld (fig. 1). Ce putto narquois arrachant son masque à Sénèque a été abondamment commenté. Encore récemment une bonne cinquantaine de pages lui sont consacrées dans une étude d’Isabelle Chariatte [1]. On ne peut, dans ces conditions, que s’étonner du nombre d’éléments restés encore inaperçus, et de tous les traits qui demeurent mal compris. Y a-t-il meilleure illustration de la remarque de Pascal Quignard : « L‘ambiguïté des images est le propre des estampes et fait leur attrait, et presque le plaisir de leur contemplation » [2] ?
Il est en tout cas un point qui n’est jamais traité, dont j’ai pris conscience grâce au présent colloque : le cadre ! Le cadre du frontispice fige la scène, l’arrache à un continuum temporel que le spectateur est invité à restituer. Et surtout, dans le cas qui va nous retenir, il mutile une inscription, transformant en quasi-énigme un lieu commun culturel. On remarque souvent que le cadrage permet de montrer ce que l’on veut, et donc d’effacer ce que l’on veut. L’analyse de notre image nous découvrira une grammaire plus complexe : le cadre ici dérobe ce qu’il lui importe de signifier. Il cache pour exhiber différemment.
Deux questions principales se posent au sujet de cette image. Tout d’abord, celle de l’interdiction. Il y a un veto dans la gravure (Quid vetat), mais que signifie-t-il ? Qui le formule, et sur quoi porte-t-il ? Le deuxième problème est celui du rire : qui est le rieur ? Où est-il ? Il reste hors cadre. N’est-ce pas La Rochefoucauld lui-même, qui fait entendre que derrière l’amour de la vérité, il est celui qui mène cette entreprise de dérision ? Dans les deux cas, la réponse est hors champ, dans un élément implicite, et qui est peut-être même l’essentiel du message. Avec ce très célèbre frontispice, nous sommes donc au cœur du problème soulevé par le présent colloque : celui de l’image, et du cadre – une image cadrée d’étrange manière, si bien que l’essentiel de sa signification est rejeté hors cadre. Quant aux enjeux spécifiques de cette image, sur un plan philosophique aussi bien qu’esthétique, nous serons aidés pour mieux les comprendre par l’existence d’une autre image rivale : celle qui ouvre le livre parallèle de Jacques Esprit.
Pour instruire convenablement le dossier, il ne sera pas inutile de procéder à une élémentaire description et de rassembler les informations disponibles.
L’ouvrage de La Rochefoucauld est publié en 1665 chez Barbin, c’est-à-dire chez un libraire « galant ». Comme le souligne Isabelle Chariatte, après bien d’autres, « en choisissant Barbin pour publier ses Maximes, La Rochefoucauld se range lui-même parmi les mondains » [3]. La présence d’un amour au seuil du livre n’a pas lieu de surprendre. La gravure est l’affaire du libraire, qui s’entend lui-même avec l’artiste pour en arrêter les détails. Le frontispice est vraiment la porte d’entrée de l’ouvrage : la page exposée dans la boutique du libraire – ce qui doit conduire à acquérir le livre, que l’acheteur se chargera ensuite de relier. Mais est-ce bien un amour qui nous est ici donné à voir ? Plus exactement, il s’agit d’un putto – c’est-à-dire d’un jeune garçon, nu et ailé, assez dodu : sorte d’angelot omniprésent dans les décors depuis la Renaissance italienne et souvent assimilable à Cupidon (quoiqu’ici l’arc et les flèches lui fassent défaut). S’il représente cependant l’Amour, ce n’est pas n’importe quel amour, mais – l’inscription est là pour nous en informer – l’amour de la vérité.
Il est intéressant de noter que cette précision d’importance ne figurait pas originellement. En effet, un premier état de cette gravure, due à Etienne Picart, dit le Romain (1631-1721), nous est conservé au département des estampes de la BnF [4] (fig. 2). La mention « l’Amour de la vérité » en est absente. L’identification formelle de l’angelot est une des trois corrections que l’on peut constater sur l’état final (fig. 1). Les deux autres sont : le périzonium venant cacher la nudité du putto (visible dans un premier temps) et la transcription en latin du nom de Sénèque, qui figurait d’abord sous sa forme française. Si l’on comprend bien ces trois corrections de dernière minute, elles viennent régler trois éventuels problèmes : un problème d’information (l’identité de l’angelot) ; un problème de bienséance externe (la trop grande évidence de son sexe) ; un problème de bienséance interne (la présence d’une graphie française dans une scène strictement antique, et au voisinage de deux termes latins).
[1] I. Chariatte, La Rochefoucauld et la culture mondaine. Portraits du cœur de l’homme, Paris, Classiques Garnier, 2011. Le chapitre préliminaire de l’ouvrage est consacré à une étude du frontispice : « Sur le "seuil" des Maximes : le frontispice, une clé de lecture », pp. 17-68.
[2] J. Esprit, La Fausseté des vertus humaines, précédée de Traité sur Esprit par P. Quignard, Paris, Aubier, 1996, p. 38.
[3] I. Chariatte, La Rochefoucauld et la culture mondaine. Portraits du cœur de l’homme, Op. cit., p. 22.
[4] BnF, département des Estampes, cote Ed-56-fol. (voir dans le catalogue de la BnF). La gravure mesure 130 x 78 cm au coup de planche ; 127 x 76 cm au trait carré. Le volume où elle se trouve est issue de la collection Beringhen. Pour toutes ces précieuses informations, mes chaleureux remerciements vont à Rémi Mathis, conservateur des collections du XVIIe siècle.