
De certains usages du cinéma en poésie
- Luigi Magno
_______________________________

Fig. 1. E. Pellet, Noir-écran, 2008 ![]()
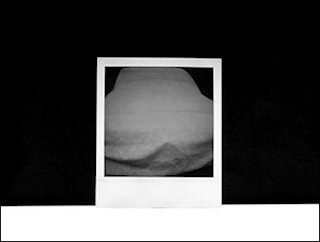
Fig. 2. E. Pellet, Noir-écran, 2008 ![]()

Fig. 3. S. Bérard, Mortinsteinck, 1998 ![]()

Fig. 4. S. Bérard, Mortinsteinck, 1998 ![]()
Cinéma littéral du monde médié (Jean-Marie Gleize, Eric Pellet)
Si, comme le pense Clément Rosset, le réel est ce qui exclut le double, comment dire, capter, enregistrer, transmettre le Réel ou, du moins, un certain réel possible [20] ? Cette interrogation constitue l’une des questions autour desquelles tourne l’écriture de Jean-Marie Gleize. Dans Film à venir la possibilité de cette captation est questionnée à partir d’images plastiques, directement ou indirectement convoquées dans le texte [21]. On sait que la présence d’images photographiques ou écraniques est une sorte de basse continue de l’écriture de Gleize, mais dans ce livre cette présence devient centrale, voire capitale, dès le titre. Comme l’annonce le sous-titre, il s’agit ici d’un essai de « conversions », de passages ou trans-codifications, d’une tentative d’écriture sans images (au sens littéraire du terme), faite à partir d’un film (inexistant, car il est « à venir ») et d’images (filmiques, vidéo, écraniques…).
Dans une écriture qui prend par moments le ton et l’allure d’un scénario, les images (tous azimuts) sont incessamment questionnées. En ouverture on lit : « C’est dans les interruptions de la projection d’un film, dans ces zones découpées où apparaissent des crachats d’encre, que s’impose la méthode du pourrissement de l’objet » ; plus loin : « A la fin du film l’ampoule est une flaque noire au bas de l’écran » ; et encore : « Plus tard encore l’écran est noir, vidé absolument noir » [22]. Au départ donc c’est le noir, le A noir, un noir premier, matriciel, duquel découlent les tentatives d’inscription, de prise de parole qui essaient de dire sans images, au-delà ou en deçà des images. S’agence ainsi une série de plans et de surfaces qui s’encastrent sans fin dans la poursuite d’une captation possible qui revient littéralement au noir par un rectangle (noir) qui apparaît dans le texte comme une photo surexposée, trop chargée car trop remplie (quoique mettre du noir en Chine veut dire écrire), ou un écran de cinéma éteint ou qui ne retransmet rien, où on ne voit plus rien [23].
A ce stade de la progression du livre on s’aperçoit que la « couverture » du réel (« covering the real » est le nom d’un chapitre du livre) va tout aussi bien dans le sens d’un témoignage de quelque chose (en prise directe) que dans le sens d’une médiation ou prise indirecte. Le réel n’existe pas, le réel n’existe qu’en images, ou en images d’images, en images d’images d’images…, il est donc inévitablement médié par les surfaces, les écrans et autres voiles. Le texte s’approprie alors factuellement des images photographiques qui disent, par leur flou et leur indétermination iconique, toute leur ignorance du réel, jusqu’à ce que les mots réapparaissent, comme sortis d’un bain révélateur, imprimés en blanc sur une page noire [24]. Le noir, cette marque d’ignorance matricielle, est aussi à lire comme le point de tension idéal vers lequel l’écriture se dirige dans la tentative de dire tout en neutralisant les (belles) images. Un Film à venir donc, qui tourne du noir au noir.
Entre noir-premier et noir-tension/but, l’écriture des faits (« FACT » [25], peut-être en écho au « What we want is facts » de Dickens dans Hard Times) s’ancre ainsi chez Gleize plus que jamais dans les gestes que la saisie des faits comporte. C’est donc tout naturellement que l’écrivain prête sa voix et son texte, littéralement, à la vidéo d’Eric Pellet Noir-écran. L’essai de captation continue à l’écran, par cette vidéo qui est un film, dans une conversion qui prolonge les tentatives écrites du livre. Les images montrent ce que le texte dit, disent ce que le texte dit, tout en dévoilant les techniques de cette captation. L’intérêt du film, à notre avis, ne réside pas tellement dans cette redite mais se trouve dans l’exhibition des gestes techniques, tels que la mise au point de l’image et la conséquente multiplication des flous, ou encore l’utilisation de plans-séquences qui affichent les mouvements de la caméra ou de son objectif à la recherche d’un cadrage et soulignent les différents fondus (surtout au noir). Tous ces gestes filmiques sont des tentatives de captation qui circulent dans les lignes, les pages et les chapitres de Film à venir. Peu importe si ces gestes appréhendent le monde, disent ou réinventent un certain réel tout en ayant conscience de leur impossibilité foncière.
Le texte et le film vivent entre un ancrage référentiel et une clôture sur leurs langages, leurs codes et le brassage de ceux-ci. Leur intérêt réside dans l’oscillation entre leur pouvoir de dire transitivement et leur capacité de tester, en même temps, la portée de l’hybridation codique qu’ils mettent en place. Tous ces gestes pratiques sont autant d’outils critiques aptes à dépecer nos représentations du monde (donc nos mondes) et en révéler ainsi le fonctionnement.
Le cinéma comme outil de poétique et d’investigation du monde de l’art (Nathalie Quintane, Stéphane Bérard)
Mortinsteinck de Nathalie Quintane constitue un autre exemple de livre écrit à partir d’un film car il se présente explicitement, dès le sous-titre, comme étant « le livre du film » éponyme réalisé en 1998 par Stéphane Bérard [26]. L’écriture de Quintane, mimant la démarche hétéroclite du film, prend la forme d’un scénario ou d’une analyse séquentielle, agrémentés de commentaires, de conversations captées dans la rue, de reportages télévisés, d’un certain nombre de références à d’autres films, de documents. Outre le fait de proposer des clés de lecture ou de compréhension du film, le livre semble de prime abord reconstruire les étapes non chronologiques de la fabrication de celui-ci et de l’invention du scénario. A un degré zéro de lecture, le livre apparaît donc comme un appendice ou un prolongement (gratuit ?) du film.
Le film de Bérard est un produit artistique d’une qualité artisanale et douteuse, voire mauvaise, un film que l’on dirait raté, aussi bien dans le sujet choisi (qui n’est qu’une reprise jouissive et carnavalesque des conventions du film de guerre ou d’un téléfilm américain quelconque) que dans le jeu des acteurs, ou encore dans les moyens de tournage. Il s’agit d’un produit fait maison, à la fois incongru et comique, et qui, en accord avec l’ensemble de la production artistique de Bérard, a été souvent classé parmi des œuvres parodiques, idiotes, voire « topiques » (dans le sens d’une modélisation qui réduit tout à des fonctions et à des schèmes minimaux) [27]. Il semble cependant que Bérard présente ce produit comme une œuvre d’art authentique – avec un profil low-fi et tournée avec des moyens low cost, certainement – revendiquant non risiblement une insertion dans les réseaux des musées et des galeries d’art, voire dans la tradition du marketing hollywoodien. Le film excède l’histoire racontée tout comme l’objet-film lui-même et se laisse appréhender dans une réception à la fois conceptuelle et contextuelle. Le but de Mortinsteinck – le film – et d’une bonne partie de l’œuvre de Bérard est de créer une faille en pénétrant un milieu artistique (le milieu du cinéma et/ou de l’art, le cas échéant), donc de fonctionner comme un objet d’art sans en avoir les traits essentiels ou qui permettent communément de reconnaitre un objet d’art en tant que tel. Le film se conçoit alors comme un outil apte à déclencher un processus d’interrogation et de révision dans lequel réside l’opération artistique véritable. En s’insérant de façon apparemment incongrue dans le milieu institutionnel du cinéma et/ou de l’art, Mortinsteinck suscite une série d’interrogations au sujet de l’institution qui est supposée légitimer l’existence de l’objet d’art lui-même, de la nature de l’art et de son fonctionnement, du statut de l’œuvre d’art, de sa circulation et de sa valeur marchandes, bref une réflexion philosophique, logique et sociologique digne de la plus pure tradition d’une philosophie de l’art [28].
Ce film de Bérard invite à repenser l’œuvre d’art non plus comme un objet clos et défini par essence, donc comme une entité autonome, mais en tant qu’objet en réseau. Repenser l’objet artistique inséré dans son réseau contextuel de fabrication veut dire lire l’objet sans faire abstraction du contexte qui lui donne un sens. Et c’est proprement vers cette direction que le livre de Nathalie Quintane mène le lecteur du livre et le spectateur du film [29]. Si l’on s’attache à dénombrer les références au monde institutionnel de l’art contenues dans le livre, on voit qu’un certain nombre de passages s’inscrit dans cette catégorie. On pourrait y rattacher un document comme la lettre de convocation adressée à Nathalie Quintane pour intégrer le jury du « Festival du Cinéma Américain de Deauville », la référence à la conférence de Régis Debray tenue à Digne-les-Bains (dont les images ouvrent le film de Bérard), ou encore l’évocation de la ville de Cannes et de l’imaginaire spectaculaire qu’elle évoque dans nos croyances [30].
En suivant cette ligne critique, il apparaît que le film et le livre du film fonctionnent comme un véritable dispositif qui, excluant toute filiation ou hiérarchie, est à prendre comme une interrogation globale sur le monde institué et institutionnalisé de l’art et sur les modalités courantes de circulation et de diffusion de ses objets. Bérard et Quintane façonnent, séparément et chacun par ses codes, un objet d’art à deux têtes, filmique et littéraire à la fois, qui invente et produit des formes de légitimité – remises en question sitôt produites – et engendre ou pénètre donc un art qui remet aussitôt en question ses propres critères d’évaluation.
[20] Cl. Rosset, Le Réel et son double [1976], Paris, Gallimard, 1984.
[21] J.-M. Gleize, Film à venir, Paris, Seuil, 2007.
[22] Ibid., p. 11.
[23] Ibid., p. 117.
[24] Ibid., p. 149.
[25] Ibid., p. 150.
[26] N. Quintane, Mortinsteinck, Paris, P.O.L, 1999, couverture.
[27] Sur ces trois jugements critiques voir respectivement : A. Labelle Rojoux, L’Art parodic’, Paris, Java, 1996, rééd. Cadeilhan, Zulma, 2003 ; J.-Y. Jouannais, L’Idiotie, Paris, Beaux-arts magazine, 2003 ; J.-M. Chapoulie, Preuves de cinéma, 2005 (dernière consultation le 19 octobre 2013).
[28] Comme le remarque déjà Johann Defer au sujet de Ce que je fiche, « le geste artistique fondamental consiste donc à interroger des structures de réception dont la valeur institutionnelle est d’importance notoire, en s’y insérant » (J. Defer, Les Protocoles expérimentaux dans le catalogue d’exposition de Stéphane Bérard. Ce que je fiche, La passe du vent, 2006, p. 8).
[29] Dans une visée plus générale, on peut affirmer, comme le fait Alain Farah, que Mortinsteinck est un « art poétique » où trouvent une formulation positive certains traits de l’esthétique de Quintane (comme le douteux). Voir A. Farah, Le Gala des incomparables, Paris, Classiques Garnier, 2013, pp. 177-181.
[30] Voir N. Quintane, Mortinsteinck, op. cit., respectivement pp. 16, 21-23, 31.
![]()